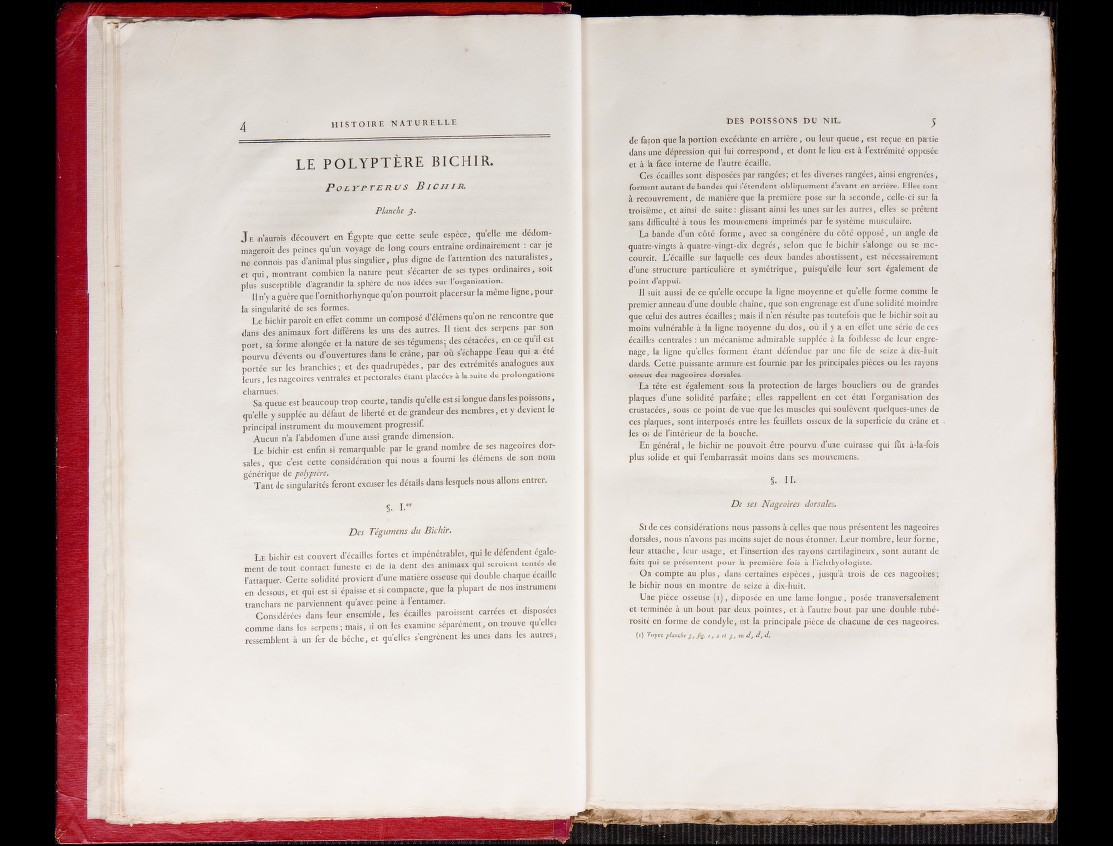
LE P O L Y P T È R E BICHIR.
P O L Y P T E R U S B l C H I R .
Planche y .
J e n'aurais découvert en Égypte que cette seule espèce, quelle me dédommagerait
des peines qu’un voyage de long cours entraîne ordinairement : car je
ne connois pas d’animal plus singulier, plus digne de l’attention des naturalistes,
et qui, montrant combien la nature peut s’écarter de ses types ordinaires, soit
plus susceptible d’agrandir la sphère de nos idées sur 1 organisation.
Il n’y a guère que l’ornithorhynque qu’on pourroit placer sur la meme ligne, pour
la singularité de ses formes.
Le bichir paroît en effet comme un composé d’élémens qu’on ne rencontre que
dans des animaux fort différens les uns des autres. Il tient des serpens par son
port, sa forme alongée et la nature de ses tégumens; des cétàcées, en ce quil est
pourvu d’évents ou d’ouvertures dans le crâne, par où s’échappe l’eau qui a été
portée sur les branchies; et des quadrupèdes, par des extrémités analogues aux
leurs, les nageoires ventrales et pectorales étant placées à la suite de prolongations
charnues. (
Sa queue est beaucoup trop courte, tandis qu’elle est si longue dans les poissons,
qu’elle y supplée au défaut de liberté et de grandeur des membres, et y devient le
principal instrument du mouvement progressif.
Aucun n’a l’abdomen d’une aussi grande dimension.
Le bichir est enfin si remarquable par le grand nombre de ses nageoires dorsales
, que c’est cette considération qui nous a fourni les élémens de son nom
générique de polyptère.
Tant de singularités feront excuser les détails dans lesquels nous allons entrer.
§. m
D es Tégumens du Bichir.
L e bichir est couvert d’écailles fortes et impénétrables, qui le défendent également
de tout contact funeste et de la dent des animaux qui seroient tentés de
l’attaquer. Cette solidité provient d’une matière osseuse qui double chaque écaille
en dessous, et qui est si épaisse et si compacte, que la plupart de nos instrumens
tranchans ne parviennent quavec peine a 1 entamer.
Considérées dans leur ensemble, les écailles paraissent carrées et disposées
comme dans les serpens ; mais, si on les examine séparément , on trouve quelles
ressemblent à un fer de bêche, et qu’elles s’engrènent les unes dans les autres,
de façon que la portion excédante en arrière, ou leur queue, est reçue en partie
dans une dépression qui lui correspond, et dont le lieu est à l’extrémité opposée
et à la face interne de l’autre écaille.
Ces écailles sont disposées par rangées; et les diverses rangées, ainsi engrenées,
forment autant de bandes qui s’étendent obliquement d’avant en arrière. Elles sont
à recouvrement, de manière que la première pose sur la seconde, celle-ci sur la
troisième, et ainsi de suite: glissant ainsi les unes sur les autres, elles se prêtent
sans difficulté à tous les mouvemens imprimés par le système musculaire.
La bande d’un côté forme, avec sa congénère du- côté opposé, un angle de
quatre-vingts à quatre-vingt-dix degrés, selon que le bichir s’alonge ou se raccourcit.
L ’écaille sur laquelle ces deux bandes aboutissent, est nécessairement
d’une structure particulière et symétrique, puisqu’elle leur sert également de
point d’appui.
II suit aussi de ce qu’elle occupe la ligne moyenne et qu’elle forme comme le
premier anneau d’une double chaîne, que son engrenage est d’une solidité moindre
que celui des autres écailles ; mais il n’en résulte pas toutefois que le bichir soit au
moins vulnérable à la ligne moyenne du dos, où il y a en effet une série de ces
écailles centrales : un mécanisme admirable supplée à la foiblesse de leur engrenage,
la ligne qu’elles forment étant défendue par une file de seize à dix-huit
dards. Cette puissante armure-est fournie par les principales pièces ou les rayons
osseux des nageoires dorsales.
La tête est également sous la protection de larges boucliers ou de grandes
plaques d’une solidité parfaite ; elles rappellent en cet état l’organisation des
crustacées, sous ce point de vue que les muscles qui soulèvent quelques-unes de
ces plaques, sont interposés entre les feuillets osseux de la superficie du crâne et
les os de l’intérieur de la bouche.
En général, le bichir ne pouvoit être pourvu d’une cuirasse qui fût à-la-fois
plus solide et qui l’embarrassât moins dans ses mouvemens.
S. II.
D e ses Nageoires dorsales.
Si de ces considérations nous passons à celles que nous présentent les nageoires
dorsales, nous n’avons pas moins sujet de nous étonner. Leur nombre, leur forme,
leur attache, leur usage, et l’insertion des rayons cartilagineux, sont autant de
faits qui se présentent pour la première fois à l’ichthyologiste.
On compte au plus, dans certaines espèces, jusqu’à trois de ces nageoires;
lè bichir nous en montre de seize à dix-huit.
Une pièce osseuse ( i) , disposée en une lame longue, posée transversalement
et terminée à un bout par deux pointes, et à l’autre bout par une double tubérosité
en forme de condyle, est la principale pièce de chacune de ces nageoires.
(i) Voyez planche y , fig. j , 2 et 3 , en d , a , d.