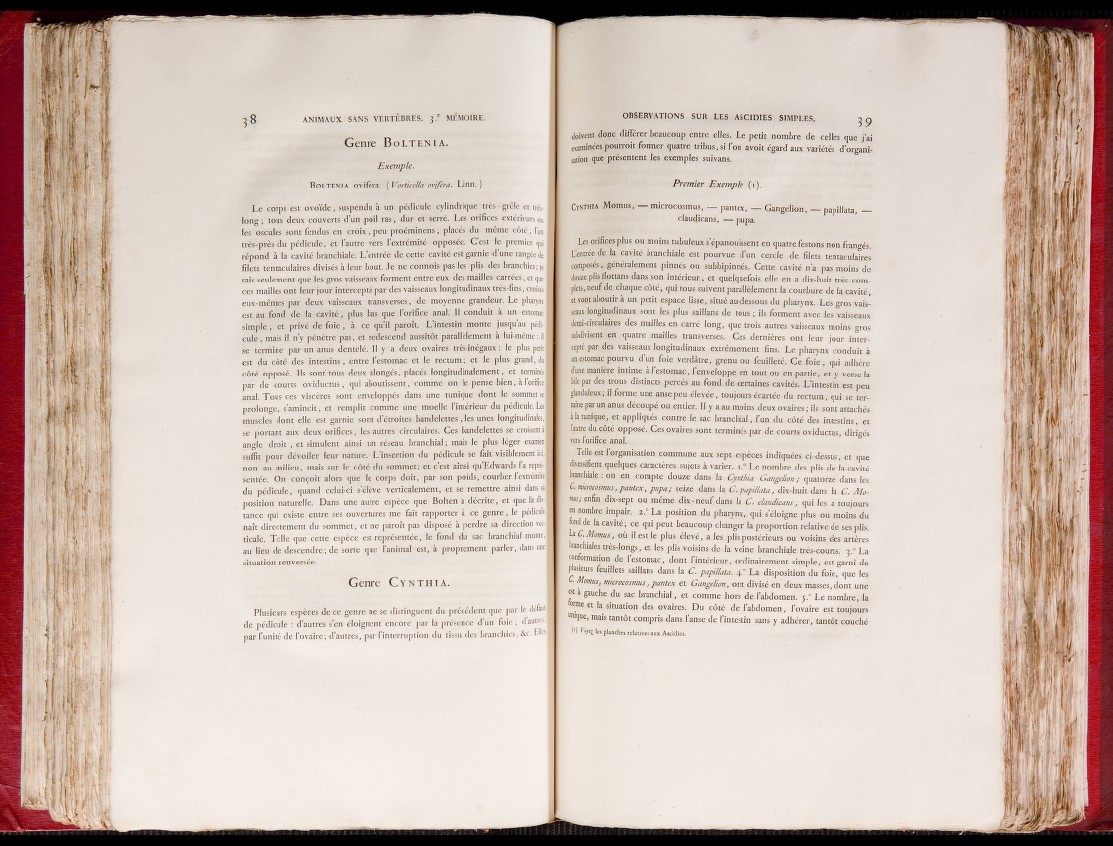
Genre B o l t e n i a .
Exemple.
. B o l t e n i a ovifera. ( Vorticella ovifera. Linn. )
L e corps est ovoïde, suspendu à un pédicule cylindrique très-grêle et très- 1
long ; tous deux couverts d’un poil ras, dur et serré. Les orifices extérieurs ou ■
les oscules sont fendus en croix , peu proéminens, places du même coté, l’un I
très-près du pédicule, et l’autre vers l’extrémité opposée. C ’est le premier qui I
répond à la cavité branchiale. L ’entrée de cette cavité est garnie d’une rangée de I
filets tentaculaires divisés à leur bout. Je ne connois pas les plis des branchies; je I
sais seulement que les gros vaisseaux forment entre eux des mailles carrées, et que I
ces mailles ont leur jour intercepté par' des vaisseaux longitudinaux tres-fins, croisés I
eux-mêmes par deux vaisseaux transverses, de moyenne grandeur. Le pharynxI
est au fond de la cavité, plus bas que l’orifice anal. Il conduit a un estomac I
simple , et privé de foie , à ce qu’il paroît. L ’intestin monte jusqu’au pédi-1
cule , mais il n’y pénètre pas, et redescend aussitôt parallèlement à lui-même : il H
se termine par un anus dentèlé. Il y a deux ovaires très-inegaux : le plus petit®
est du côté des intestins, entre l’estomac et le rectum; et le plus grand, duI
côté opposé. Ils sont tous deux alongés, placés longitudinalement, et terminés®
par de courts oviductus, qui aboutissent, comme on le pense bien, à l’oriiicer
anal. Tous ces viscères sont enveloppés dans une tunique dont le sommet sel
prolonge, s’amincit, et remplit comme une moelle l’intérieur du pédicule.Les®
muscles dont elle est garnie sont d’étroites bandelettes, les unes longitudinales,!
se portant aux deux orifices, les autres circulaires. Ces bandelettes se croisentà|
angle droit , et simulent ainsi un réseau branchial ; mais le plus leger examen
suffit pour dévoiler leur nature. L ’insertion du pédicule se fait visiblement ici,l
non au milieu, mais sur le côté du sommet; et c’est ainsi qu’Edwards l’a repré-1
sentée. On conçoit alors que le corps doit, par son poids, courber l'extrémité!
du pédicule, quand celui-ci s’élève verticalement, et se remettre ainsi dans saP
position naturelle. Dans une autre espèce que Bolten a décrite, et que la distance
qui existe entre ses ouvertures me fait rapporter à ce genre, le pédicule
naît directement du sommet, et ne paroît pas disposé à perdre sa direction ver-l
ticale. Telle que cette espèce est représentée, le fond du sac branchial monte,
au lieu de descendre; de sorte que l’animal est, à proprement parler, dans une
situation renversée.
Genre C y n t h i a .
Plusieurs espèces de ce genre ne se distinguent du précédent que par le défaut
de pédicule : d’autres s’en éloignent encore par la présence d’un foie ; d autres,^
par l’unité de l’ovaire; d’autres, par l’interruption du tissu des branchies, &c. Elles
doivent donc différer beaucoup entre elles. Le petit nombre de celles que j’ai
examinées pourroit former quatre tribus, si 1 on avoit égard aux variétés d’organisation
que présentent les exemples suivans.
Premier Exemple (1).
C y n t h i a Momus, — microcosmus, — pantex, — Gangelion, — papillata, —
claudicans, — pupa.
Les orifices plus ou moins tubuleux s’épanouissent en quatre festons non frangés.
L ’e n tré e de la cavité branchiale est pourvue d’un cercle de filets tentaculaires
composés, .généralement pinnés ou subbipinnés. Cette cavité n’a pas moins de
douze plis fiottans dans son intérieur, et quelquefois elle en a dix-huit très-complets,
neuf de chaque côté, qui tous suivent parallèlement la courbure de la cavité,
et vont aboutir à un petit espace lisse, situé au-dessous du pharynx. Les gros vaisseaux
longitudinaux sont les plus saillans de tous ; ils forment avec les vaisseaux
demi-circulaires des mailles en carré long, que trois autres vaisseaux moins gros
subdivisent en quatre mailles transverses. Ces dernières ont leur jour intercepté
par des vaisseaux longitudinaux extrêmement fins. Le pharynx conduit à
1111 estomac pourvu d'un foie verdâtre, grenu ou feuilleté. C e fo ie , qui adhère
dune manière intime à 1 estomac, l’enveloppe en tout ou en partie, et y verse la
bile par des trous distincts percés au fond de certaines cavités. L ’intestin est peu
glanduleux; il forme une anse peu élevée, toujours écartée du rectum, qui se termine
par un anus découpé ou entier. Il y a au moins deux ovaires ; ils sont attachés
à la tunique, et appliqués contre le sac branchial, l’un du côté des intestins, et
lautre du, coté oppose. Ces ovaires sont terminés par de courts oviductus, dirigés
vers l’orifice anal.
Telle est 1 organisation commune aux sept espèces indiquées ci-dessus, et que
diversifient quelques caractères sujets à varier. i.° Le nombre des plis de la cavité
branchiale ; on en compte douze dans la Cynthia Gangelion; quatorze dans les
C. microcosmus, pantex. pupa; seize dans la C.papillata, dix-huit dans la C. Mornes,
enfin dix-sept ou meme dix-neuf dans la C . claudicans, qui les a toujours
en nombre impair. 2.° La position du pharynx, qui s’éloigne plus ou moins du
fond de la cavité; ce qui peut beaucoup changer la proportion relative de ses plis.
La C.Momus, où il est le plus élevé, a les plis postérieurs ou voisins des artères
ranchiales très-longs, et les plis voisins de la veine branchiale très-courts. 3.0 La
con ormation de 1 estomac, dont 1 intérieur, ordinairement simple, est garni de
pusieurs feuillets saillans dans la C . papillata. 4 ° La disposition du foie, que les
■ Momus, microcosmus, pantex et Gangelion, ont divisé en deux masses, dont une
« a gauche du sac branchial, et comme hors de l’abdomen. y.° Le nombre, la
orme et la situation des ovaires. Du côté de l’abdomen, l’ovaire est toujours
“"■que, mais tantôt compris dans l’anse de l’intestin sans y adhérer, tantôt couché
(0 Voyr^ les planches relatives aux Ascidies.