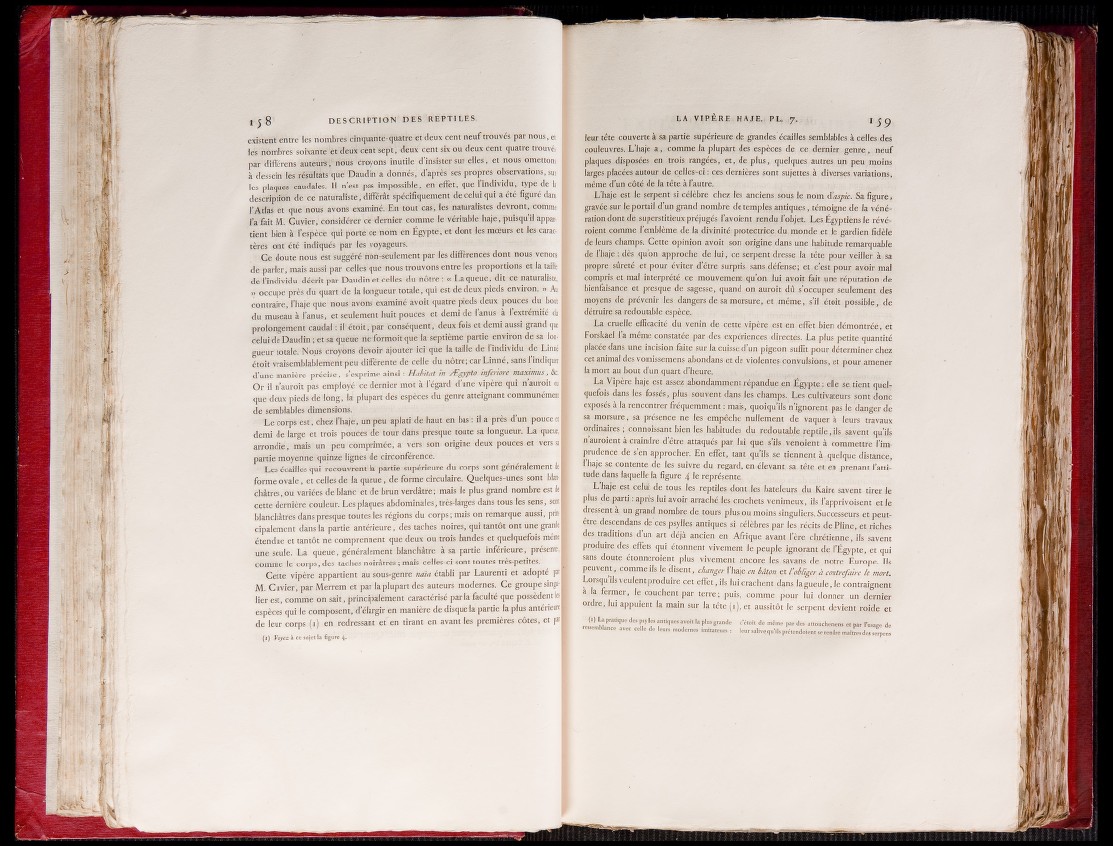
existent entre les nombres cinquante-quatre et deux cent neuf trouvés par nous, et
les nombres soixante et deux cent sept, deux cent six ou deux cent quatre trouvés
par différens auteurs, nous croyons inutile d’insister sur elles, et nous omettons
à dessein les résultats que Daudin a donnés, d’après ses propres observations, sur
les plaques caudales. Il n’est pas impossible, en effet, que l’individu, type de la
description de ce naturaliste, différât spécifiquement de celui qui a été figuré dans
l’Atlas et que nous avons examiné. En tout cas, les naturalistes devront, comme
l’a fait M. Cuvier, considérer ce dernier comme le véritable haje, puisqu’il appartient
bien à l’espèce qui porte ce nom en Égypte, et dont les moeurs et les caractères
ont été indiqués par les voyageurs.
Ce doute nous est suggéré non-seulement par les différences dont nous venons
de parler, mais aussi par celles que nous trouvons entre les proportions et la taille
de l’individu décrit par Daudin et celles du notre : « La queue, dit ce naturaliste,
» occupe près du quart de la longueur totale, qui est de deux pieds environ. » Au
contraire, l’haje que nous avons examiné avoit quatre pieds deux pouces du bout
du museau à l’anus, et seulement huit pouces et demi de 1 anus à 1 extrémité du
prolongement caudal : il étoit, par conséquent, deux fois et demi aussi grand que
celui de Daudin ; et sa queue ne formoit que la septième partie environ de sa longueur
totale. Nous croyons devoir ajouter ici que la taille de 1 individu de Linné
étoit vraisemblablement peu différente de celle du notre ; car Linné, sans 1 indiquer
d’une manière précise, s’exprime ainsi : Habitat in Ægypto infe7iore maximus, &c.
Or il n’auroit pas employé ce dernier mot a 1 égard d une vipère qui n auroit eu
que deux pieds de long, la plupart des espèces du genre atteignant communément
de semblables dimensions.
Le corps est, chez l’haje, un peu aplati de haut en bas : il a près dun pouce etI
demi de large et trois pouces de tour dans presque toute sa longueur. La queue,
arrondie, mais un peu comprimée, a vers son origine deux pouces et vers sa
partie moyenne quinze lignes de circonférence.
Les écailles qui recouvrent la partie supérieure du corps sont généralement de
forme ovale, et celles de la queue, de forme circulaire. Quelques-unes sont blanchâtres,
ou variées de blanc et de brun verdâtre; mais le plus grand nombre est de
cette dernière couleur. Les plaques abdominales, tres-larges dans tous les sens, sont
blanchâtres dans presque toutes les régions du corps ; mais on remarque aussi, pria
cipalement dans la partie antérieure, des taches noires, qui tantôt ont une grandeI
étendue et tantôt ne comprennent que deux ou trois bandes et quelquefois meme
une seule. La queue, généralement blanchâtre a sa partie inférieure, présente,r
comme le corps, des taches noirâtres ; mais celles-ci sont toutes très-petites.
Cette vipère appartient au sous-genre naia établi par Laurenti et adopte pat I
M. Cuvier, par Merrem et par la plupart des auteurs modernes. Ce groupe singulier
est, comme on sait, principalement caractérisé par la faculté que possèdent les
espèces qui le composent, d’élargir en manière de disque la partie la plus antérieure
de leur corps (i) en redressant et'en tirant en avant les premières côtes, et pat
(i) Voyez à ce sujet la figure 4-
leur téte couverte à sa partie supérieure de grandes écailles semblables à celles des
couleuvres. L ’haje a , comme la plupart des espèces de ce dernier genre, neuf
plaques disposées en trois rangées, et, de plus, quelques autres un peu moins
larges placées autour de celles-ci : ces dernières sont sujettes à diverses variations,
même d’un côté de la tête à l’autre.
L ’haje est le serpent si célèbre chez les anciens sous le nom d’aspic. Sa figure,
gravée sur le portail d’un grand nombre de temples antiques, témoigne de la vénération
dont de superstitieux préjugés l’avoient rendu l’objet. Les Égyptiens le révé-
roient comme l’emblème de la divinité protectrice du monde et le gardien fidèle
de leurs champs. Cette opinion avoit son origine dans une habitude remarquable
de l’haje ; dès qu’on approche de lui, ce serpent dresse la tête pour veiller à sa
propre sûreté et pour éviter d’être surpris sans défense; et c’est pour avoir mal
compris et mal interprété ce mouvement qu’on lui avoit fait une réputation de
bienfaisance et presque de sagesse, quand on auroit dû s’occuper seulement des
moyens de prévenir les dangers de sa morsure, et même, s’il étoit possible, de
détruire sa redoutable espèce.
La cruelle efficacité du venin de cette vipère est en effet bien démontrée, et
Forskael 1 a même constatée par des expériences directes. La plus petite quantité
placée dans une incision faite sur la cuisse d’un pigeon suffit pour déterminer chez
cet animal des vomissemens abondans et de violentes convulsions, et pour amener
la mort au bout d’un quart d’heure.
La Vipère haje est assez abondamment répandue en Égypte : elle se tient quelquefois
dans les fossés, plus souvent dans les champs. Les cultivateurs sont donc
exposés à la rencontrer fréquemment : mais, quoiqu’ils n’ignorent pas le danger de
sa morsure, sa présence ne les empêche nullement de vaquer à leurs travaux
ordinaires; connoissant bien les habitudes du redoutable reptile, ils savent qu’ils
n’auroient à craindre d’être attaqués par lui que s’ils venoient à commettre l’imprudence
de s’en approcher. En effet, tant qu’ils se tiennent à quelque distance,
I haje se contente de les suivre du regard, en élevant sa tête et en prenant l’attitude
dans laquelle la figure 4 le représente.
L haje est celui de tous les reptiles dont les bateleurs du Kaire savent tirer le
plus de parti : après lui avoir arraché les crochets venimeux, ils l’apprivoisent et le
dressent à un grand nombre de tours plus ou moins singuliers. Successeurs et peut-
être descendans de ces psyiles antiques si célèbres par les récits de Pline, et riches
(le?.traditions dun art déjà ancien en Afrique avant l’ère chrétienne, ils savent
produire des effets qui étonnent vivement le peuple ignorant de J’Égypte, et qui
sans doute étonneroient plus vivement encore les savans de notre Europe. Ils
peuvent, comme ils le disent, changer l’haje en bâton et l ’obliger à contrefaire le mort.
Lorsqu ils veulent produire cet effet, iis lui crachent dans la gueule, le contraignent
à la fermer, le couchent par terre; puis, comme pour lui donner un dernier
ordre, lui appuient la main sur la tête (i), et aussitôt le serpent devient roide et
‘ 1 M PraliqUe d“ 7 0it Ia P‘“ S gra” de C’ét0it de même Par des attouchemens et par l’usage de
ressemblance avec celle de leurs modernes imitateurs : leur salive qu’ils prétendaient se rendre maîtres des serpens