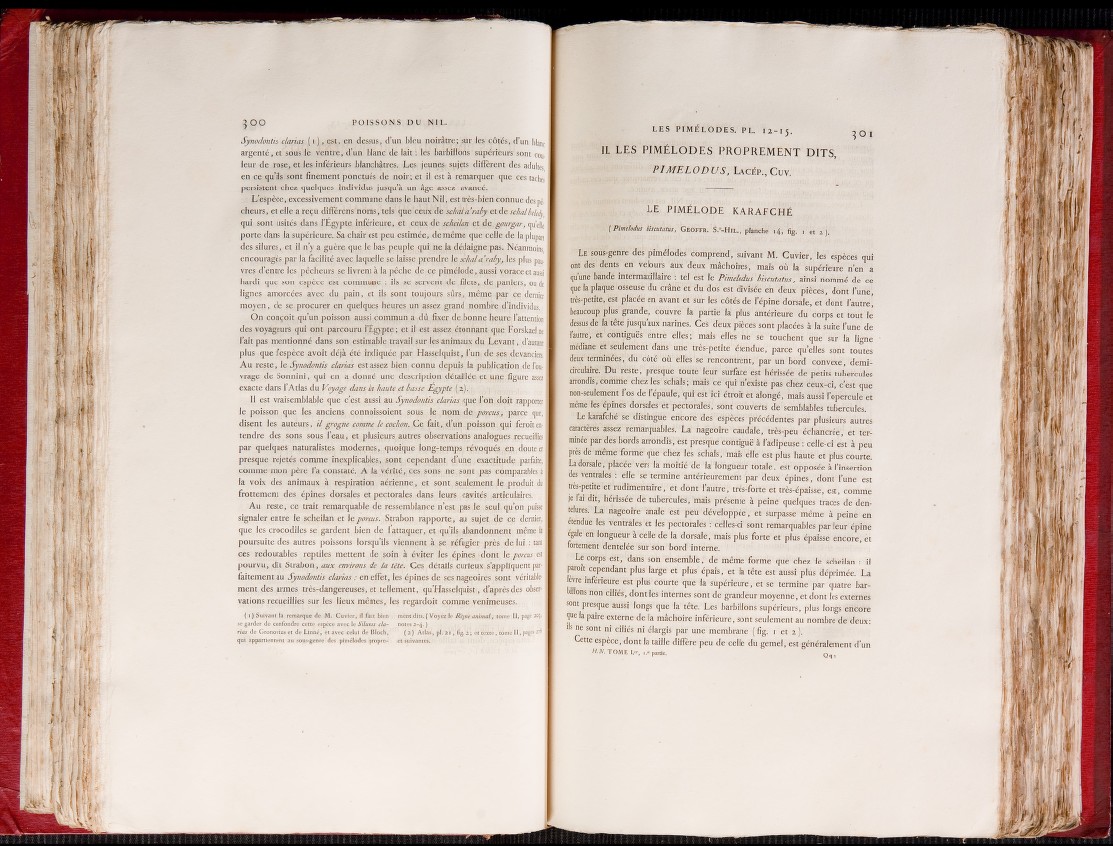
Synodonùs ciarías ( i ) , est, en dessus, d’un bieu noirâtre; sur les côtés, d’un blata
argenté, et sous le ventre, d’un blanc de lait ; les barbillons supérieurs sont con.
leur de rose, et les inférieurs blanchâtres. Les jeunes sujets diffèrent des adultes
en ce qu’ils sont finement ponctués de noir; et il est à remarquer que ces taches
persistent chez quelques individus jusqu’à un âge assez avancé.
L ’espèce, excessivement commune dans le haut Nil, est très-bien connue despc-
cheurs, et elle a reçu différens noms, tels que ceux de scimi a’raby et de schalbelcdy
qui sont usités dans l’Egypte inférieure, et ceux de scheilan et de gourgar, qu’e||e
porte dans la supérieure. Sa chair est peu estimée, de même que celle de la plupart
des silures, et il n’y a guère que le bas peuple qui ne la dédaigne pas. Néanmoins
encouragés par la facilité avec laquelle se laisse prendre le schala'raby, les plus pan-
vres d’entre les pêcheurs se livrent à la pêche de ce pimélode, aussi vorace et aussi
hardi que son espèce est commune : ils se servent de filets, de paniers, ou de
lignes amorcées avec du pain, et ils sont toujours sûrs, même par ce dernier
moyen, de se procurer en quelques heures un assez grand nombre d’individus.
On conçoit qu’un poisson aussi commun a du fixer de bonne heure l'attention
des voyageurs qui ont parcouru l’Egypte ; et il est assez étonnant que Forskael ne
l’ait pas mentionné dans son estimable travail sur les animaux du Levant, d’autant
plus que l’espèce avoit déjà été indiquée par Hasselquist, l’un de ses devancière,
A u reste, le Synodonùs ciarías est assez bien connu depuis la publication de l’ouvrage
de Sonnini, qui en a donné une description détaillée et une figure assez
exacte dans l’Atlas du Voyage dans la haute et basse Egypte ( z).,|.
Il est vraisemblable que c’est aussi au Synodonùs ciarías que l’on doit rapporter
le poisson que les anciens connoissoient sous le nom de porcus, parce que,
disent les auteurs, il grogne comme le cochon. Ce fait, d’un poisson qui feroitentendre
des sons sous l’eau, et plusieurs autres observations analogues recueillies
par quelques naturalistes modernes, quoique long-temps révoqués en doute et
presque rejetés comme inexplicables, sont cependant d’une exactitude parfaite,
comme mon père l’a constaté. A la vérité, ces sons ne sont pas comparables à
la voix des animaux à respiration aérienne, et sont seulement le produit du
frottement des épines dorsales et pectorales dans leurs cavités articulaires.
Au reste, ce trait remarquable de ressemblance n’est pas le seul qu’on puisse
signaler entre le scheilan et le porcus. Strabon rapporte, au sujet de ce dernier,
que les crocodiles se gardent bien de 1 attaquer, et qu’ils abandonnent même la
poursuite des autres poissons lorsqu’ils viennent à se réfugier près de lui : tant
ces redoutables reptiles mettent de soin à éviter les épines dont le porcus est
pourvu, dit Strabon, aux environs de la tête. Ces détails curieux s’appliquent parfaitement
au Synodonùs ciarías : en effet, les épines de ses nageoires sont véritablement
des armes très-dangereuses, et tellement, qu’Hasselquist, d’après des observations
recueillies sur les lieux mêmes, les regardoit comme venimeuses.
( i ) Suivant la remarque de M. Cuvier, il faut bien nient dits. ( Voyez le Règne animal, tome II, page 20},
se garder de confondre cette espèce avec le Silurus cia- notes 2-4. )
rias de Gronovius et de Linné, èt avec celui de Bloch, (2 ) Atlas, pl. 2 1 , fig. 2; et texte, tóme II,pages 270
qui appartiennent au sous-genre des piméiodes propre- e t suivantes.
II. LES PIMÉLODES PROPREMENT DITS,
P l M E L O D U S , L a c é p . , C u v .
L E P IM É L O D E K A R A F C H É
[P im tlo iu s biscutatus, G e o f f r . S Z -H i l . , planche i 4, fig. 1 et 2 ).
Le sous-genre des piméiodes comprend, suivant M. Cuvier, les espèces qui
ont des dents en velours aux deux mâchoires, mais où la supérieure n’en a
qu’une bande intermaxillaire ; tel est le Pimelodus biscutatus, ainsi nommé de ce
que la plaque osseuse du crâne et du dos est divisée en deux pièces, dont l'une,
très-petite, est placée en avant et sur les côtés de l’épine dorsale, et dont l’autre!
beaucoup plus grande, couvre la partie la plus antérieure du corps et tout lé
dessus de la tête jusqu’aux narines. Ces deux pièces sont placées à la suite l’une de
1 autre, et contiguës entre elles; mais elles ne se touchent que sur la ligne
médiane et seulement dans une très-petite étendue, parce qu’elles sont toutes
deux terminées, du côté où elles se rencontrent, par un bord convexe, demi-
circulaire. Du reste, presque toute leur surface est hérissée de petits tubercules
arrondis y comme chez les schals; mais ce qui n existe pas chez ceux-ci, c’est que
non-seulement 1 os de 1 epaule, qui est ici étroit et alongé, mais aussi l’opercule et
meme lës'epines dorsales et pectorales, sont couverts de semblables tubercules.
Le karafché se distingue encore des espèces précédentes par plusieurs autres
caractères assez remarquables. La nageoire caudale, très-peu échancrée, et terminée
par des bords arrondis, est presque contiguë à l’adipeuse ; celle-ci est à peu
près de même forme' que chez les schals, mais elle est plus haute et plus courte.
La dorsale, placée vers la moitié de la longueur totale, est opposée à l’insertion
des ventrales ; elle se termine antérieurement par deux épines, dont l’une est
très-petite et rudimentaire, et dont l’autre, très-forte et très-épaisse, est, comme
je 1 ai dit, hérissée de tubercules/mais présente à peine quelques traces de dentelures.
La nageoire anale est peu développée, et surpasse même à peine en
etendue les ventrales et les pectorales ; celles-ci sont remarquables par leur épine
égale en longueur à celle de la dorsale, mais plus forte et plus épaisse encore, et
fortement dentelée sur son bord interne.
Le corps est, dans son ensemble, de même forme que chez le scheilan ; il
paroit cependant plus large et plus épais, et la tête est aussi plus déprimée. La
evre inférieure est plus courte que la supérieure, et se termine par quatre barbillons
non ciliés, dont les internes sont de grandeur moyenne, et dont les externes
sont presque aussi longs que la tête. Les barbillons supérieurs, plus longs encore
que la paire externe de la mâchoire inférieure, sont seulement au nombre de deux;
ils ne sont ni ciliés ni élargis par une membrane ( fig. 1 et 2. ).
Cette espèce, dont la taille diffère peu de celle du gemel, est généralement d’un
H.N. TOME I.», ..» p a r t ie . q