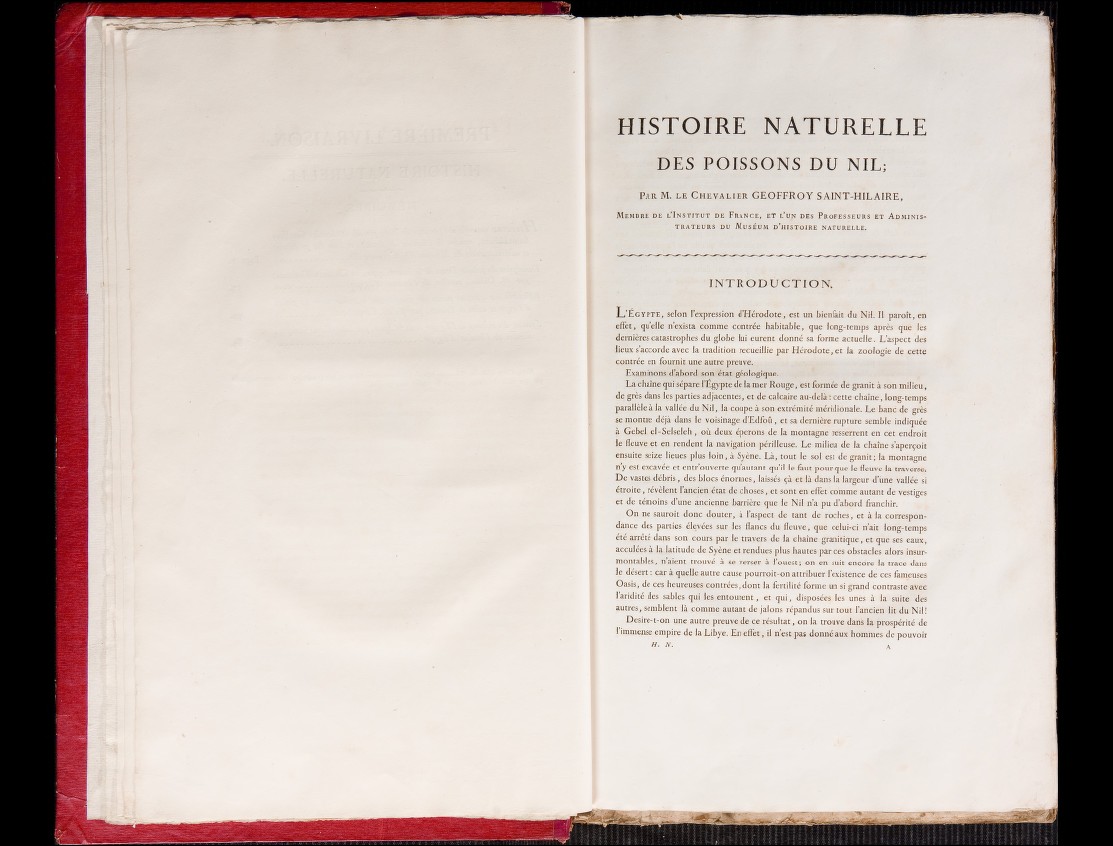
HISTOIRE NATURELLE
DES POISSONS DU NIL;
P a r M. l e C h e v a l i e r G E O F F R O Y S A IN T -H I L A IR E ,
M e m b r e d e l ’ I n s t i t u t d e F r a n c e , e t l’ u n d e s P r o f e s s e u r s e t A d m i n i s t
r a t e u r s d u M u s é u m d ’ h i s t o i r e n a t u r e l l e .
I N T R O D U C T I O N .
L ’ É g y p t e , selon l’expression d’H érodote, est un bienfait du Nil. IL paroît, en
effet, quelle n’exista comme contrée habitable, que long-temps après que les
dernières catastrophes du globe lui eurent donné sa forme actuelle. L ’aspect des
lieux s’accorde avec la tradition recueillie par Flérodote, et la zoologie de cette
contrée en fournit une autre preuve.
Examinons d’abord son état géologique.
La chaîne qui sépare l’Egypte de la mer Rouge, est formée de granit à son milieu,
de grès dans les parties adjacentes, et de calcaire au-delà : cette chaîne, long-temps
parallèle à la vallée du Nil, la coupe à son extrémité méridionale. Le banc de grès
se montre déjà dans le voisinage d’Edfoû , et sa dernière rupture semble indiquée
à Gebel el-Selseleh, où deux éperons de la montagne resserrent en cet endroit
le fleuve et en rendent la navigation périlleuse. Le milieu de la chaîne s’aperçoit
ensuite seize lieues plus loin, à Syène. Là, tout le sol est de granit; la montagne
n’y est excavée et entrouverte qu’autant qu’il le faut pour que le fleuve la traverse.
De vastes débris, des blocs énormes, laissés çà et là dans la largeur dune vallée si
étroite, révèlent l’ancien état de choses, et sont en effet comme autant de vestiges
et de témoins d’une ancienne barrière que le Nil n’a pu d’abord franchir.
On ne sauroit donc douter, à l’aspect de tant de roches, et à la correspondance
des parties élevées sur les flancs du fleuve, que celui-ci n’ait long-temps
été arrête dans son cours par le travers de la chaîne granitique, et que ses eaux,
acculées à la latitude de Syène et rendues plus hautes par ces obstacles alors insurmontables,
naient trouvé à se verser à l'ouest; on en suit encore la trace dans
le désert ; car à quelle autre cause pourroit-on attribuer l’existence de ces fameuses
Oasis, de ces heureuses contrées, dont la fertilité forme un si grand contraste avec
1 aridité des sables qui les entourent, et qui, disposées les unës à la suite des
autres, semblent là comme autant de jalons répandus sur tout l’ancien lit du Nil!
Desire-t-on une autre preuve de ce résultat, on la trouve dans la prospérité de
l’immense empire de la Libye. En effet, il n’est pas donné aux hommes de pouvoir
h . n . A