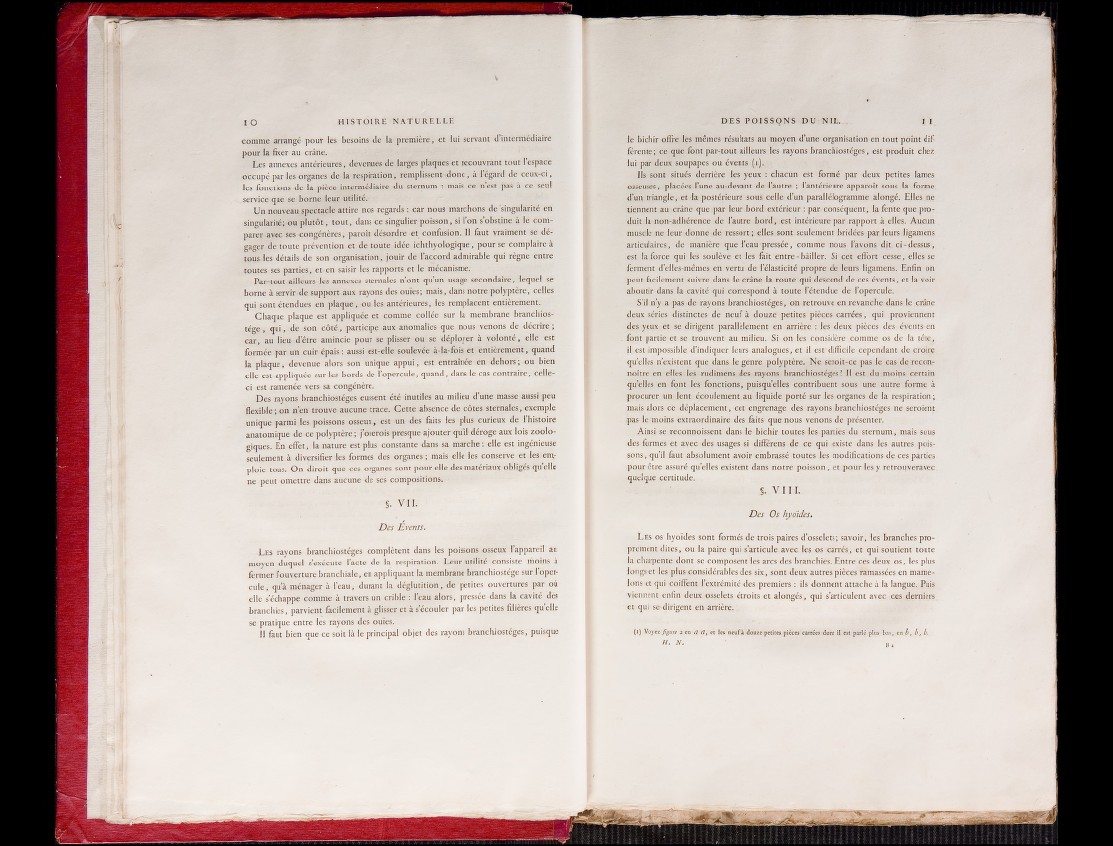
comme arrangé pour les besoins de la première, et lui servant d intermédiaire
pour la fixer au crâne.
Les annexes antérieures, devenues de larges plaques et recouvrant tout l’espace
occupé par les organes de la respiration, remplissent donc , à 1 égard de ceux-ci,
les fonctions de la pièce intermédiaire du sternum ; mais ce n est pas a ce seul
service que se borne leur utilité.
Un nouveau spectacle attire nos regards : car nous marchons de 'singularité en
singularité; ou plutôt, tout, dans ce singulier poisson, si l’on s’obstine à le comparer
avec ses congénères, paroît désordre et confusion. II faut vraiment se dégager
de toute prévention et de toute idée ichthyologique, pour se complaire à
tous, les détails de son organisation, jouir de l’accord admirable qui règne entre
toutes ses parties, et en saisir les rapports et le mécanisme.
Par-tout ailleurs les annexes sternales n’ont qu’un usage secondaire, lequel se
borne à servir de support aux rayons des ouïes; mais, dans notre polyptere, celles
qui sont étendues en plaque, ou les antérieures, les remplacent entièrement.
Chaque plaque est appliquée et comme collée sur la membrane branchios-
tége , q u i, de son cô té , participe aux anomalies que nous venons de décrire ;
car, au lieu d’être amincie pour se plisser ou se déployer à volonté, elle est
formée par un cuir épais : aussi est-elle soulevée à-la-fois et entièrement, quand
la plaque, devenue alors son unique appui, est entraînée en dehors ; ou bien
elle est appliquée sur les bords de l’opercule, quand, dans le cas contraire, celle-
ci est ramenée vers sa congénère.
Des rayons branchiostéges eussent été inutiles au milieu d’une masse aussi peu
flexible; on n’en trouve aucune trace. Cette absence de côtes sternales, exemple
unique parmi les poissons osseux, est un des faits les plus curieux de 1 histoire
anatomique de ce polyptère ; j’oserois presque ajouter qu’il déroge aux lois zoo logiques.
En effet, la nature est plus constante dans sa marche : elle est ingénieuse
seulement à diversifier les formes des organes ; mais elle les conserve et les em,-
ploie tous. On diroit que ces organes sont pour elle des matériaux obligés quelle
ne peut omettre dans aucune de ses compositions.
s. VII.
D es Évents.
L es rayons branchiostéges complètent dans les poissons osseux 1 appareil au
moyen duquel s’exécute l’acte de la respiration. L eu r utilité consiste moins à
fermer l’ouverture b ranchiale, en appliquant la membrane branchiostége sur l’opercu
le , qu’à ménager à l’e au , durant la d é g lu titio n , de petites ouvertures par o ù
elle s’échappe comme à travers un crible : l’eau alors, pressée dans la cavité dés
b ranchies, parvient facilement à glisser et à s’écouler pa r les petites filières qu’elle
se pratique entre les rayons des ouïes.
Il faut bien que ce soit là le principal objet des rayons branchiostéges, puisque
le bichir offre les mêmes résultats au moyen d’une organisation en tout point dif
férente; ce que font par-tout ailleurs les rayons branchiostéges, est produit chez
lui par deux soupapes ou évents (i).
Us sont situés derrière les yeux : chacun est formé par deux petites lames
osseuses, placées l’une au-devant de l’autre ; l’antérieure apparoît sous la forme
d’un triangle, et la postérieure sous celle d’un parallélogramme alongé. Elles ne
tiennent au crâne que par leur bord extérieur : par conséquent, la fente que produit
la non-adhérence de l’autre bord, est intérieure par rapport à elles. Aucun
muscle ne leur donne de ressort ; elles sont seulement bridées par leurs ligamens
articulaires, de manière que l’eau-pressée, comme nous l’avons dit ci-dessus,
est la force qui les soulève et les fait entre - bâiller. Si cet effort cesse, elles se
ferment d’elles-mêmes en vertu de l’élasticité propre de leurs ligamens. Enfin on
peut facilement suivre dans le crâne la roüte qui descend de ces évents, et la voir
aboutir dans la cavité qui correspond à toute l’étendue de l’opercule.
S’il n’y a pas de rayons branchiostéges, on retrouve en revanche dans le crâne
deux séries distinctes de neuf à douze petites pièces carrées, qui proviennent
des yeux et se dirigent parallèlement en arrière ; les deux pièces des évents en
font partie et se trouvent au milieu. Si on les considère comme os de la tête,
il est impossible d’indiquer leurs analogues, et il est"difficile cependant de croire
qu’elles n’existent que dans le genre polyptère. Ne seroit-ce pas le cas de recon-
noître en elles les rudimens des rayons branchiostéges ! Il est du moins certain
qu’elles en font les fonctions, puisqu’elles contribuent sous une autre forme à
procurer un lent écoulement au liquide porté sur les organes de la respiration;
mais alors ce déplacement, cet engrenage des rayons branchiostéges ne seroient
pas le moins extraordinaire des faits que nous venons de présenter.
Ainsi se reconnoissent dans le bichir toutes les parties du sternum, mais sous
des formes et avec des usages si différens de ce qui existe dans les autres poissons
, qu’il faut absolument avoir embrassé toutes les modifications de ces parties
pour être assuré qu’elles existent dans notre poisson, et pour les y retrouveraveç
quelque certitude.
s, v u I
D es Os hyoïdes.
L es os hyoïdes sont formés de trois paires d’osselets; savoir, les branches proprement
dites, ou la paire qui s’articule avec les os carrés, et qui soutient toute
la charpente dont se composent les arcs des branchies. Entre ces deux os, les plus
longs et les plus considérables des six, sont deux autres pièces ramassées en mamelons
et qui coiffent l’extrémité des premiers : ils donnent attache à la langue. Puis
viennent enfin deux osselets étroits et alongés, qui s’articulent avec ces derniers
et qui se dirigent en arrière.
(l) Voyez figure 2 en a il, et les neuf à douze petites pièces carrées dont il est parlé plus bas, en 1) , b , h.
H - N . • B i