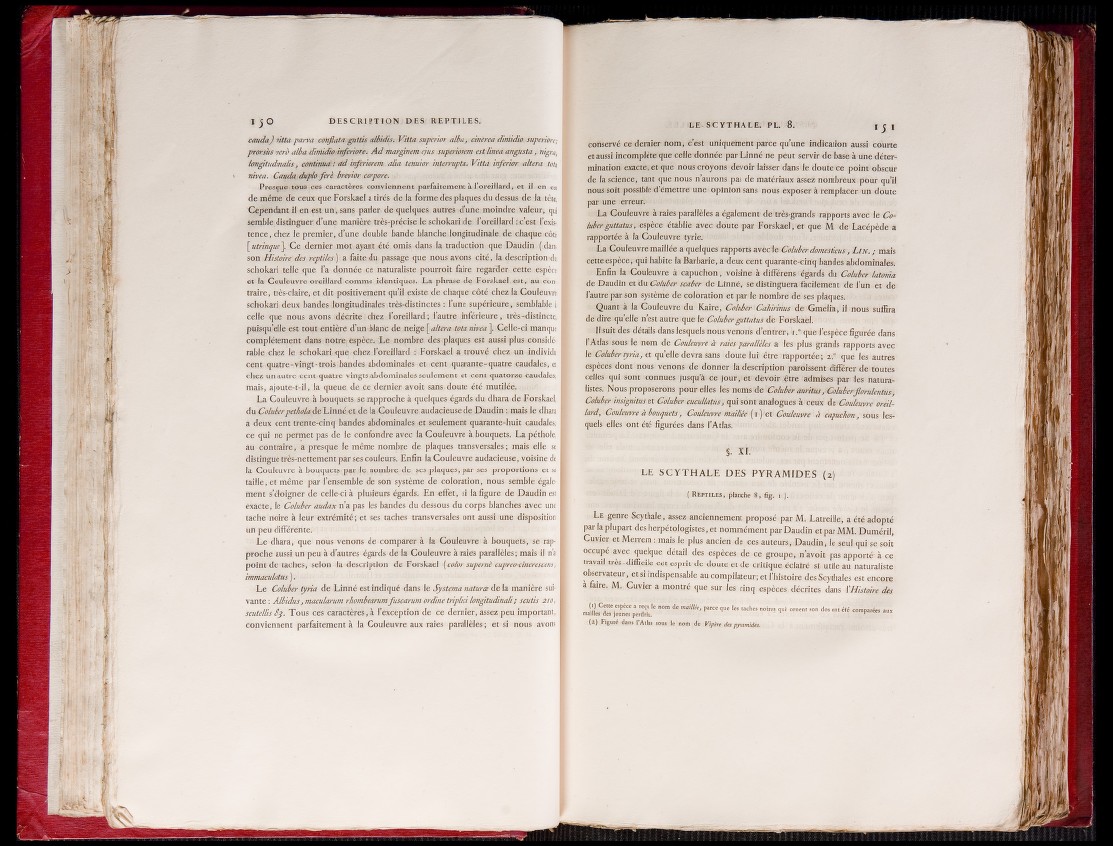
couda) vitta parva conflato gnttis albidis. Vit ta superior alba, cinerea diniidio superiore;
prorsàs vero alba dinùdio inferiore. A d marginem e/us superiorem est linea angusta, nigra,
longitudinalis, continua : ad ittfetiorem alia tenuior interrupta. Vitto inferior altera tota
nivea. Cauda duplo fe r i brevior corpore.
Presque tous ces caractères conviennent parfaitement à i’oreillard, et il en est
de même de ceux que Forskael a tirés de la forme des plaques du dessus de la tête.
Cependant il en est un, sans parler de quelques autres d’une moindre valeur, qui
semble distinguer d’une manière très-précise le schokari de l’oreillard : c’est l’existence,
chez le premier, d’une double bande blanche longitudinale de chaque côte
[ utrinque ]. Ce dernier mot ayant été omis dans la traduction que Daudin ( dans
son Histoire des reptiles ) a faite du passage que nous avons cité, la description'du
schokari telle que l’a donnée ce naturaliste pourroit faire regarder cette espèce
et la Couleuvre oreillard comme identiques. La phrase de Forskael, est, au contraire,
très-claire, et dit positivement qu’il existe de chaque côté chez la Couleuvre
schokari deux bandes longitudinales très-distinctes : l’une supérieure, semblable à
celle que nous avons décrite chez l’oreillard; l’autre inférieure, très-distincte,
puisqu’elle est tout entière d’un blanc de neige [ altera tota nivea ]. Celle-ci manque
complètement dans notre espèce. L e nombre des plaques est aussi plus considérable
chez le schokari que chez l’oreillard : Forskael a trouvé chez un individu
cent quatre-vingt-trois bandes abdominales et cent quarante-quatre caudales, et
chez un autre cent quatre vingts abdominales seulement et cent quatorze caudales; I
mais, ajoute-t-il, la queue de ce dernier avoit sans doute été mutilée.
La Couleuvre à bouquets se rapproche à quelques égards du dhara de Forskael, I
du ColuberpetholadeLinné et de la Couleuvre audacieuse de Daudin : mais le dhara
a deux cent trente-cinq bandes abdominales et seulement quarante-huit caudales;
ce qui ne permet pas de le confondre avec la Couleuvre à. bouquets. La péthole,
au contraire, a presque le même nombre de plaques transversales; mais elle se
distingue très-nettement par ses couleurs. Enfin la Couleuvre audacieuse, voisine de
la Couleuvre à bouquets par le nombre de ses plaques, par ses proportions et sî
taille, et même par l’ensemble de son système de coloration, nous semble également
s’éloigner de celle-ci à plusieurs égards. En effet, si la figure de Daudin est
exacte, le Coluber audax n’a pas les bandes du dessous du corps blanches avec une
tache noire à leur extrémité ; et ses taches transversales ont aussi une disposition
un peu différente.
Le dhara, que nous venons de comparer à la Couleuvre à bouquets, se rapproche
aussi un peu à d’autres égards de la Couleuvre à raies parallèles; mais il n’a
point de tâches, selon la description de Forskael [color superni cupreo-cinerescens,
immaculatus ).
L e Coluber tyria de Linné est indiqué dans le Systema natura de la manière suivante
: Albidus, macularum rltombearum fuscarum ordine triplici longitudinali ; scutis 210,
scutellis 8y. Tous ces caractères, à l’exception de ce dernier, assez peu important,
conviennent parfaitement à la Couleuvre aux raies parallèles ; et si nous avons
conservé ce dernier nom, c’est uniquement parce qu’une indication aussi courte
et aussi incomplète que celle donnée par Linné ne peut servir de base à une détermination
exacte, et que nous croyons devoir laisser dans le doute ce point obscur
de la science, tant que nous n’aurons pas de matériaux assez nombreux pour qu’il
nous soit possible d’émettre une opinion sans nous exposer à remplacer un doute
par une erreur.
La Couleuvre à raies parallèles a également de très-grands rapports avec le Coluber
guttatus, espèce établie avec doute par Forskael, et que M. de Lacépède a
rapportée à la Couleuvre tyrie.
La Couleuvre maillée a quelques rapports avec le Coluber domesticus, L i n . ; mais
cette espèce, qui habite la Barbarie, a deux cent quarante-cinq bandes abdominales.
Enfin la Couleuvre à capuchon, voisine à différens égards du Coluber latonia
de Daudin et du Coluber scaber de Linné, se distinguera facilement de l’un et de
l’autre par son système de coloration et par le nombre de ses plaques.
Quant à la Couleuvre du Kaire, Coluber Cahirinus de Gmelin, il nous suffira
de dire qu elle n est autre que le Coluber guttatus de Forskael.
Il suit des détails dans lesquels nous venons d’entrer, 1 ° que l’espèce figurée dans
I Atlas sous le nom de Couleuvre à raies parallèles a les plus grands rapports avec
le Coluber yria, et qu’elle devra sans doute lui être rapportée ; 2." que les autres
especes dont nous venons de donner la description paroissent différer de toutes
celles qui sont connues jusqua ce jour, et devoir être admises par les naturalistes.
Nous proposerons pour elles les noms de Coluber ouritus, Coluberflorulentus,
Coluber insignitus et Coluber cucullatus, qui sont analogues à ceux de Couleuvre oreillard,
Couleuvre à bouquets, Couleuvre maillée (1) et Couleuvre à capuchon, sous lesquels
elles ont été figurées dans l’Atlas.
§- XI.
L E S C Y T H A L E D E S P Y R A M ID E S (2)
( R e p t il e s , planche 8 , fig . 1 9 .
L e genre Scythale, assez anciennement proposé par M. Latreille, a été adopté
par la plupart des herpétologistes, et nommément par Daudin et par MM. Dumérii,
Cuvier et Merrem : mais le plus ancien de ces auteurs, Daudin, le seul qui se soit
occupé avec quelque détail des espèces de ce groupe, n’avoit pas apporté' à ce
travail très-difficile cet esprit de doute et de critique éclairé si utile au naturaliste
observateur, et si indispensable au compilateur; et l’histoire des Scythales est encore
a faire, M. Cuvier a montré que sur les cinq espèces décrites dans l'Histoire des
(1) Cette espèce a reçu le nom de maillé', parce que les taches noires qui ornent son dos ont été comparées aux
mailles des jeunes perdrix.
(1 ) Figuré dans l’Atlas sous le noiti de Vipère des pyramidès.