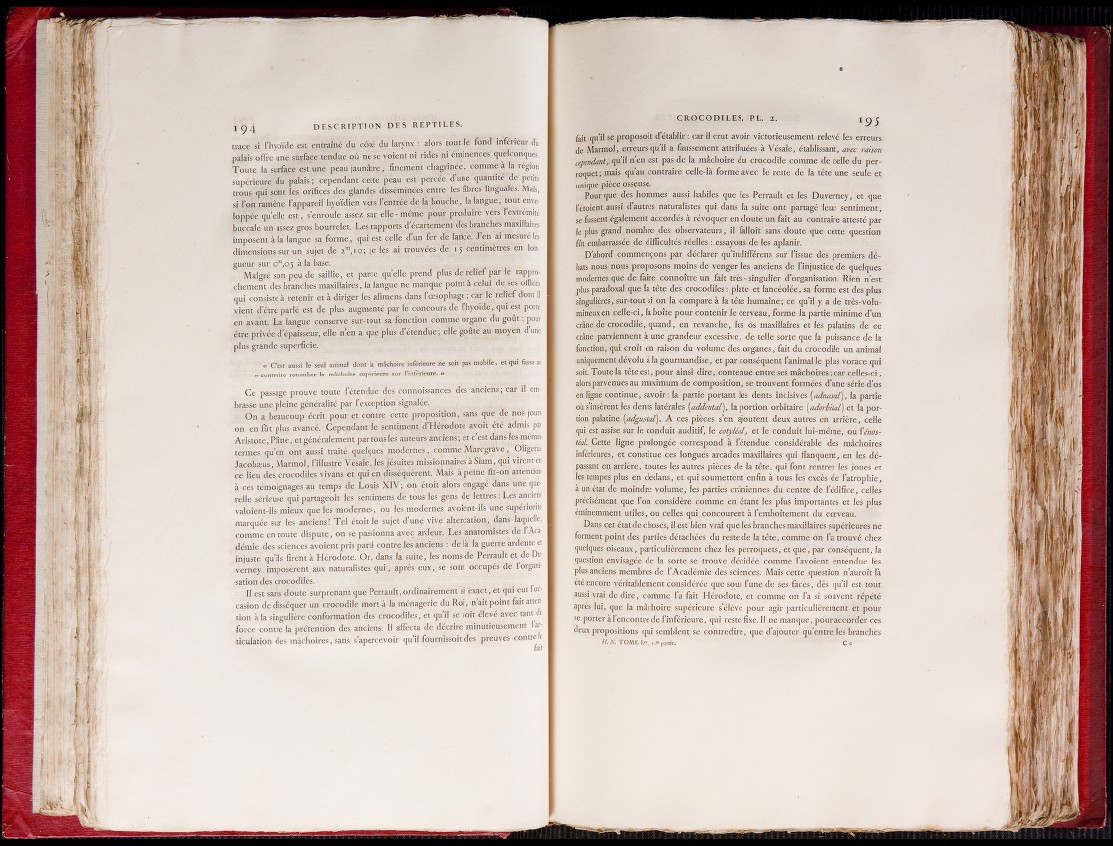
d e s c r i p t i o n d e s r e p t i l e s .
trace si l’hyoïde est entraîné du côté du larynx : alors tout le fond inférieur du
palais offre une stirface tendue où ne se voient ni rides ni éminences quelconques.
Toute la surface est une peau jaunâtre,. finement chagrinée, comme à la région
supérieure du palais ; cependant cette peau est percée d une quantité de petits
trous qui sont les orifices des glandes disséminées entre les fibres linguales. Mais,
si l’on ramène l’appareil hyoïdien vers l’entrée de la bouche, la langue, tout enveloppée
qu’elle e st, s’enroule assez sur elle - même pour produire vers 1 extrémité
buccale un assez gros bourrelet. Les rapports d ecartement des branchés maxillaires
imposent à la langue sa forme, qui est celle d un fer de lance. J en ai mesuré les
dimensions sur un sujet de zm, 10; je les ai trouvées de i j centimètres en longueur
sur om,oy à la base.
Malgré son peu de saillie, et parce qu’elle prend plus de relief par le rapprochement
des branches maxillaires, la langue ne manque point à celui de ses offices
qui consiste à retenir et à diriger les alimens dans l’oesophage ; car le relief dont il
vient d’être parlé est de plus augmenté par le concours de l’hyoïde, qui est porté
en avant. La langue conserve sur-tout sa fonction comme organe du g o u t. pour
être privée d’épaisseur, elle n’en a que plus d’étendue; elle goûte au moyen dune
plus grande superficie.
« C ’est aussi le seul animal dont la mâchoire inférieure ne soit pas mob ile, et qui fasse au
» contraire retomber la mâchoire supérieure sur l’inférieure. »
Ce passage prouve toute l’étendue des connoissances des anciens; car il embrasse
une pleine généralité par l’exception signalée.
On a beaucoup écrit pour et contre cette proposition, sans que de nos jours
on en fût plus avancé. Cependant le sentiment d’Hérodote avoir été admis par
Aristote, Pline, et généralement par tous les auteurs anciens ; et c’est dans les mêmes
termes qu’en ont aussi traité quelques modernes, comme Marcgrave, Oligerus
Jacobæus, Marmol, l’illustre Vésale, les jésuites missionnaires à Siam, qui virent en
ce lieu des crocodiles vivans et qui en disséquèrent. Mais à peine fit-on attentiojn
à ces témoignages au temps de Louis X IV ; on étoit alors engagé dans une querelle
sérieuse qui partageoit les sentimens de tous les gens de lettres : Les anciens
valoient-ils mieux que les modernes, ou les modernes avoient-ils une supériorité
marquée sur les anciens! T e l étoit le sujet d’une vive altercation, dans laquelle,
comme en toute dispute, on se passionna avec ardeur. Les anatomistes de 1 Académie
des sciences avoient pris parti contre les anciens : de là la guerre ardente et
injuste qu’ils firent à Hérodote. O r, dans la suite, les noms de Perrault et de Du-
verney imposèrent aux naturalistes qui, après eux, se sont occupés de 1 organisation
des crocodiles. jj
Il est sans doute surprenant que Perrault, ordinairement si exact, et qui eut 1 occasion
de disséquer un crocodile mort à la ménagerie du Roi, n’ait point fait attention
à la singulière conformation des crocodiles, et qu’il se soit élevé avec tant de
force contre la prétention des anciens. Il affecta de décrire minutieusement I ar
ticulation des mâchoires, sans s’apercevoir qu’il fournissoit des preuves contre le
fait
C R O C O D I L E S . PL. 2. j p j
fait qu’il se proposoit d’établir : car il crut avoir victorieusement relevé les erreurs
de Marmol, erreurs qu’il a faussement attribuées à Vésale, établissant, a v e c ra ison
cependant, qu’il n’en est pas de la mâchoire du crocodile comme de celle du perroquet;
mais qu’au contraire celle-là forme avec le reste de la tête une seule et
unique pièce osseuse.
Pour que des hommes aussi habiles que les Perrault et les Duverney, et que
l’étoient aussi d’autres naturalistes qui dans la suite ont partagé leur sentiment,
se fussent également accordés à révoquer en doute un fait au contraire attesté par
le plus grand nombre des observateurs, il falloit sans doute que cette question
fût embarrassée de difficultés réelles : essayons de les aplanir.
D’abord commençons par déclarer qu’indifférens sur l’issue des premiers débats
nous nous proposons moins de venger les anciens de l’injustice de quelques
modernes que de faire connoître un fait très - singulier d’organisation. Rien n’est
plus paradoxal que la tête des crocodiles : plate et lancéolée, sa forme est des plus
singulières, sur-tout si on la compare à la tête humaine ; ce qu’il y a de très-volumineux
en celle-ci, la boîte pour contenir le cerveau, forme la partie minime d’un
crâne de crocodile, quand, en revanche, les os maxillaires et les palatins de ce
crâne parviennent à une grandeur excessive, de telle sorte que la puissance de la
fonction, qui croît en raison du volume des organes, fait du crocodile un animal
uniquement dévolu à la gourmandise, et par conséquent l’animal le plus vorace qui
soit. Toute la tête est, pour ainsi dire, contenue entre ses mâchoires ; car celles-ci,
alors parvenues au maximum de composition, s'e trouvent formées d’une série d’os
en ligne continue, savoir: la partie portant les dents incisives (adnasal), la partie
où s’insèrent les dents latérales (addental), la portion orbitaire (adorbital) et la portion
palatine [adgustal). A ces pièces s’en ajoutent deux autres en arrière, celle
qui est assise sur le conduit auditif, le cotyléal, et le conduit lui-même, ou l’énos-
téal. Cette ligne prolongée correspond à l’étendue considérable des mâchoires
inférieures, et constitue ces longues arcades maxillaires qui flanquent, en les dépassant
en arrière, toutes les autres pièces de la tête, qui font rentrer les joues et
les tempes plus en dedans, et qui soumettent enfin à tous les excès de l’atrophie,
à un état de moindre volume, les parties crâniennes du centre de l’édifice, celles
précisément que l’on considère comme en étant les plus importantes et les plus
éminemment utiles, ou celles qui concourent à l’emboîtement du cerveau.
Dans cet état de choses, il est bien vrai que les branches maxillaires supérieures ne
forment point des parties détachées du reste de la tête, comme on l’a trouvé chez
quelques oiseaux, particulièrement chez les perroquets, et que, par conséquent, la
question envisagée de la sorte se trouve décidée comme l’avoient entendue les
plus anciens membres de l’Académie des sciences. Mais cette question n’auroit là
ete encore véritablement considérée que sous l’une de ses faces, dès qu’il est tout
aussi vrai de dire, comme l’a fait Hérodote, et comme on l’a si souvent répété
après lui, que la mâchoire supérieure s’élève pour agir particulièrement et pour
se porter al encontre de l’inférieure, qui reste fixe. Il ne manque, pour accorder ces
deux propositions qui semblent se contredire, que d’ajouter qu’entre les branches
H. N. TOME I.», i.” partie. C c