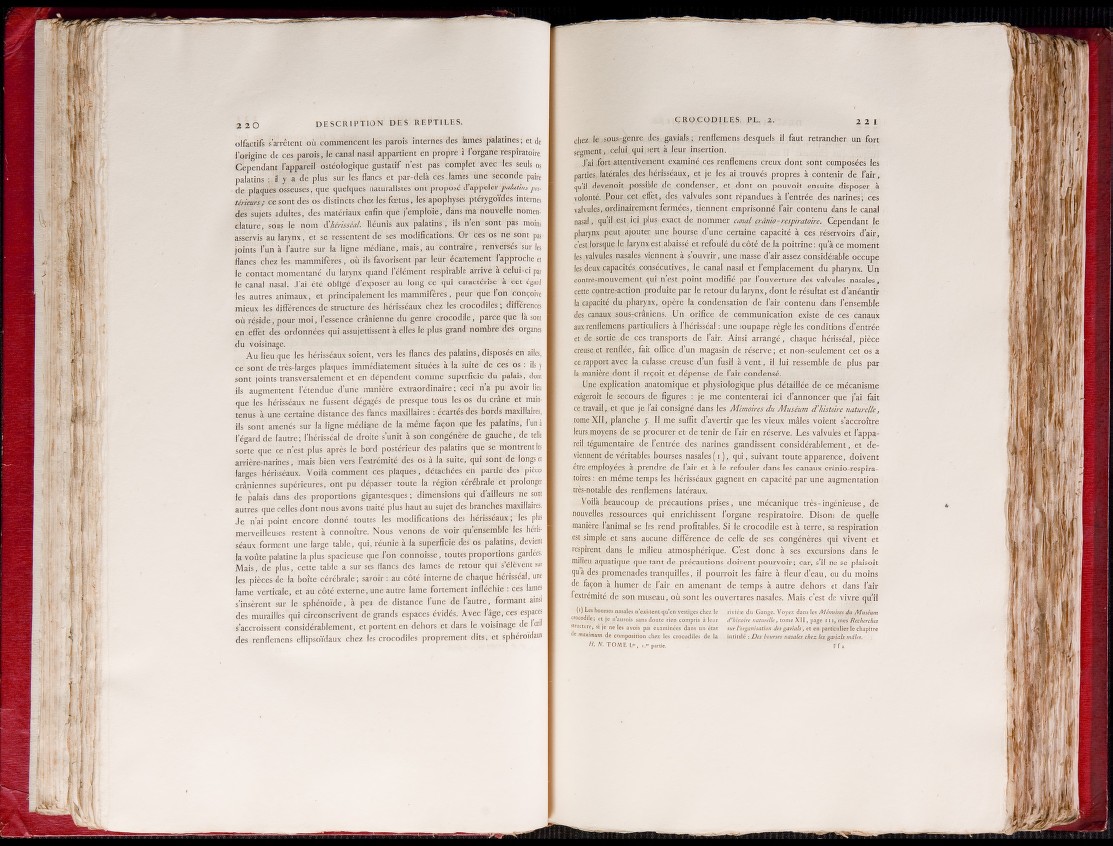
olfactifs s’arrêtent où commencent les parois internes des lames palatines ; et de
l’origine de ces parois, le canal nasal appartient en propre à 1 organe respiratoire.
Cependant l’appareil ostéologique gustatif n’est pas complet avec les seuls os
palatins : il y a de plus sur les flancs et par-delà ces.lames une seconde paire
de plaques osseuses, que quelques naturalistes ont proposé d’appeler palatins post
é r i e u r s ; ce sont des os distincts chez les foetus, les apophyses ptérygoides internes
des sujets adultes, des matériaux enfin que j’emploie, dans ma nouvelle nomenclature,
sous le nom d’hérisséal- Réunis aux palatins , ils n en sont pas moins
asservis au larynx, et se ressentent de ses modifications. O r ces os ne sont pas
joints l’un à l’autre sur la ligne médiane, mais, au contraire, renversés sur les
flancs chez les mammifères, où ils favorisent par leur ecartement 1 approche et
le contact momentané du larynx quand 1 element respirable arrive a celui-ci par
le canal nasal. J’ai été obligé d exposer au long ce qui caractérisé a cet égard
les autres animaux, et principalement les mammifères, pour que 1 on conçoive
mieux les différences de structure des herisseaux chez les crocodiles, différences
où réside, pour moi, l’essence crânienne du genre crocodile, parce que là sont
en effet des ordonnées qui assujettissent à elles le plus grand nombre des organes
du voisinage.
A u lieu que les hérisséaux soient, vers les flancs des palatins, disposes en ailes,
ce sont de très-larges plaques immédiatement situées à la suite de ces os : ils y
sont joints transversalement et en dépendent comme superficie du palais, dont
ils augmentent l'étendue d’une manière extraordinaire; ceci n’a pu avoir lieu
que les hérisséaux ne fussent dégagés de presque tous les os du crâne et maintenus
à une certaine distance des flancs maxillaires : écartés des bords maxillaires,
ils sont amenés sur la ligne médiane de la même façon que les palatins, 1 un à
l’égard de l’autre; l’hérisséal de droite s’unit à son congénère de gauche, de telle
sorte que ce n’est plus après le bord postérieur des palatins que se montrent les
arrière-narines, mais bien vers l’extrémité des os a la suite, qui sont de longs et
larges hérisséaux. Voilà comment ces plaques, détachées en partie des pièces
crâniennes supérieures, ont pu dépasser toute la région cerebrale et prolonger
le palais dans des proportions gigantesques; dimensions qui d ailleurs ne sont
autres que celles dont nous avons traité plus haut au sujet des branches maxillaires.
Je n’ai point encore donné toutes les modifications des herisseaux, les plus
merveilleuses restent à connoître. Nous venons de voir qu ensemble les heris
séaux forment une large table, qui, réunie à la superficie des os palatins, devient
la voûte palatine la plus spacieuse que l’on connoisse, toutes proportions gardées.
Mais, de plus, cette table a sur ses flancs des lames de retour qui s’élèvent sur
les pièces de la boîte cérébrale ; savoir : au côté interne de chaque hérisséal, une
lame verticale, et au côté externe, une autre lame fortement infléchie : ces lames
s’insèrent sur le sphénoïde, à peu de distance lune de Iautre, formant ainsi
des murailles qui circonscrivent de grands espaces évidés. A ve c l’âge, ces espaces
s’accroissent considérablement, et portent en dehors et dans le voisinage de loeil
des renflemens ellipsoïdaux chez les crocodiles proprement dits, et sphéroidaux
chez le sous-genre des gavials ; renflemens desquels il faut retrancher un fort
segment, celui qui sert à leur insertion.
J’ai fort attentivement examiné ces renflemens creux dont sont composées les
parties, latérales des hérisséaux, et je les ai trouvés propres à contenir de l’air,
qu’il devenoit possible de condenser, et dont on pouvoit ensuite disposer à
volonté. Pour cet effet, des valvules sont répandues à l’entrée des narines; ces
valvules, ordinairement fermées, tiennent emprisonné l’air contenu dans le canal
nasal , quil est ici plus exact de nommer canal crânio-respiratoire. Cependant le
pharynx peut ajouter une bourse d’une certaine capacité à ces réservoirs d’air,
c’est lorsque je larynx est abaissé et refoulé du côté de la poitrine: qu’à ce moment
les valvules nasales viennent à s’ouvrir, une masse d’air assez considérable occupe
les deux capacités, consécutives, le canal nasal et l’emplacement du pharynx. Un
contre-mouvement qui n’est point modifié par l’ouverture des valvules nasales,
cette coptreraction produite par le retour du larynx, dont le résultat est d’anéantir
la capacité du pharynx, opère la condensation de l’air contenu dans l’ensemble
des canaux sous-crâniens. Un orifice de communication existe de ces canaux
aux renflemens particuliers à l’hérisséal : une soupape règle les conditions d’entrée
et de sortie de ces transports de l’air. Ainsi arrangé, chaque hérisséal, pièce
creusç.et renflée, fait office d’un magasin de réserve; et non-seulement cet os a
ce rapport avec la culasse creuse d’un fusil à ven t, il lui ressemble de plus par
la manière dont il reçoit et dépense de l’air condensé.
Une explication anatomique et physiologique plus détaillée de ce mécanisme
exigeroit le secours de figures : je me contenterai ici d’annoncer que j’ai fait
ce travail, et que je l’ai consigné dans les Mémoires du Muséum d ’histoire naturelle,
tome XII, planche y. Il me suffit d’avertir que les vieux mâles voient s’accroître
leurs moyens de se procurer et de tenir de l’air en réserve. Les valvules et l’appareil
tégumentaire de l’entrée des narines grandissent considérablement, et deviennent
de véritables bourses nasales(i), qui, suivant toute apparence, doivent
etre employées à .prendre de l’air et à le refouler dans les canaux crânio-respira-
toires : en même temps les hérisséaux gagnent en capacité par une augmentation
très-notable des renflemens latéraux.
Voilà beaucoup de précautions prises, une mécanique très-ingénieuse, de
nouvelles ressources qui enrichissent l’organe respiratoire. Disons de quelle
manière l’animal se les rend profitables. Si le crocodile est à terre, sa respiration
est simple et sans aucune différence de celle de ses congénères qui vivent et
respirent dans le milieu atmosphérique. C ’est donc à ses excursions dans le
milieu aquatique que tant de.précautions doivent pourvoir; car, s’il ne se plaisoit
qua des promenades tranquilles, il pourroit les faire à fleur d’eau, ou du moins
de façon à humer de l’air en amenant de temps à autre dehors et dans l’air
Iextrémité de son museau, où sont les ouvertures nasales. Mais c’est de vivre qu’il
(i) Les bourses nasales n’existent qu’en vestiges chez le rivière du Gange. Voyez dans les Mémoires du Muséum
crocodile; et je n’aurois sans doute rien compris à.leur d'histoire naturelle, tome X I I , page 1 1 1 , mes Recherches
J ructure, si je ne les avois pas examinées dans un état sur l ’organisation des gavials, et en particulier le chapitre
e ma*hnum. de composition chez les crocodiles de la intitulé : Des bourses nasales chez les gavials mâles.
H,N. TOME I.«, partie. " * F fa