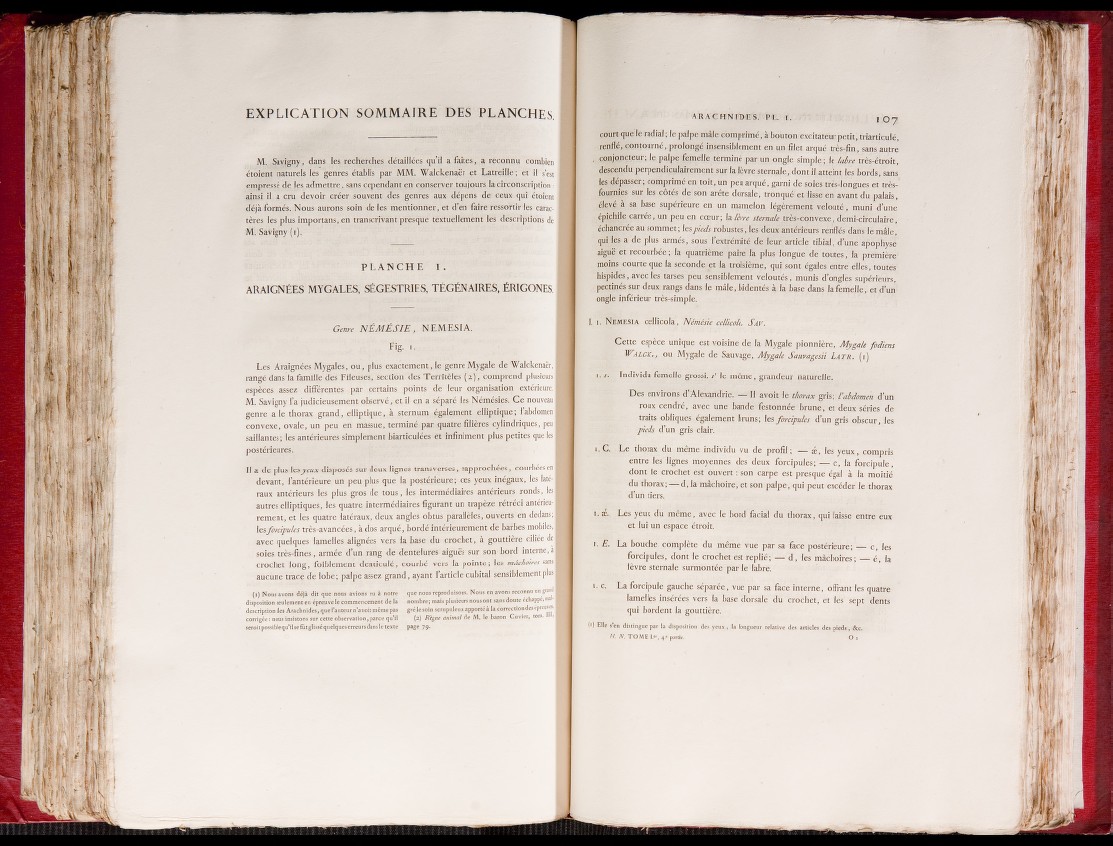
M . S a v ign y , dans les re ch e rch es détaillées qu’il a fa ite s , a re con n u combien
é to ien t naturels les gen res établis pa r M M . W a lck en a ë r e t L a tre ille ; et il s’est
empressé d e les a dm e ttr e , sans c ep en dan t en con se rv e r toujours la circonscription :
ainsi il a cru d e v o ir c ré e r so u v en t des genres aux dép ens d e ceux qui étoient
déjà formé s. N o u s aurons soin de les m en t io n n e r , et d ’en faire ressortir les caractères
les plus im p o rtans , en transcrivant presque textu e llem en t les descriptions de
M . S av igny (i).
P L A N C H E I .
A R A IG N É E S M Y G A L E S , S É G E S T R IE S , T É G É N A IR E S , É R IG O N E S .
Genre N É M É S I E , N E M E S I A .
F ig . g
L e s A ra ign é e s M y g a le s , o u , plus e x a c tem e n t , le g en re M y g a le d e W a lc k en a ë r,
rangé dans la famille des F ileu se s , se c tio n des T e r r itè le s (a) , com p ren d plusieurs
e spèces assez différentes par certains points de leur org anisa tion extérieure.
M . Sav igny l’a ju d ic ieu sem en t o b s e rv é , e t il en a séparé les Némesies. C e nouveau
g en re a le thorax g ra n d , e llip tiq u e , à sternum é g a lem en t e llip tiq u e ; l ’abdomen
c o n v e x e , o v a le , un p eu en massue, te rm in é pa r quatre filières cylindriques, peu
saillantes; les antérieures sim p lem en t biarticulées e t in fin im en t plus petites que les
pos térieures.
Il a d e plus les yeu x disposés sur d eu x lignes transverses, ra p p ro ch é e s , courbées en|
d ev an t, l’antérieure un p eu plus qu e la p o s té r ieu re ; ces yeux inégaux, les latéraux
antérieurs les plus gros d e to u s , les in termédiaires antérieurs ronds, les
autres e llip tiqu e s , les quatre in termédiaires figuran t un trapeze ré tré c i antérieurem
en t , e t les quatre latéraux, d eux angles obtus parallèles, ou v e r ts en dedans;
lesforcipules trè s -a v an c é e s , à d o s a rq u é , b o rd é in té r ieu rem en t d e barbes mobiles,
a v e c quelques lamelles a lignées vers la base du c r o c h e t , à g o u ttiè re ciliée de
soies trè s-fine s, a rmée d’un rang de d entelures aiguës sur son bord interne,a
c ro ch e t lo n g , fo ib lem en t d e n t ic u lé , co u rb é vers la p o in t e ; les mâchoires sans
aucu n e tra ce d e lo b e ; p a lp e assez g ra n d , ayant l’a r tic le cubital sensiblement plus
que nous reproduisons. Nous en avons reconnu un grand
nombre; mais plusieurs nous ont sans doute échappé, malgré
(i) Nous avons déjà dit que nous avions eu à notre
disposition seulement en épreuve le commencement de la
description des Arachnides, que l’auteur n’a voit même pas
corrigée: nous insistons sur cette observation, parce qu’il
seroitpossiblequ’ilse futglissé quelques erreurs dansle texte
le soin scrupuleux apporté à la corr.ectipn des épreuves-
(2) Règne animal de M. le baron Cuvier, tom. M»
page 79.
court que le radial ; le pa lpe mâle c om p r im é , à bouton exc ita teur p e tit, triarticulé,
renflé, co n to u rn é , p ro lo n g é insensiblement en un filet arqué très-fin, sans autre
. con jon cteur ; le pa lp e fem elle te rminé par un on g le s im p le ; le labre très-étroit,
descendu p e rp en d icu la irem en t sur la lè v re sternale, d on t il a tte int les b o rd s , sans
les dépasser, com p r im e en to it , un p eu a rqué, garni de soies très-longues et très-
fournies sur les cotes de son arete dorsale, tron qué e t lisse en a vant du p a la is ,
élevé à sa base supérieure en un m am elon lé g è rem en t v e lo u t é , m un i d ’une
épichile c a r r é e , un p eu en coe u r ; la lèvre sternale t r è s - c o n v e x e , d em i-c ircu la ire ,
échancree au som m e t; les pieds robustes, les deux antérieurs renflés dans le m â le ,
qui les a d e plus a rmés, sous l ’extrémité d e leu r a rtic le tib ia l, d’une apophyse
aiguë e t re co u rb e e ; la quatrième paire la plus lon gu e de to u te s , la première
moins cou r te que la se con d e et la tro isièm e , qui son t égales entre e lle s, toutes
hispides, a v e c les tarses p eu sensiblement v e lo u té s , munis d ’ongle s supérieurs,
pectinés sur deux rangs dans le m âle , bidentés à la base dans la fem e lle , e t d ’un
ôngle in fé r ieu r très-simple.
1. 1. N e m e s i a c e llic o la , Némésie cellicole. S Av.
C e t t e e sp è ce uniqu e est vo is in e d e la M y g a le p io n n iè r e , Mygale fodiens
Wal ck . , ou M yg a le d e Sauvage, Mygale Sanvagesii L a t r . ( i)
1 . 1. Ind iv idu fem e lle grossi. 1' le m êm e , grandeu r naturelle.
D e s en virons d ’A le x an d r ie . — Il a v o it le thorax g r is ; l ’abdomen d’un
ro u x c e n d r é , a v e c u n e bande fe s ton n é e b ru n e , e t deux séries de
traits obliques ég a lement bruns; les forcipules d’un gris o b s cu r , les
pieds d ’un gris clair.
1. C . L e thorax d u même in d iv id u vu d e p r o f i l; — æ , les y e u x , com pris
entre les lignes m o y en n e s des deux fo r c ip u le s ; L - c , la fo r c ip u le ,
d o n t le c ro ch e t est o u v e r t : son ca rpe est p resqu e égal à la m o itié
du th orax; — d , la m â ch o ire , et son p a lp e , qui p eu t exc éd e r le thorax
d’un tiers.
1. æ. L e s yeux du m êm e , a v e c le b o rd facial du th o ra x , qui laisse entre eux
e t lui un espace étroit.
1. E . L a bou che , com p lè te du m êm e v u e par sa fa ce p o s té r ieu re ; — c , les
fo r c ip u le s , d o n t le c ro ch e t est r e p lié ; — d , les m â c h o i r e s ; é , la
lè v re sternale su rm on té e par le labre.
1. c. L a fo r c ip u le g auche s é p a ré e , vue par sa fa c e in te rn e , offrant les quatre
lamelles insérées vers la base dorsale du c ro ch e t , et les sep t dents
qui b o rd en t la gouttière.
(>) Elle s’en distingue par la disposition des yeux, la longueur relative des articles des pieds, &c.
H- N. TOME I.er, 4.« partie. O z