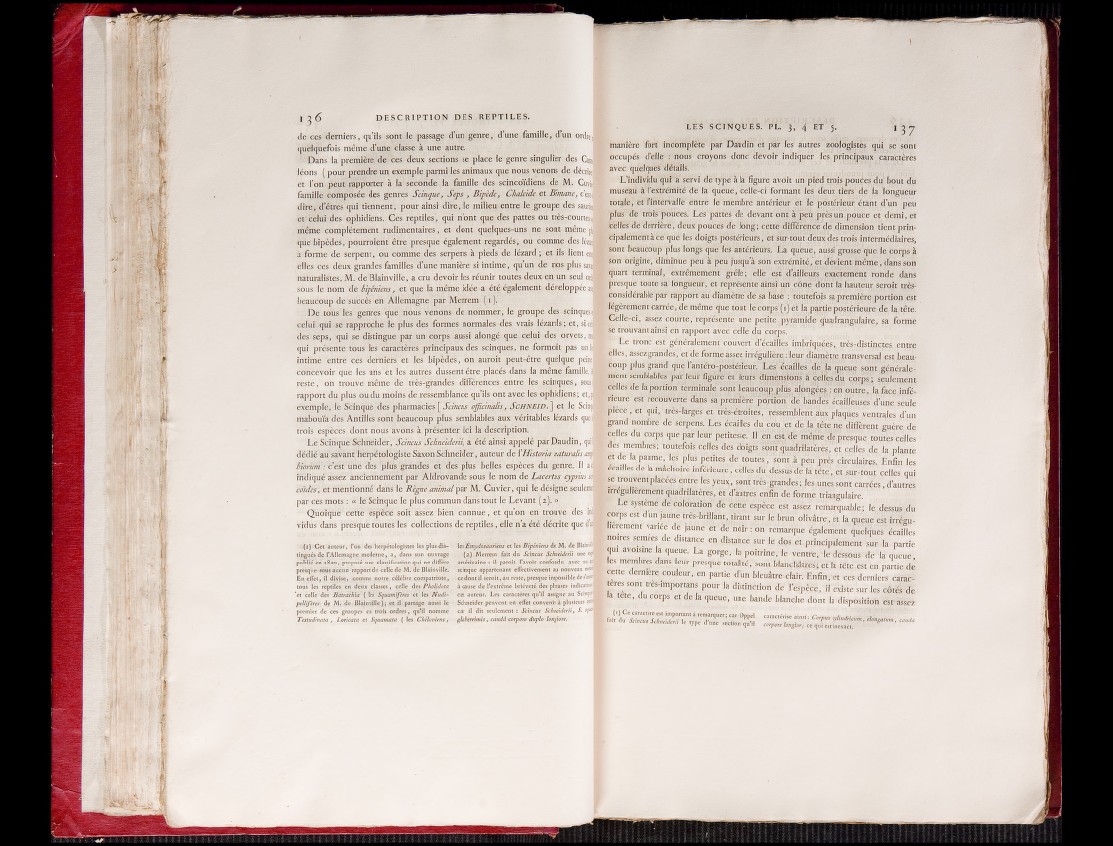
de ces derniers, qu’ils sont le passage d’un genre, d’une famille, dun ordre*
quelquefois même d’une classe à une autre.
Dans la première de ces deux sections se place le genre singulier des C a J
léons ( pour prendre un exemple parmi les animaux que nous venons de décrite*
et l’on peut rapporter à la seconde la famille des scincoïdiens de M. Cuvietl
famille composée des genres Scinque, Seps , Bipède, Chalcide et Bimane, c’est*
dire, d’êtres qui tiennent, pour ainsi dire, le milieu entre le groupe des sauriel
et celui des ophidiens. Ces reptiles, qui n’ont que des pattes ou très-courtes M
même complètement rudimentaires, et dont quelques-uns ne sont même p|l
que bipèdes, pourroient être presque également regardés, ou comme des lczal
à forme de serpent, ou comme des serpens à pieds de lézard ; et ils lient ea*
elles ces deux grandes familles d’une manière si intime, qu’un de nos plus savil
naturalistes, M. de Blainville, a cru devoir les réunir toutes deux en un seul ordfl
sous le nom de bipéniens, et que la même idée a été également développée a il
beaucoup de succès en Allemagne par Merrem ( i ).
De tous les genres que nous venons de nommer, le groupe des scinques I
celui qui se rapproche le plus des formes normales des vrais lézards; et, s ic tl
des seps, qui se distingue par un corps aussi alongé que celui des orvets, m*
qui présente tous les caractères principaux des scinques, ne formoit pas unlil
intime entre ces derniers et les bipèdes, on auroit peut-être quelque peine!
concevoir que les uns et les autres dussent être placés dans la même famille, i l
reste, on trouve même de très-grandes différences entre les scinques, sousl
rapport du plus ou du moins de ressemblance qu’ils ont avec les ophidiens; e t , !
exemple, le Scinque des pharmacies [ Scincus officinalis, S c h n e i d . ] et le Scinfl
mabouïa des Antilles sont beaucoup plus semblables aux véritables lézards quel*
trois espèces dont nous avons à présenter ici la description.
L e Scinque Schneider, Scincus Schneiderii, a été ainsi appelé parDaudin, qui
dédié au savant herpétologiste Saxon Schneider, auteur de l’Historia naturalis ¡mm
bionim : c’est une des plus grandes et des plus belles espèces du genre. Il a H
indiqué assez anciennement par Aldrovande sous le nom de Lacertus cyprins sÆ
co'ides, et mentionné dans le Règne animal par M. Cuvier, qui le désigne seulemf*
par ces mots : « le Scinque le plus commun dans tout le Levant (2). 33
Quoique cette espèce soit assez bien connue, et qu’on en trouve des in<*
vidus dans presque toutes les collections de reptiles, elle n’a été décrite que d'i*
(1) Cet auteur, l’un des herpétologistes les plus dis- les Èmydosaurïens et les Bipéniens de M. de BlainvilH
tingués de l’Allemagne moderne, a, dans son ouvrage (2) Merrem fait du Scincus Schneiderii une
publié en 1820, proposé une classification qui ne diffère américaine : il paroît l’avoir confondu avec un
presque sous aucun rapport de celle de M. de Blainville. scinque appartenant effectivement au nouveau monra
En effet, il divise, .comme notre célèbre compatriote, ce dont il seroit, au reste, presque impossible desassfL .
tous les reptiles en deux classes, celle des Pholidota à cause de l’extrême brièveté des phrases indicatives^
‘ et celle des Batraclna ( les Squamifères et les JVudi- cet auteur. Les caractères qu’ il assigne au Scinque1.
pellifères de M . de Blainville); et il partage aussi le Schneider peuvent en effet convenir à plusieurs aufit..
premier de ces groupes en trois ordres, qu’il nomme car il dit seulement : Scincus Schneiderii, S.
Testudinata , Loricata et Squamata ( les Chéloniens, glaberrimis, caudâ corpore duplo longiore.
manière fort incomplète par Daudin et par les autres zoologistes qui se sont
occupés d’elle : nous croyons donc devoir indiquer les principaux caractères
avec quelques détails.
L ’individu qui a servi de type à la figure avoit un pied trois pouces du bout du
museau à l’extrémité de la queue, celle-ci formant les deux tiers de la longueur
totale, et l’intervalle entre le membre antérieur et le postérieur étant d’un peu
plus de trois pouces. Les pattes de devant ont à peu près un pouce et demi, et
celles de derrière, deux pouces de long; cette différence de dimension tient principalement
à ce que les doigts postérieurs, et sur-tout deux des trois intermédiaires,
sont beaucoup plus longs que les antérieurs. La queue, aussi grosse que le corps à
Son origine, diminue peu à peu jusqu’à son extrémité, et devient même, dans son
quart terminal, extrêmement grêle; elle est d’ailleurs exactement ronde dans
presque toute sa longueur, et représente ainsi un cône dont la hauteur seroit très-
considérable par rapport au diamètre de sa base : toutefois sa première portion est
légèrement carrée, de même que tout le corps (i) et la partie postérieure de la tête.
Celle-ci, assez courte, représente une petite pyramide quadrangulaire, sa forme
se trouvant ainsi en rapport avec celle du corps.
Le tronc est généralement couvert d’écailles imbriquées, très-distinctes entre
elles, assez grandes, et de forme assez irrégulière,: leur diamètre .transversal est beaucoup
plus grand que l’antéro-postérieur. Les écailles de la queue sont généralement
semblables par leur figure et leurs dimensions à celles du corps; seulement
celles de la portion terminale sont beaucoup plus alongées ; en outre, la face inférieure
est recouverte dans sa première portion de bande? écailleuses d’une seule
pièce , et qui, très-larges et très-étroites, ressemblent aux plaques ventrales d’un
grand nombre de serpens. Les écailles du cou et de, la tête ne diffèrent guère de
celles du corps que par leur petitesse. Il en est dé même de presque toutes celles
des membres; toutefois celles des doigts sont quadrilatères, et celles de la plante
et de la paume, les plus petites de toutes.^sont à peu près circulaires. Enfin les
écailles de la mâchoire inférieure, celles du dessus de la tête', et sur-tout celles qui
se trouvent placées entre les yeux, sont très-grandes ; les unes sont carrées, d’autres
irrégulièrement quadrilatères, et d’autres enfin de forme triangulaire.
Le système de coloration de cette espèce est assez remarquable; le dessus du
corps est d’un jaune très-brillant, tirant sur le brun olivâtre, et la queue est irrégulièrement
variée de jaune et dé' noir : on remarque également quelques écailles
noires semees de distance en distance sur le dos et principalement sur la partie
qui avoisine la queue. La gorge, la poitrine, le ventre, le dëssôus de la queue,
les membres dans leur presque totalité, sont blanchâtres,; et la tête est en partie de
cette derniere couleur, en partie d’un bleuâtre clair. Enfin, et ces derniers caractères
sont tres-nnportans pour la distinction de l’espèce, il existe sur les côtés de
ia tete, du corps et de la queue, une bande blanche dont la disposition est assez