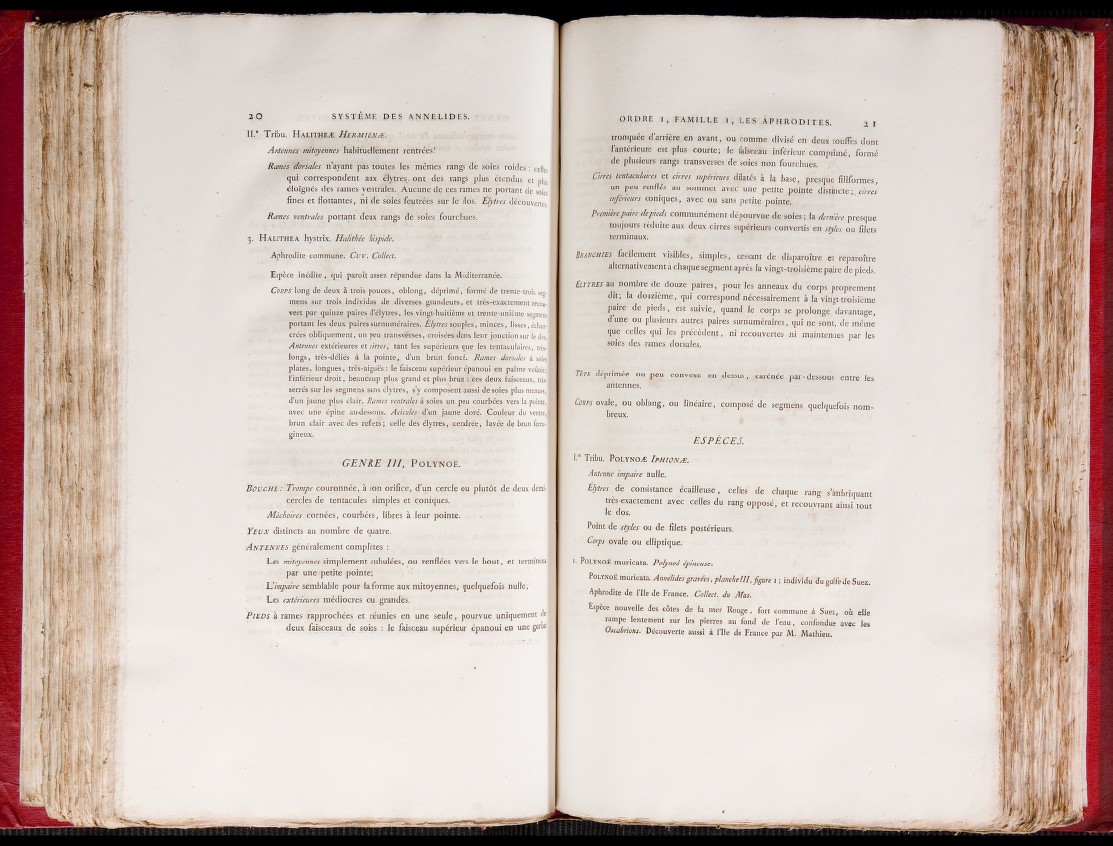
II.* Tribu. H a l i t h e æ H e r m io n æ .
Antennes mitoyennes habituellement rentrées'
Rames dorsales n’ayant pas toutes les mêmes rangs de soies roides : celles
qui correspondent aux élytres,. ont des rangs plus étendus et plus I
éloignés des rames ventrales. Aucune de ces rames ne portant de soies
fines et flottantes, ni de soies feutrées sur le dos. Élytres découvertes
Rames ventrales p o rtan t deux rangs dé soies fourchues.
3. H alithea hystrix. Halithée hispide.
A p h ro d ite commune. Cvv. Collect.
E sp èce in é d it e , qui paroît assez répandue dans la Méditerranée.
C o rp s lon g de deux à trois p o u c e s , o b lo n g , dépr imé , formé de trente-trois ses-|
mens sur trois individus de diverses grandeurs, et très-exactement recou-1
v e r t par quinze paires d’é ly t re s , les vingt-huitième et trente-unième segmensl
portant les deux paires surnuméraires. Élytres souple s , m in ce s , lisses, e'chan-l
crées o b liq u em en t, un peu transvërses, croisées dans leu r jonction sur le dos,I
Antennes extérieures e t cirres, tant les supérieurs que les tentaculaires, très-l
lo n g s , très-déliés à la p o in te , d’un brüri fon cé. Rames dorsales à soiesfl
p la te s , lo n gu e s , très-aiguè's: le faisceau supérieur épanoui en palme voûtée;!
l ’inférieur d ro it , beaucoup plus grand e t plus brun ;,ces deux faisceaux, très-l
serrés sur les segmens sans é ly tre s , s’y composent aussi de sp ie s plus menues,!
d’un jaune plus clair. Rames ventrales à soies un peu courbées vers la pointe,!
a v e c une épine au-dessous. Acicules d’un jaune doré. C o u leu r du ventre,!
brun clair avec des re fle ts ; celle des é ly t re s , c end ré e , la vé e de brun ferru-l
gineux .
G E N R E / / / r P o L Y N O È .
B o u c h e : Trompe couronnée, à son orifice, d’un cercle ou plutôt de deux demi-l
cercles de tentacules simples et coniques.
Mâchoires cornées, courbées, libres à leur pointe. .
Y e u x distincts au nombre de quatre.
A n t e n n e s généralement complètes :
Les mitoyennes simplement subulées, ou renflées vers le bout, et terminéesI
par une petite pointe;
G impaire semblable pour la forme aux mitoyennes, quelquefois nulle;
Les extérieures médiocres ou grandes.
P ie d s à rames rapprochées et réunies en une seule, pourvue uniquement deI
deux faisceaux de soies ; le faisceau supérieur épanoui en une gerbe I
tronquée d’arrière en avant, ou comme divisé en deux toüfies dont
l’antérieure est plus courte; le faisceau inférieur comprimé, formé
de plusieurs rangs transverses de soies non fourchues.
Çirrcs tentaculaires et cirres supérieurs dilatés à la base, presque filiformes,
un peu renflés au sommet avec une petite pointe distincte; cirres
inférieurs coniques, avec ou sans petite pointe.
Première paire de pieds communément dépourvue de soies ; la dernière presque
toujours réduite aux deux cirres supérieurs convertis en styles ou filets
terminaux.
Branchies facilement visibles, simples, cessant de disparoître et reparoître
alternativement à chaque segment après la vingt-troisième paire de pieds.
ÉLTTRES au nombre de douze paires, pour les anneaux du corps proprement
dit; la douzième, qui correspond nécessairement à la vingt-troisième
paire de pieds, est suivie, quand le corps se prolonge davantage,
dune ou plusieurs autres paires surnuméraires, qui ne sont, de même
que celles qui les précèdent, ni recouvertes ni maintenues par les
soies des rames dorsales.
Tè t e déprimée ou peu convexe en dessus, carénée par-dessous entre les
antennes.
Co r p s ovale, ou oblong, ou linéaire, composé de segmens quelquefois nombreux.
E S P È C E S .
I." T r ib u . P o l y n o æ I p h i q n æ .
Antenne impaire nulle.
Élytres de consistance écailleuse, celles de chaque rang s’imbriquant
très-exactement avec celles du rang opposé, et recouvrant ainsi tout
le dos.
Point de styles ou de filets postérieurs.
Corps ovale ou elliptique.
1. PoLYNOË muricata. Polynoê épineuse.
Polïnoë muricata. Annelides gravées, planche III, figure 1 ; individu du golfe de Suez.
Aphrodite de l’Ile de France. Collect. du Mus.
Espèce nouvelle des côtes de la mer Rouge, fort commune à Suez, où elle
rampe lentement sur les pierres au fond de i’eau, confondue avec les
Oscabrions. Découverte aussi à l’Ile de France par M. Mathieu.