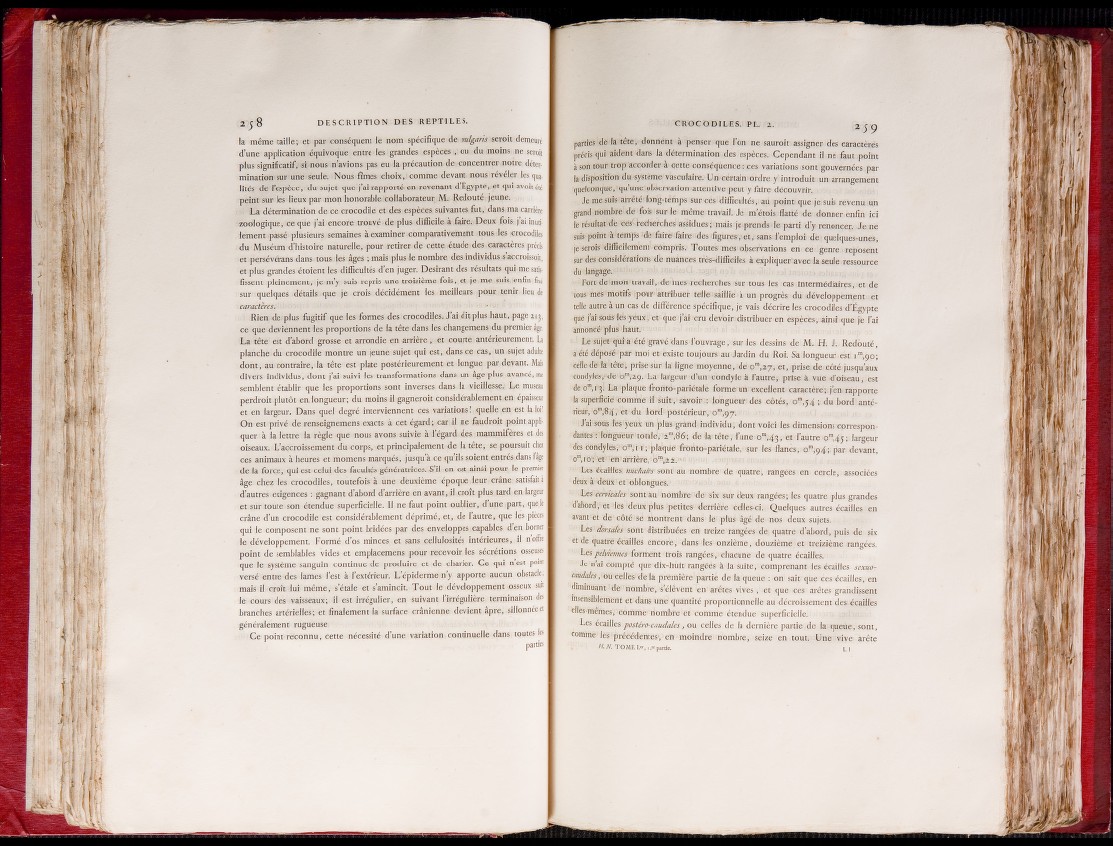
la même taille; et par conséquent le nom spécifique de vnlgaris seroit demeuré
d’une application équivoque entre les grandes espèces , ou du moins ne seroit
plus significatif, si nous n’avions pas eu la précaution de concentrer notre détermination
sur une seule. Nous fîmes choix, comme devant nous révéler les qualités
de l’espèce, du sujet que j’ai rapporté en revenant d’Égypte, et qui avoit été
peint sur les lieux par mon honorable collaborateur M. Redouté jeune.
La détermination de ce crocodile et des espèces suivantes fut, dans ma carrière
zoologique, ce que j’ai encore trouvé de plus difficile à faire. Deux fois j ai inutilement
passé plusieurs semaines à examiner comparativement tous les crocodiles
du Muséum d’histoire naturelle, pour retirer de cette étude des caractères précis
et persévérans dans tous les âges ; mais plus Je nombre des individus s accroissoit,
et plus grandes étoient les difficultés d en juger. Désirant des résultats qui me satisfissent
pleinement, je m’y suis repris une troisième fois, et je me suis, enfin fixé
sur quelques détails que je crois décidément les meilleurs pour tenir lieu de
caractères. . ■ . ;
Rien de plus fugitif que les formes des crocodiles. J’ai ditplus haut, page 213,
ce que deviennent les proportions de la tête dans les changemens du premier, âge.
La tête est d’abord grosse et arrondie en arrière, et courte antérieurement. La
planche du crocodile montre un jeune sujet qui est, dans ce cas, un sujet adulte
dont, au contraire, la tête est plate postérieurement et longue par devant. Mais
divers individus, dont j’ai suivi les transformations dans un âge plus avance, me
semblent établir que les proportions sont inverses dans la vieillesse.' Le museau
perdroit plutôt en longueur; du moins il gagneroit considérablement,en épaisseur
et en largeur. Dans quel degré interviennent ces variations î . quelle en est la loi!
On est privé de renseignemens exacts à cet égard ; car il ne faudroit point appliquer
à la lettre la règle que nous avons suivie à l’égard des mammifères et des
oiseaux. L ’accroissement du corps, et principalement de la tete, se poursuit chez
ces animaux à heures et momens marqués, jusqua ce qu’ils soient entrés,danslage
de la force, qui est celui des facultés génératrices. S’il en est ainsi pour le premier
âge chez les crocodiles, toutefois à une deuxième époque leur crâne satisfait i
d’autres exigences : gagnant d’abord d’arrière en avant, il croît plus tard en largeur
et sur toute son étendue superficielle. Il ne faut point oublier, d une part, que le
crâne d’un crocodile est considérablement déprimé, et, de l’autre, que les pièces
qui le composent ne sont point bridées par des enveloppes capables d’en borner
le développement. Formé d’os minces et sans cellulosités intérieures, il noire
point de semblables vides et emplacemens pour recevoir les sécrétions osseuses
que le système sanguin continue de produire et de charier. Ce qui n est point
versé entre des lames l’est à l’extérieur. L ’épiderme n’y apporte aucun obstacle,
mais il croît lui même, s’étale et s’amincit. Tout le développement osseux suit
le cours des vaisseaux; il est irrégulier, en suivant 1 irrégulière terminaison des
branches artérielles; et finalement la surface crânienne devient âpre, sillonnée et
généralement rugueuse.
Ce point réconnu, cette nécessité d’une variation,continuelle dans toutes les
parties
parties de la tête, donnent à penser que l’on ne sauroit assigner des caractères
précis qui aident dans la détermination des espèces. Cependant il ne faut point
à son tour trop accorder a qette conséquence : ces variations sont gouvernées par
la disposition du système vasculaire. Un certain ordre y introduit un arrangement
quelconque, qu’une observation attentive peut y faire découvrir.
Je me suis arrêté long-temps sur ces difficultés,, au point que je suis revenu un
grand nombre de fois sur le même travail. Je m’étois flatté de donner enfin ici
le résultat de céS' recherches asridues ; mais je prends le parti d’y renoncer. Je ne
suis point à temps de faire faire des-figures, et, sans l’emploi de quelques-unes,
je serois difficilement compris. Toutes mes observations en ce genre reposent
sur des considérations de nuances très-difficiles à expliquer'avec la seule ressource
du langage.
Fort deimon travail, de'ines1 recherches sur tous les cas intermédiaires, et de
tous mes motifs pour attribuer telle saillie à un progrès du développement et
telle autre à un cas de différence spécifique, je vais décrire les crocodiles d’Egypte
que j’ai Soüs lésiyeux, et que-j’ai cru devoir distribuer en espèces, ainsi que je l’ai
annoncé’ plus’ haut.
I.e sujet quia été gravé dans l’ouvrage, sur les dessins de M. H. J. Redouté,
a été déposé par moi et existe toujours au Jardin du Roi. Sa longueur est im,po;
celle de la' tête; prise sur la ligne moyenne, de om,27, et, prise.de côté jusqu’aux
eôndyles/de 6™,29. La largeur d’un condyie à l’autre, prise à vue d’oiseau, est
M R n | La plaque frortto-pariétale forme un excellent caractère; j’en rapporte
la superficie comme il suit, savoir : longueur des côtés, om,y4 ; du bord antérieur,
o5“,'8 4 ,et du bord postérieur, om,07.
Jai sous les yeux un plus-grand individu, dont voici les dimensions correspondantes’
;^longueur totale; '2m,86; de la tête, l’une om,43, et l’autre om,4 j ; largeur
des condJ'Iàs^o'TVi 1 ; plaque frorito-pariétâle, sur les flancs, o " ,94; par devant,
ora,iôf;r,et ; en'arrière/b^.a 2. '
Les écailles1 hùchales' sont au nombre de quatre, rangées en cercle, associées
deux à deux et oblongues. ’
Les cervicales son tau nombre de six sur deux rangées; les quatre plus grandes
dabord,"et les deux plus petites derrière celles-ci. Quelques autres écailles en
avant et de côté se montrent dans le plus âgé de nos deux sujets.
Les dorsales sont distribuées en treize rangées dë quatre d’abord, puis de six
et'de quatre ecailleS encore1, dans les onzième, douzième et treizième rangées.
Les pelviennes forment trois rangées, chacune de quatre écailles.
Je nai compté que dix-huit rangées à la suite, comprenant les écailles sexuo-
caudàles,"ou celles de la première partie de la queue : on sait que ces écailles, en
diminuant de nombre, s'élèvent en arêtes vives et que ces arêtes grandissent
insensiblement et dans une quantité proportionnelle au décroissement des; écailles
elles-memes; comme nombre et comme étendue superficielle.
Les écailles postéro-caudales, ou celles de la dernière partie de la queue, sont,
comme les précédentes", en moindre nombre, seize en tout. Une vive arête
H.N. TOMEI.«, partie. L ,