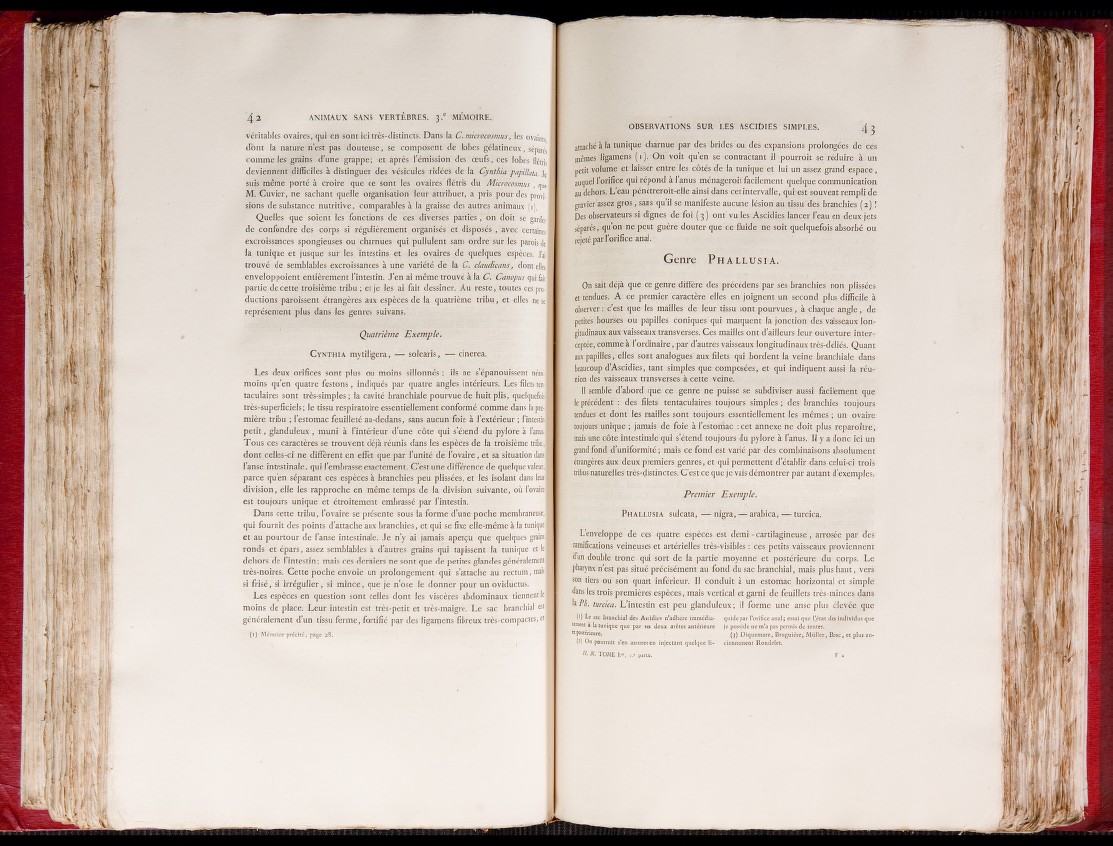
véritables ovaires, qui en sont ici très-distincts. Dans la C. nùcrocosmus, les ovaires
dont la nature n’est pas douteuse, se composent de lobes gélatineux, séparés
comme les grains d’une grappe ; et après l’émission des oeufs, ces lobes flétris
deviennent difficiles à distinguer des vésicules ridées de la Cynthia papillata. Je
suis même porté à croire que ce sont les ovaires flétris du Mlcrocosmus , (jUe
M. Cuvier, ne sachant quelle organisation leur attribuer, a pris pour des provi.
sions de substance nutritive, comparables à la graisse des autres animaux (i).
Quelles que soient les fonctions de ces diverses parties, on doit se garderi
de confondre des corps si régulièrement organisés et disposés , avec certaines
excroissances spongieuses ou charnues qui pullulent sans ordre sur les parois de
la tunique et jusque sur les intestins et les ovaires de quelques espèces. J’aj
trouvé de semblables excroissances à une variété de la C. claudicans, dont elles]
enveloppoient entièrement l’intestin. J’en ai même trouvé à la C . Canopus qui fait]
partie de cette troisième tribu ; et je les ai fait dessiner. A u reste, toutes ces pro-l
ductions paroissent étrangères aux espèces de la quatrième tribu, et elles ne se]
représentent plus dans les genres suivans.
Quatrième Exemple.
C yn th ia mytiligera, — solearis, — cinerea.
Les deux orifices sont plus ou moins sillonnés ; ils ne s’épanouissent néaii-l
moins qu’en quatre festons, indiqués par quatre angles intérieurs. Les filets ten l
taculaires sont très-simples ; la cavité branchiale pourvue de huit plis, quelquefois!
très-superficiels; le tissu respiratoire essentiellement conformé comme dans lapre-l
mière tribu ; l’estomac feuilleté au-dedans, sans aucun foie à l’extérieur ; l’intestin!
p e tit, glanduleux, muni à l’intérieur d’une côte qui s’étend du pylore à l’anus.1
Tous ces caractères se trouvent déjà réunis dans les espèces de la troisième tribu ,1
dont celles-ci ne diffèrent en effet que par l’unité de l’ovaire, et sa situation dans!
l’anse intestinale, qui l’embrasse exactement. C ’est une différence de quelque valeur,]
parce qu’en séparant ces espèces à branchies peu plissées, et les isolant dans leur]
division, elle les rapproche en même temps de la division suivante, où l’ovairt]
est toujours unique et étroitement embrassé par l’intestin.
Dans cette tribu, l’ovaire se présente sous la forme d’une poche membraneuse,]
qui fournit des points d’attache aux branchies, et qui se fixe elle-même à la tu n iqu e]
et au pourtour de l’anse intestinale. Je n’y ai jamais aperçu que quelques grains]
ronds et épars, assez semblables à d’autres grains qui tapissent la tunique et le ]
dehors de l’intestin; mais ces derniers ne sont que de petites g l a n d e s g é n é r a le m e n t ]
très-noires. Cette poche envoie un prolongement qui s’attache au r e c t u m , mais]
si frisé, si irrégulier, si mince, que je n’ose le donner pour un oviductus.
Les espèces en question sont celles dont les viscères abdominaux t ie n n e n t le ]
moins de place. Leur intestin est très-petit et très-maigre. Le sac b r a n c h i a l est]
généralement d’un tissu ferme, fortifié par des ligamens fibreux t r è s - c o m p a c t e s , e t]
(•i) Mémoire précité, page 28.
a t t a c h é à la tunique charnue par des brides ou des expansions prolongées de ces
mêmes ligamens (t). On voit qu’en se contractant il pourroit se réduire à un
petit volume et laisser entre'les côtés de la tunique et lui un assez grand espace ,
auquel l’orifice qui répond à 1 anus ménageroit facilement quelque communication
au dehors. L ’eau pénétreroit-elle ainsi dans cet intervalle, qui est souvent rempli de
g r a v i e r assez gros, sans qu’il se manifeste aucune lésion au tissu1 des branchies ( 2) !
Des observateurs si dignes de foi ( 3 ) ont vu les Ascidies lancer l’eau en deux jets
s é p a r é s , qu’on ne peut guère douter que ce fluide ne soit quelquefois absorbé ou
rejeté par l’orifice anal.
Genre P h a l l u s i A.
On sait déjà que ce genre diffère des précédens par ses branchies non plissées
et tendues. A ce premier caractère elles en joignent un second plus difficile à
observer : c’est que les mailles de leur tissu sont pourvues, à chaque angle, de
petites bourses ou papilles coniques qui marquent la jonction des vaisseaux longitudinaux
aux vaisseaux transverses. Ces mailles ont d’ailleurs leur ouverture interceptée,
comme à l’ordinaire, par d’autres vaisseaux longitudinaux très-déliés. Quant
aux papilles, elles sont analogues aux filets qui bordent la veine branchiale dans
beaucoup d’Ascidies, tant simples que composées, et qui indiquent aussi la réunion
des vaisseaux transverses à cette veine.
Il semble d’abord que ce genre ne puisse se subdiviser aussi facilement que
le précédent : des filets tentaculaires toujours simples ; des branchies toujours
tendues et dont les mailles sont toujours essentiellement les mêmes ; un ovaire
toujours unique ; jamais de foie à l’estomac : cet annexe ne doit plus reparoître,
mais une côte intestinale qui s’étend toujours du pylore à l’anus. Il y a donc ici un
grand fond d’uniformité ; mais ce fond est varié par des combinaisons absolument
étrangères aux deux premiers genres, et qui permettent d’établir dans celui-ci trois
tribus naturelles très-distinctes. C ’est ce que je vais démontrer par autant d’exemples.-
Premier Exemple.
P h a l l u s i a sulcata, — nigra, — arabica,— turcica.
L enveloppe de ces quatre espèces est demi - cartilagineuse, arrosée par des
ramifications veineuses et artérielles très-visibles : ces petits vaisseaux proviennent
dun double tronc qui sort de la partie moyenne et postérieure du corps. Le
pharynx n’est pas situé précisément au fond du sac branchial, mais plus haut, vers
son tiers ou son quart inférieur. Il conduit à un estomac horizontal èt simple
dans les trois premières espèces, mais vertical et garni de feuillets très-minces dans
b P l. turcica. L ’intestin est peu glanduleux; il forme une anse plus élevée que
(0 Le sac branchial des Ascidies n’adhère immédia- quide par l’orifice anal; essai que l’état des individus que
tement a la tunique que par ses deux arêtes antérieure je possède ne m’a pas permis de tenter,
et postérieure. • (3) Diquemare, Bruguière, Müller, Bosc, et plus an-
(2) On pourroit s’en assurer en injectant quelque Ii- dénuement Rondelet.
I §f TOME ¡ J a., partie. F a