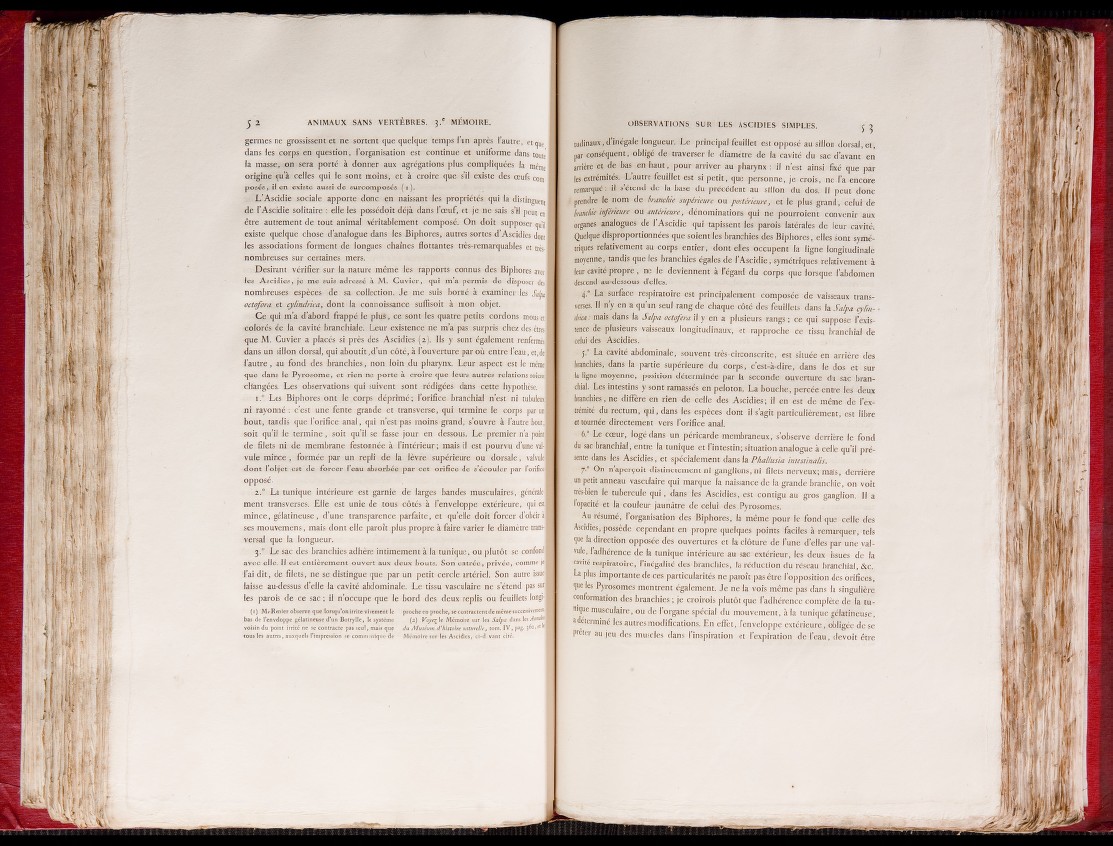
germes ne grossissent et ne sortent que quelque temps l’un après l’autre, et que
dans les corps en question, l’organisation est continue et uniforme dans toute I
la masse, on sera porté à donner aux agrégations plus compliquées la même I
origine qu’à celles qui le sont moins, et à croire que s’il existe des oeufs coin I
posés, il en existe aussi de surcomposés ( 1 ).
L ’Ascidie sociale apporte donc en naissant les propriétés qui la distingua I
de l’Ascidie solitaire : elle les possédoit déjà dans l’oeuf, et je ne sais s’il peut en I
être autrement de tout animal véritablement composé. On doit supposer qU’j| I
existe quelque chose d’analogue dans les Biphores, autres sortes d’Ascidies dont I
les associations forment de longues chaînes flottantes très-remarquables et très-1
nombreuses sur certaines mers.
Désirant vérifier sur la nature même les rapports connus des Biphores avec!
les Ascidies, je me suis adressé à M. Cuvier, qui m’a permis de disposer des■
nombreuses espèces de sa collection. Je me suis borné à examiner les SalpM
octqfora et cylindrica, dont la connoissance suffisoit à mon objet.
Ce qui m’a d’abord frappé le plus, ce sont les quatre petits cordons mous et|
colorés de la cavité branchiale. Leur existence ne m’a pas surpris chez des êtres!
que M. Cuvier a placés si près des Ascidies (2). Ils y sont également renfermés!
dans un sillon dorsal, qui aboutit, d’un côté, à l’ouverture par où entre l’eau, et, de!
l’autre, au fond des branchies, non loin du pharynx. Leur aspect est le même!
que dans le Pyrosome, et rien ne porte à croire que leurs autres relations soient!
changées. Les observations qui suivent sont rédigées dans cette hypothèse. I
i.° Les Biphores ont le corps déprimé; l’orifice branchial n’est ni tuhuleuxfl
ni rayonné : c’est une fente grande et transverse, qui termine le corps par uni
bout, tandis que l’orifice anal, qui n’est pas moins grand, s’ouvre à l’autre bout,!
soit qu’il le termine, soit qu’il se fasse jour en dessous. Le premier n’a ponttl
de filets ni de membrane festonnée à l’intérieur ; mais il est pourvu d’une val-l
vule mince , formée par un repli de la lèvre supérieure ou dorsale, valvule!
dont l’objet est de forcer l’eau absorbée par cet orifice de s’écouler par l’orifice!
opposé.
2.0 La tunique intérieure est garnie de larges bandes musculaires, générale!
ment transverses. Elle est unie de tous côtés à l’enveloppe extérieure, qui esd
mince, gélatineuse, d’une transparence parfaite, et qu’elle doit forcer d’obéir àB
ses mouvemens, mais dont elle paroît plus propre à faire varier le diamètre trans-H
versai que la longueur.
3.0 Le sac des branchies adhère intimement à la tunique, ou plutôt se confond!
avec elle. Il est entièrement ouvert aux deux bouts. Son entrée, privée, comme je!
l’ai dit, de filets, ne se distingue que par un petit cercle artériel. Son autre issue!
laisse au-dessus d’elle la cavité abdominale. Le tissu vasculaire ne s’étend pas sur!
les parois de ce sac ; il n’occupe que le bord des deux replis ou feuillets longt-H
(1) MrRenier observe que lorsqu’on irrite vivement le proche en proche, se contractentde même successivement.
bas de l’enveloppe gélatineuse d’un Botrylle, le système (2) Voye^ le Mémoire sur les Salpa dans \e$AnM‘am
voisin du point irrité ne se contracte pas seul, mais que du Muséum d'histoire naturelle, tom. IV , pag. 360,et ie ^.|
cous les autres, auxquels l’impression se communique de Mémoire sur les Ascidies, ci-cl.vant ciré.
tudinaux, d’inégale longueur. Le principal feuillet est opposé au sillon dorsal, et,
par conséquent, obligé de traverser le diamètre de la cavité du sac d’avant en
arrière et de bas en haut, pour arriver au pharynx : il n’est ainsi fixé que par
l e s extrémités. Lautre feuillet est si petit, que personne, je crois, ne l’a encore
remarqué : il s’étend de la base du précédent au sillon du dos. II peut donc
prendre le nom de branchie supérieure ou postérieure, et le plus grand, celui de
Iranchie inférieure ou antérieure, dénominations qui ne pourroient convenir aux
organes analogues de 1 Ascidie qui tapissent les parois latérales de leur cavité,
Quelque disproportionnées que soient les branchies des Biphores, elles sont symétriques
relativement au corps entier, dont elles occupent la ligne longitudinale
moyenne, tandis que les branchies égalés de 1 Ascidie, symétriques relativement à
leur cavité propre , ne le deviennent à 1’égard du corps que lorsque l’abdomen
descend au-dessous d’elles.
1 ° La surface respiratoire est principalement composée de vaisseaux transverses.
Il n’y en a qu’un seul rang de chaque côté des feuillets dans la Salpa cylin- -
drica: mais dans la Salpa. octqfera il y en a plusieurs rangs ; ce qui suppose l’existence
de plusieurs vaisseaux longitudinaux, et rapproche ce tissu branchial de
celui des Ascidies.
j.° La cavité abdominale, souvent très-circonscrite, est située en arrière des
branchies, dans la partie supérieure du corps, c’est-à-dire, dans le dos et sur
la ligne moyenne, position déterminée par la seconde ouverture du sac branchial.
Les intestins y sont ramasses en peloton. La bouche, percée entre les deux
branchies, ne diffère en rien de celle des Ascidies ; il en est de même de l’ex-
trémite du rectum, qui, dans les espèces dont il s’agit particulièrement, est libre
et tournée directement vers l’orifice anal.
6. Le coeur, loge dans un péricarde membraneux, s’observe derrière le fond
du sac branchial, entre la tunique et l’intestin ; situation analogue à celle qu’il présente
dans les Ascidies, et spécialement dans la Phallusia imestinalis.
J.° On n’aperçoit distinctement ni ganglions, ni filets nerveux; mais, derrière
un petit anneau vasculaire qui marque la naissance de la grande blanchie, on voit
tres-bien le tubercule q u i, dans' les Ascidies, est contigu au gros ganglion. Il a
I opacité et la couleur jaunâtre de celui des Pyrosomes.
Au résumé, 1 organisation des Biphores, la même pour le fond que celle des
Ascidies; possède cependant en propre quelques points faciles à remarquer, tels
que la direction opposée des ouvertures et la clôture de l’une d’elles par une valvule,
l’adhérence de la tunique intérieure au sac extérieur, les deux issues de la
cavité respiratoire, l’inégalité des branchies, la réduction du réseau branchial, &c.
La plus importante de ces particularités ne paroît pas être l’opposition des orifices,
que les Pyrosomes montrent également. Je ne la vois même pas dans la singulière
con ormation des branchies ; je croirois plutôt que l’adhérence complète de la tunique
musculaire, ou de l’organe spécial du mouvement, à la tunique gélatineuse,
a déterminé les autres modifications. En effet, l’enveloppe extérieure, obligée de se
prêter au jeu des muscles dans l’inspiration et l’expiration de l’eau, devoit être