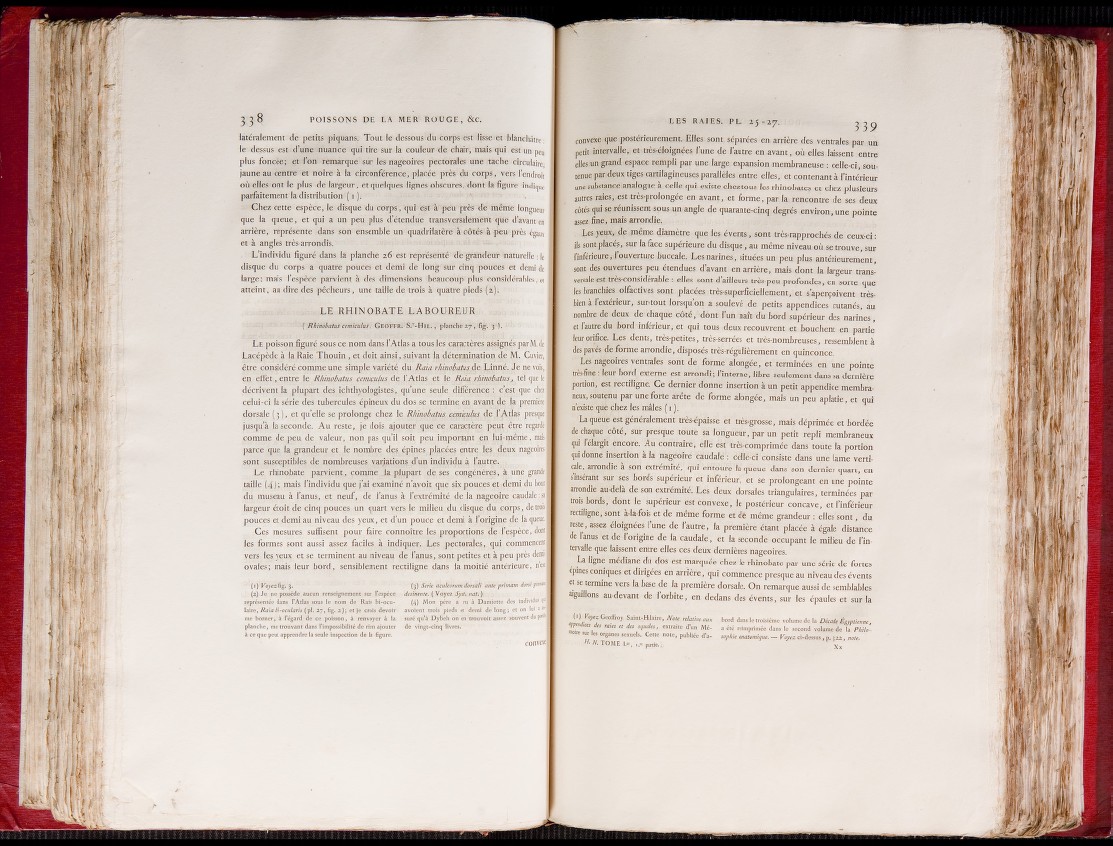
3 38 P O I S S O N S D E L A ME R R O U G E , &C.
latéralement de petits piquans. Tout le dessous du corps est lisse et blanchâtre-
le dessus est d’une nuance qui tire sur la couleur de chair, mais qui est un peu
plus foncée; et l’on remarque sur les nageoires pectorales une tache circulaire
jaune au centre et noire à la circonférence, placée près du corps, vers l’endroit
où elles ont le plus de largeur, et quelques lignes obscures, dont la figure indique
parfaitement la distribution ( i ).
Chez cette espèce, le disque du corps, qui est à peu près de même longueur
que la queue, et qui a un peu plus d’étendue transversalement que d’avant en
arrière, représente dans son ensemble un quadrilatère à côtés à peu près égaux
et à angles très-arrondis.
L ’individu figuré dans la planche 26 est représenté de grandeur naturelle : le
disque du corps a quatre pouces et demi de long sur cinq pouces et demi de
large ; mais l’espèce parvient à des dimensions beaucoup plus considérables, et
atteint, au dire des pêcheurs, une taille de trois à quatre pieds (2).
L E R H IN O B A T E L A B O U R E U R
( Rhinobatus cemicuïus, G eof fr . S.t-H i l . , planche 2 7 , fig. 3 ).
L e poisson figuré sous ce nom dans l’Atlas a tous les caractères assignés parM. de I
Lacépède à la Raie Thouin , et doit ainsi, suivant la détermination de M. Cuvier, I
être considéré comme une simple variété du Raia rhinobatus de Linné. Je ne vois, I
en effet, entre le Rhinobatus cemicuïus de l’Atlas et le Raia rhinobatus, tel que le
décrivent la plupart des ichthyologistes, qu’une seule différence : c’est que chez
celui-ci la série des tubercules épineux du dos se termine en avant de la première
dorsale (3 ), et qu’elle se prolonge chez le Rhinobatus cemicuïus de l’Atlas presque
jusqu’à la seconde. A u reste, je dois ajouter que ce caractère peut être regardé
comme de peu de valeur, non pas qu’il soit peu important en lui-même, mais
parce que la grandeur et le nombre des. épines placées entre les deux nageoires
sont susceptibles de nombreuses variations d’un individu à l’autre.
L e rhinobate parvient, comme Ja plupart de ses congénères, à une grande
taille (4) i mais l’individu que j’ai examiné n’avoit que six pouces et demi du bout
du museau à l’anus, et neuf, de l’anus à l’extrémité de la nageoire caudale:al
largeur étoit de cinq pouces un quart vers le milieu du disque du corps, de trois
pouces et demi au niveau des yeux, et d’un pouce et demi à l’origine de la queue.
Ces mesures suffisent pour faire connoître les proportions de l’espèce, dont
les formes sont aussi assez faciles à indiquer. Les pectorales, qui commencent
vers les yeux et se terminent au niveau de l’anus, sont petites et à peu près demi
ovales; mais leur bord, sensiblement rectiligne dans la moitié antérieure, nest]
' (1) Voyez ftg. 3.
(2) Je ne possède aucun renseignement sur i’espèce
représentée dans l’Atlas sous le nom de Raie bi-ocu-
laire, Rata bi-ocularis (pl. 27, fig. 2 ) ; et je crois devoir
me borner, à l’égard de ce poisson, à renvoyer à la
planche, me trouvant dans l’impossibilité de rien ajouter
à ce que peut apprendre la seule inspection de la figure.
(3) Serie aculeorum dorsali ante priinam dorsi
desinente. ( Voyez Syst. nat. )
(4) Mon père a vu à Darhiette des individus qui
avoient trois pieds et demi de long ; et on lui a as'
suré qu’à Dybeh on en 'trou voit assez souvent du pois
de vingt-cinq livres.
convexe
convexe que postérieurement. Elles sont séparées en arrière des ventrales par un
petit intervalle, et tres-eloignees 1 une de 1 autre en avant, où elles laissent entre
elles un grand espace rempli par une large expansion membraneuse ; celle-ci, soutenue
par deux tiges cartilagineuses parallèles entre elles, et contenant à l’intérieur
u n e substance analogue a celle qui existe chez tous les rhinobates et chez plusieurs
autres raies,.est très-prolongée en avant, et forme, par la rencontre de ses deux
côtés qui se réunissent sous un angle de quarante-cinq degrés environ, une pointe
assez fine, mais arrondie.
Les yeux, de meme diamètre que les évents, sont très-rapprochés de ceux-ci :
ils sont placés, sur la face supérieure du disque, au même niveau où se trouve, sur
l’inférieure, l’ouverture buccale. Les narines, situées un peu plus antérieurement,
sont des ouvertures peu étendues d’avant en arrière, mais dont la largeur transversale
est très-considérable : elles sont d’ailleurs très-peu profondes, en sorte que
les blanchies olfactives sont placées tres-superficiellement, et s’aperçoivent très-
bien a 1 extérieur, sur-tout lorsqu on a soulevé de petits appendices cutanés, au
nombre de deux de chaque cote , dont 1 un naît du bord supérieur des narines,
et 1 autre du bord inférieur, et qui tous deux recouvrent et bouchent en partie
leur orifice. Les dents, tres-petites, très-serrées et très-nombreuses, ressemblent à
des pavés de forme arrondie, disposés très-régulièrement en quinconce.
Les nageoires ventrales sont de forme alongée, et terminées en une pointe
tres-fine : leur bord externe est arrondi; 1 interne, libre seulement dans sa dernière
portion, est rectiligne. Ce dernier donne insertion à un petit appendice membraneux,
soutenu par une forte arete de forme alongée, mais un peu aplatie, et qui
n’existe que chez les mâles ( t ).
La queue est généralement tres-epaisse et très-grosse, mais déprimée et bordée
de chaque côté, sur presque toute sa longueur, par un petit repli membraneux
qui 1 élargit encore. Au contraire, elle est très-comprimée dans toute la portion
qui donne insertion a la nageoire caudale : celle-ci consiste dans une lame verticale,
arrondie a son extrémité, qui entoure la queue dans son dernier quart, en
smserant sur ses bords supérieur et inférieur, et se prolongeant en une pointe
arrondie au-delà de son extrémité. Les deux dorsales triangulaires, terminées par
trois bords, dont le supérieur est convexe, le postérieur concave, et l’inférieur
rectiligne, sont a-la-fois et de meme forme et de même grandeur : elles son t, du
reste, assez éloignées 1 une de l’autre, la première étant placée à égale distance
de lanus et de 1 origine de la caudale, et la seconde occupant le milieu de l’intervalle
que laissent entre elles ces deux dernières nageoires.
La ligne médiane du dos est marquée chez le rhinobate par une série de fortes
épines coniques et dirigées en arriéré, qui commence presque au niveau des évents
*t se termine vers la base de Ja première dorsale. On remarque aussi de semblables
aiguillons au-devant de l’orbite, en dedans des évents, sur les épaules et sur la
( ') ^ « G e o f fr o y Saint-Hiiaire, Note relative aux bord dans le troisième volumede la Décade Égyptienne
mndteet des rates et des squales, extraite d’un Mé- a été reimprimée dans le second volume de la Philo’.
iur Ies oreanB oeOTeIs- Cett0 note> publiée d’a- sophie anatomique. - Voyez ci-dessus , p. 3 a x , note.
H- N. TOME I .., ..«partie.;, Xx