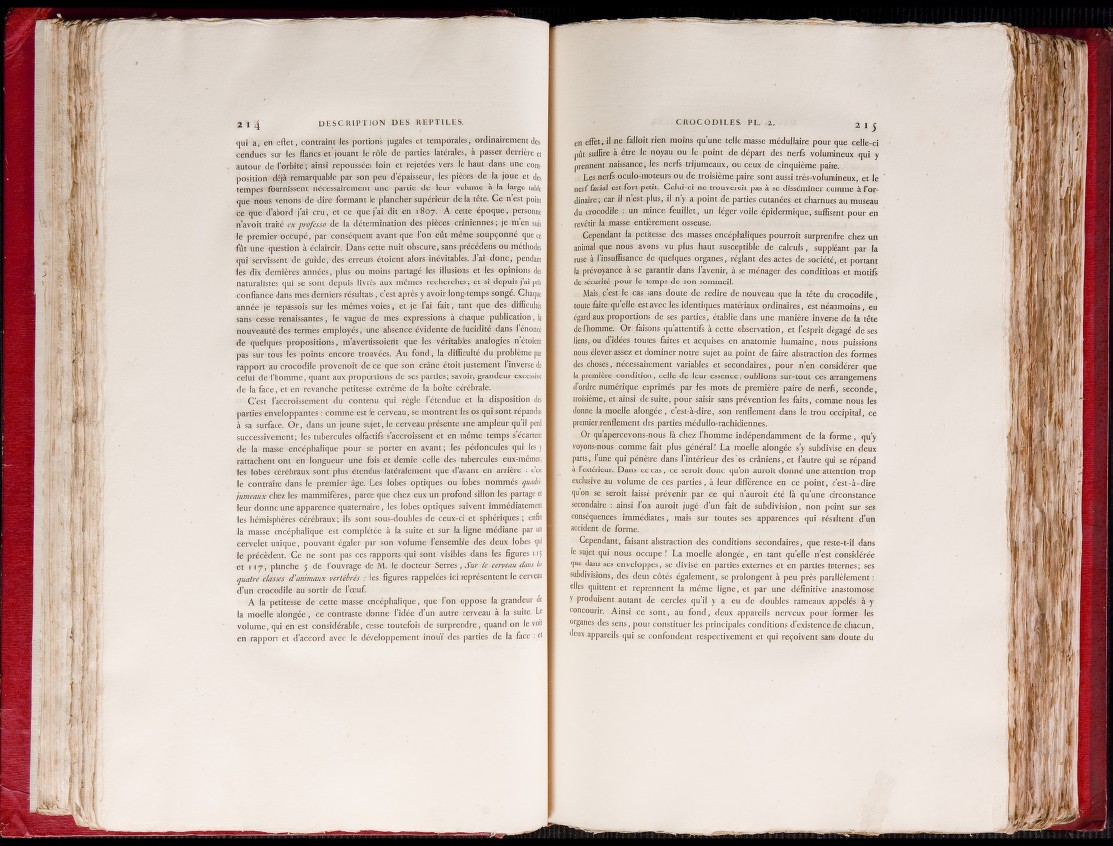
qui a, en effet, contraint les portions jugales et temporales, ordinairement des
cendues sur les flancs et jouant le rôle de parties latérales, à passer derrière et
autour de l’orbite; ainsi repoussées loin et rejetées vers le haut dans une composition
déjà remarquable par son peu d’épaisseur, les pièces de la joue et des
tempes fournissent nécessairement une partie de leur volume à la large table
que nous venons de dire formant le plancher supérieur de la tête. Ce n est point
ce que d’abord j’ai cru, et ce que j’ai dit en 1807. A cette époque, personne
n’avoit traité ex professo de la détermination des pieoes crâniennes ; je m en suis
le premier occupé, par conséquent avant que Ion eût meme soupçonne que ce
lut une question à éclaircir. Dans cette nuit obscure, sans précédens ou méthodes
qui servissent de guide, des erreurs étoient alors inévitables. J ai donc, pendant
les dix dernières années, plus ou moins partagé les illusions et les opinions des
naturalistes qui se sont depuis livrés aux mêmes recherches ; et si depuis j’ai pris
confiance dans mes derniers résultats, c’est après y avoir long-temps songé. Chaque
année je repassois sur les mêmes voies, et je l’ai fait, tant que des difficultés
sans cesse renaissantes, le vague de mes expressions à chaque publication, la
nouveauté des termes employés, une absence évidente de lucidité dans 1 énoncé
de quelques propositions, m’avertissoieiit que les véritables analogies netoient
pas sur tous les points encore trouvées. A u fond, la difficulté du problème par
rapport au crocodile provenoit de ce que son crâne étoit justement 1 inverse de
celui de l’homme, quant aux proportions de ses parties; savoir, grandeur excessive
de la face, et en revanche petitesse extrême de la boîte cérébrale.
C ’est l’accroissement du contenu qui règle l’étendue et la disposition des
parties enveloppantes : comme est le cerveau, se montrent les os qui sont répandus
à sa surface. O r , dans un jeune sujet, le cerveau présente une ampleur qu’il perd
successivement; les tubercules olfactifs s’accroissent et en même temps s’écartent
de la masse encéphalique pour se porter en avant ; les pédoncules qui les y
rattachent ont en longueur une fois et demie celle des tubercules eux-mêmes;
les lobes cérébraux sont plus étendus latéralement que d’avant en arrière : c’est
le contraire dans le premier âge. Les lobes optiques ou lobes nommés quaài
jumeaux chez les mammifères, parce que chez eux un profond sillon les partage et
leur donne une apparence quaternaire, les lobes optiques suivent immédiatement
les hémisphères cérébraux; ils sont sous-doubles de ceux-ci et sphériques ; enfin
la masse encéphalique est complétée à la suite et sur la ligne médiane par un
cervelet unique, pouvant égaler par son volume l’ensemble des deux lobes qui
le précèdent. Ce ne sont pas ces rapports qui sont visibles dans les figures nj
et 1 1 7 , planche 5 de l’ouvrage de M. le docteur Serres , Sur le cerveau dans lu
quatre classes d ’animaux vertébrés : les figures rappelées ici représentent le cerveau
d’un crocodile au sortir de l’oeuf.
A la petitesse de cette masse encéphalique, que l’on oppose la grandeur de
la moelle alongée, ce contraste donne l’idée d’un autre cerveau à la suite. Le
volume, qui en est considérable, cesse toutefois de surprendre, quand on le voit
en rapport et d’accord avec le développement inouï des parties de la face . et
en effet, il ne falloit rien moins qu’une telle masse médullaire p o u r que celle-ci
pût suffire à être le noyau ou le p o in t d e d épart des nerfs volumineux qui y
prennent naissance, les nerfs trijumeaux, o u ceux de cinquième paire.
Les nerfs oculo-moteurs ou de troisième paire sont aussi très-volumineux, et le
nerf facial est fort petit. Celui-ci ne trouveroit pas à se disséminer comme à l'ordinaire;
car il n’est plus, il n’y a point de parties cutanées et charnues au museau
du crocodile : un mince feuillet, un léger voile épidermique, suffisent pour en
revêtir la masse entièrement osseuse.
Cependant la petitesse des masses encéphaliques p o u rra it surprendre chez un
animal que nous avons vu plus haut susceptible de c alculs, suppléant par la
ruse à l’insuffisance de quelques organes, réglant des actes de société, et po rtan t
la prévoyance à se garantir dans l’avenir, à se ménager des conditions e t motifs
de sécurité p o u r le temps de son sommeil.
Mais, c’est le cas sans doute de redire de nouveau que la tête du crocodile,
toute faite qu’elle est avec les identiques matériaux ordinaires, est néanmoins, eu
égard aux proportions de ses parties, établie dans une manière inverse de la tête
de l’homme. Or faisons qu’attentifs à cette observation, et l’eSprit dégagé de ses
liens, ou d’idées toutes faites et acquises en anatomie humaine, nous puissions
nous .élever assez et dominer notre sujet au point de faire abstraction des formes
des choses, nécessairement variables et secondaires, pour n’en considérer que
la première condition, celle de leur essence ; oublions sur-tout ces arrangemens
d’ordre numérique exprimés par les mots de première paire de nerfs, seconde,
troisième, et ainsi de suite, pour saisir sans prévention les faits, comme nous les
donne la moelle alongée, c’est-à-dire, son renflement dans le trou occipital, ce
premier renflement des parties médullo-rachidiennes.
Or qu’apercevons-nous là chez l’homme indépendamment de la forme, qu’y
voyons-nous comme fait plus général j La moelle alongée s’y subdivise en deux
parts,, l’une qui pénètre dans l’intérieur des‘os crâniens, e t l’autre qui se répand
a 1 extérieur. Dans ce cas, ce serait donc qu’on aurait donné une attention trop
exclusive au volume de ces parties, à leur différence en ce point, c’est-à-dire
quon se serait laissé prévenir par ce qui n’aurait été là qu’une circonstance
secondaire : ainsi l ’on aurait jugé d’un fait de subdivision, non point sur ses
conséquences immédiates, mais sur toutes ses apparences qui résultent d’un
accident de forme.
Cependant, faisant abstraction des conditions secondaires, que reste-t-il dans
le sujet qui nous occupe ! La moelle alongée, en tant quelle n’est considérée
que dans ses enveloppes, se divisé en parties externes et en parties internes; ses
subdivisions, des deux côtés également, se prolongent à peu près parallèlement :
elles quittent et reprennent la même ligne, et par une définitive anastomose
y produisent autant de cercles qu’il y a eu de doubles rameaux appelés à y
concourir. Ainsi ce sont, au fond, deux appareils nerveux pour former les
organes des sens, pour constituer les principales conditions d’existence de chacun,
deux appareils qui se confondent respectivement et qui reçoivent sans doute du