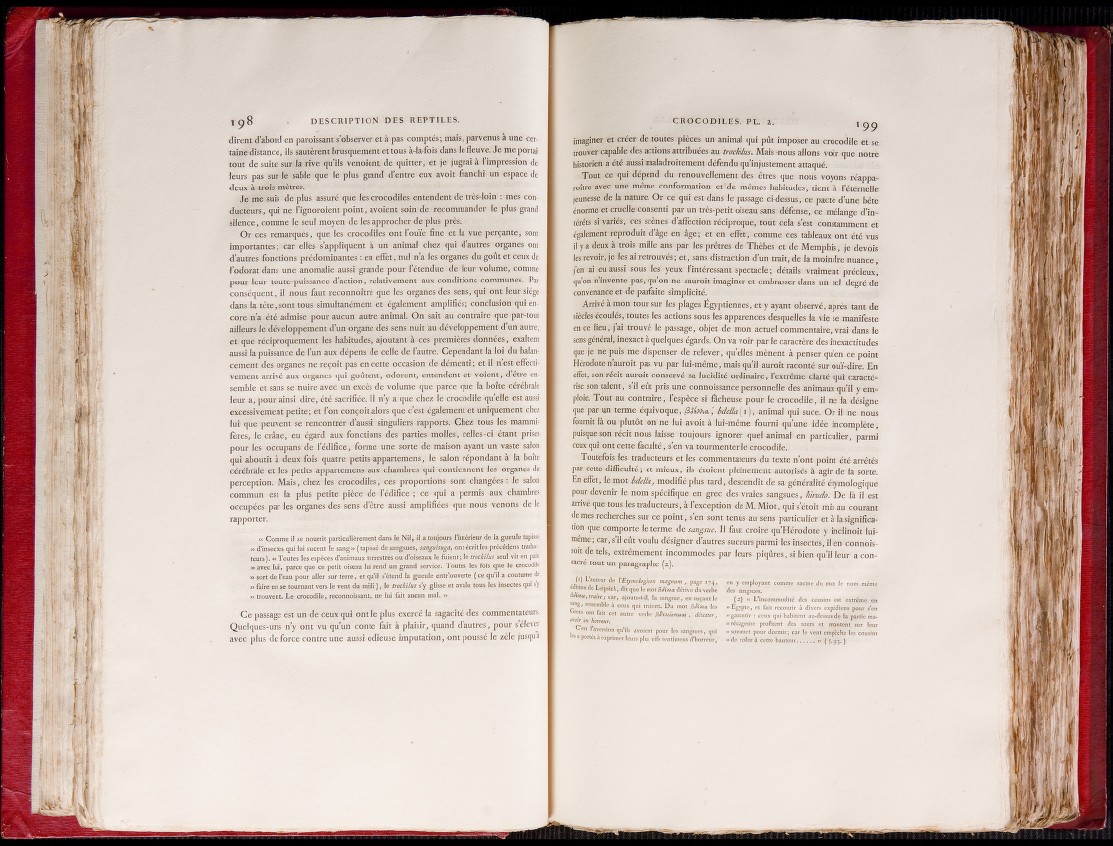
dirent d’abord en paraissant s’observer et à pas comptés; mais, parvenus à une certaine
distance, ils sautèrent brusquement et tous à-la-fois dans le fleuve. Je me portai
tout de suite sur la rive qu’ils venoient. de quitter, et je jugeai à l’impression de
leurs pas sur le sable que le plus grand d’entre eux avoit franchi un espace de
deux à trois mètres.
Je me suis de plus assuré que les crocodiles entendent de très-loin : mes conducteurs,
qui ne l’ignoraient point, avoient soin de recommander le plus grand
silence, comme le seul moyen de les approcher de plus près.
O r ces remarques, que les crocodiles ont l’ouïe fine et la vue perçante, sont
importantes; car elles s’appliquent à un animal chez qui d’autres organes ont
d’autres fonctions prédominantes : en effet, nul n’a les organes du goût et ceux de
l’odorat dans une anomalie aussi grande pour l’étendue de leur volume, comme
pour leur toute-puissance d’action, relativement aux conditions communes. Par
conséquent, il nous faut reconnoître que les qrganes des sens, qui ont leur siège
dans la tête, sont tous simultanément et également amplifiés; conclusion qui encore
n’a été admise pour aucun autre animal. On sait au contraire que par-tout
ailleurs le développement d’un organe des sens nuit au développement d’un autre,
et que réciproquement les habitudes, ajoutant à ces premières données, exaltent
aussi la puissance de l’un aux dépens de celle de l’autre. Cependant la loi du balancement
des organes ne reçoit pas en cette occasion de démenti ; et il n’est effectivement
arrivé aux organes qui goûtent, odorent, entendent et voient, détre ensemble
et sans se nuire avec un excès de volume que parce que la boîte cérébrale
leur a, pour ainsi due, été sacrifiée. Il n’y a que chez le crocodile qu’elle est aussi
excessivement petite; et l’on conçoit alors que c’est également et uniquement chez
lui que peuvent se rencontrer d’aussi singuliers rapports. Chez tous les mammifères,
le crâne, eu égard aux fonctions des parties molles, celles-ci étant prises
pour les occupans de l’édifice, forme une sorte de maison ayant un vaste salon
qui aboutit à deux fois quatre petits appartemens, le salon répondant à la boîte
cérébrale et les petits appartemens aux chambres qui contiennent les organes de
perception. Mais, chez les crocodiles, ces proportions sont changées: le salon
commun est la plus petite pièce de l’édifice ; ce qui a permis aux chambres
occupées par les organes des sens d’être aussi amplifiées que nous venons de le
rapporter.
« Comme il se nourrit particulièrement dans le Nil, il a toujours l'intérieur de la gueule tapissé
» d’insectes qui lui sucent le sang» (tapissé de sangsues, sanguisuga, ont écrit les précédens traducteurs).
« Toutes les espèces d’animaux terrestres ou d’oiseaux le fuient; le trociilus seul vit en paix
» avec lui, parce que ce petit oiseau lui rend un grand service. Toutes les fois que le crocodile
» sort de l’eau pour aller sur terre, et qu’il s’étend la gueule entr’ouverte ( ce qu’il a coutume de
„ faire en se tournant vers le vent du midi ) , le trochilus s’y glisse et avàle tous les insectes qui sy
y> trouvent. Le crocodile, reconnoissant, ne lui fait aucun mal. »
C e passage est un de ceux qui ont le plus exercé la sagacité des commentateurs.
Quelques-uns n’y ont vu qu’un conte fait à plaisir, quand d autres, pour s elever
avec plus de force contre une aussi odieuse imputation, ont poussé le zele jusqua
imaginer et créer de toutes pièces un animal qui pût imposer au crocodile et se
trouver capable des actions attribuées au trochilus. Mais nous allons voir que notre
historien a été aussi maladroitement défendu qu’injustement attaqué.
Tout ce qui dépend du renouvellement des êtres que nous voyons réappa-
roître avec une même conformation et'de mêmes habitudes, tient à l’étemelle
jeunesse de la nature. Or ce qui est dans le passage ci-dessus, ce pacte d’une bête
énorme et cruelle consenti par un très-petit oiseau sans défense, ce mélange d’intérêts
si variés, ces scènes d’affection réciproque, tout cela s’est constamment et
également reproduit d’âge en âge; et en effet, comme ces tableaux ont été vus
il y a deux à trois mille ans par les prêtres de Thèbes et de Memphis, je devois les revoir, je les ai retrouvés; et, sans distraction d’un trait, de la moindre nuance,
j’en ai eu aussi sous les yeux l’intéressant spectacle ; détails vraiment précieux,
qu’on n’invente pas, qu’on ne saurait imaginer et embrasser dans un tel degré de
convenance et de parfaite simplicité.
Arrivé à mon tour sur les plages Égyptiennes, et y ayant observé, après tant de
siècles écoulés, toutes les actions sous les apparences desquelles la vie se manifeste
en ce lieu, j’ai trouvé le passage, objet de mon actuel commentaire, vrai dans le
sens general, inexact a quelques égards. On va voir par le caractère des inexactitudes
que je ne puis me dispenser de relever, qu’elles mènent à penser qu’en ce point
Hérodote n’auroit pas vu par lui-même, mais qu’il aurait raconté sur ouï-dire. En
effet, son récit aurait conservé sa lucidité ordinaire, l’extrême clarté qui caractérise
son talent, s’il eût pris une connoissance personnelle des animaux qu’il y emploie.
Tout au contraire, l’espèce si fâcheuse pour le crocodile, il ne la désigne
que par un terme équivoque, flSitAa | bdella ( i ), animal qui suce. Or il ne nous
fournit là ou plutôt on ne lui avoit à lui-même fourni qu’une idée incomplète,
puisque son récit nous laisse toujours ignorer quel animal en particulier, parmi
ceux qui ont cette faculté, s’en va tourmenter le crocodile.
Toutefois les traducteurs et les commentateurs du texte n’ont point été arrêtés
par cette difficulté; et mieux, ils étoient pleinement autorisés à agir de la sorte.
En effet, le mot bdella, modifié plus tard, descendit de sa généralité étymologique
pour devenir le nom spécifique en grec des vraies sangsues, lùrudo. D e là il est
arrivé que tous les traducteurs, à l’exception de M. Miot, qui s’étoit mis au courant
de mes recherches sur ce point, s’en sont tenus au sens particulier et à la signification
que comporte le terme de sangsue. Il faut croire qu’Hérodote y inclinoit lui-
meme ; car, s il eût voulu désigner d’autres suceurs parmi les insectes, il en connois-
soit de tels, extrêmement incommodes par leurs piqûres, si bien qu’il leur a consacré
tout un paragraphe (2).
(0 L’auteur de l’Etymologkon magnum, page 174, en y employant comme racine du mot le nom .même
édition de Leipsick, dit que le mot dJï^a. dérive du verbe des sangsues.
Ma, traire, car, ajoute-t-il, la sangsue, en suçant le (a ) « L’incommodité des cousins est extrême en
q ë> ressent le a ceux qui traient. Du mot (iJïMa. les » Egypte, et fait recourir à divers expédiens pour s’en
ecs ont ait cet autre verbe $£'í\v<r<n>f¿cti , detesterj »garantir : ceux qui habitent au-dessus de la partie ma-
dvoir en horreur • r i
p, “ | »recageuse profitent des tours et montent sur leur
est aversion qu’ils avoient pour les sangsues, qui »sommet pour dormir; car le vent empêche les cousins
s a portera exprimer leurs plus vifs sentimens d’horreur, » de voler à cette hauteur » ( 5. 95. )