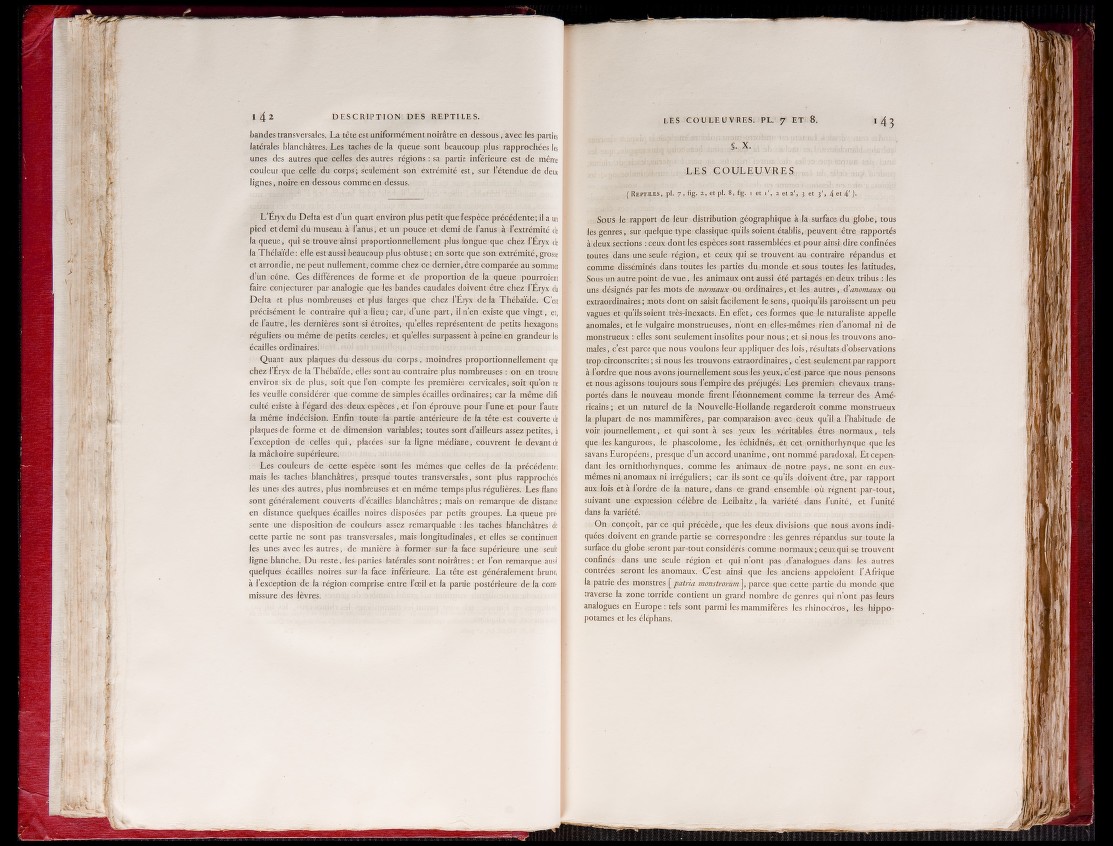
bandes transversales, La tête est uniformément noirâtre en dessous, avec Jes parties
latérales blanchâtres. Les taches de la queue sont beaucoup plus rapprochées les
unes des autres que celles des autres régions : sa partie inférieure est de même
couleur que celle du corps; seulement son extrémité est, sur l’étendue de deux
lignes, noire en dessous comme en dessus.
L ’Ëryxdu Delta est d’un quart environ plus petit que l’espèce précédente; il a un
pied et demi du museau à l’anus, et un pouce et demi de l’anus à l’extrémité de
la queue, qui se trouve ainsi proportionnellement plus longue que chez l’Eryx de
la Thébaïde : elle est aussi beaucoup plus obtuse ; en sorte que son extrémité, grosse
et arrondie, ne peut nullement, comme chez ce dernier, être comparée au sommet
d’un cône. Ces différences de forme et de proportion de la queue pourroient
faire conjecturer par analogie que les bandes caudales doivent être chez l’Eryx du
Delta et plus nombreuses et plus larges que chez l’Éryx de la Thébaïde. C ’est
précisément le contraire qui a lieu; car, d’une part, il n’en existe que vingt, et,
de l’autre, les dernières sont si étroites, qu’elles représentent de petits hexagones
réguliers ou même de petits cercles; et qu’elles surpassent à peine en grandeur les
écailles ordinaires:1
Quant aux plaques du dessous du corps, moindres proportionnellement que
chez l’Eryx de la Thébaïde, elles sont au contraire plus nombreuses : on en trouve
environ six de plus, soit que l’on compte les premières cervicales, soit qu’on ne
les veuille considérer que comme de simples écailles ordinaires; car la même difficulté
existe à l’égard des deux espèces, et l’on éprouve pour l’une et pour l’autre
la même indécision. Enfin toute la partie antérieure de la tête est couverte de
plaques de forme et de dimension variables; toutes sont d’ailleurs assez petites, à
l’exception de celles qui, placées sur la ligne médiane, couvrent le devant de
la mâchoire supérieure.
Les couleurs de cette espèce sont les mêmes que celles de la précédente;
mais les taches blanchâtres, presque toutes transversales, sont plus rapprochées
les unes des autres, plus nombreuses et en même temps plus régulières. Les flancs
sont généralement couverts d’écailles blanchâtres ; mais on remarque de distance
en distance quelques écailles noires disposées par petits groupes. La queue présente
une disposition de couleurs assez remarquable : les taches blanchâtres de
cette partie ne sont pas transversales, mais longitudinales, et elles se continuent
les unes avec les autres, de manière à former sur la face supérieure une seule
ligne blanche. Du reste, les- parties latérales sont noirâtres ; et l’on remarque aussi
quelques écailles noires sur la face inférieure. La tête est généralement brune,
à l’exception de la région comprise entre l’oeil et la partie postérieure de la commissure
des lèvres.
§. X.
L E S C O U L E U V R E S
( R e p t ile s , pl. 7 , fig. 2, et pl. 8, fig. 1 et 1', 2 et a ', 3 et 3', 4 et 4 ' )■
Sous le rapport de leur distribution géographique à la surface du globe, tous
les genres, sur quelque type classique qu’ils soient établis, peuvent être rapportés
à deux sections : ceux dont les espèces sont rassemblées et pour ainsi dire confinées
toutes dans une seule région, et ceux qui se trouvent au contraire répandus et
comme disséminés dans toutes les parties du monde et sous toutes les latitudes,
Sous un autre point de vu e , les animaux ont aussi été partagés en deux tribus : les
uns désignés par les mots de normaux ou ordinaires, et les autres, d’anomaux ou
exuaordinaires ; mots dont on saisit facilement le sens, quoiqu’ils paraissent un peu
vagues et qu’ils soient très-inexacts. En effet, ces formes que le naturaliste appelle
anomales, et le vulgaire monstrueuses, n’ont en elles-mêmes rien d’anomal ni de
monstrueux : elles sont seulement insolites pour nous ; et si nous les trouvons anomales,
c’est parce que nous voulons leur appliquer des lois, résultats d’observations
trop circonscrites ; si nous les trouvons extraordinaires, c’est seulement par rapport
à l’ordre que nous avons journellement sous les yeux, c’est parce que nous pensons
et nous agissons toujours sous l’empire des préjugés. Les premiers chevaux transportés
dans le nouveau monde firent l’étonnement comme la terreur des Américains
; et un naturel de la Nouvelle-Hollande regarderait comme monstrueux
la plupart de nos mammifères, par comparaison avec ceux qu’il a l’habitude de
voir journellement, et qui sont à ses yeux les véritables êtres normaux, tels
que les kanguroos, le phascolome, les éohidnés, et cet ornithorhynque que les
savans Européens, presque d’un accord unanime, ont nommé paradoxal. Et cependant
les ornithorhynques, comme les animaux de notre pays, ne sont en eux-
mêmes ni anomaux ni irréguliers; car ils sont ce qu’ils doivent être, par rapport
aux lois et à l’ordre de la nature, dans ce grand ensemble où régnent par-tout,
suivant une expression célèbre de Leibnitz, la variété dans l’unité, et l’unité
dans la variété.
On conçoit, par ce qui précède, que les deux divisions que nous avons indiquées
doivent en grande partie se correspondre : les genres répandus sur toute la
surface du globe seront par-tout considérés comme normaux ; ceux qui se trouvent
confinés dans une seule région et qui n’ont pas d’analogues dans les autres
contrées seront les anomaux. C’est ainsi que les anciens appeloient l’Afrique
la patrie des monstres [ patria monstrorum ], parce que cette partie du monde que
traverse la zone torride contient un grand nombre de genres qui n’ont pas leurs
analogues en Europe: tels sont parmi les mammifères les rhinocéros, les hippopotames
et les éléphans.