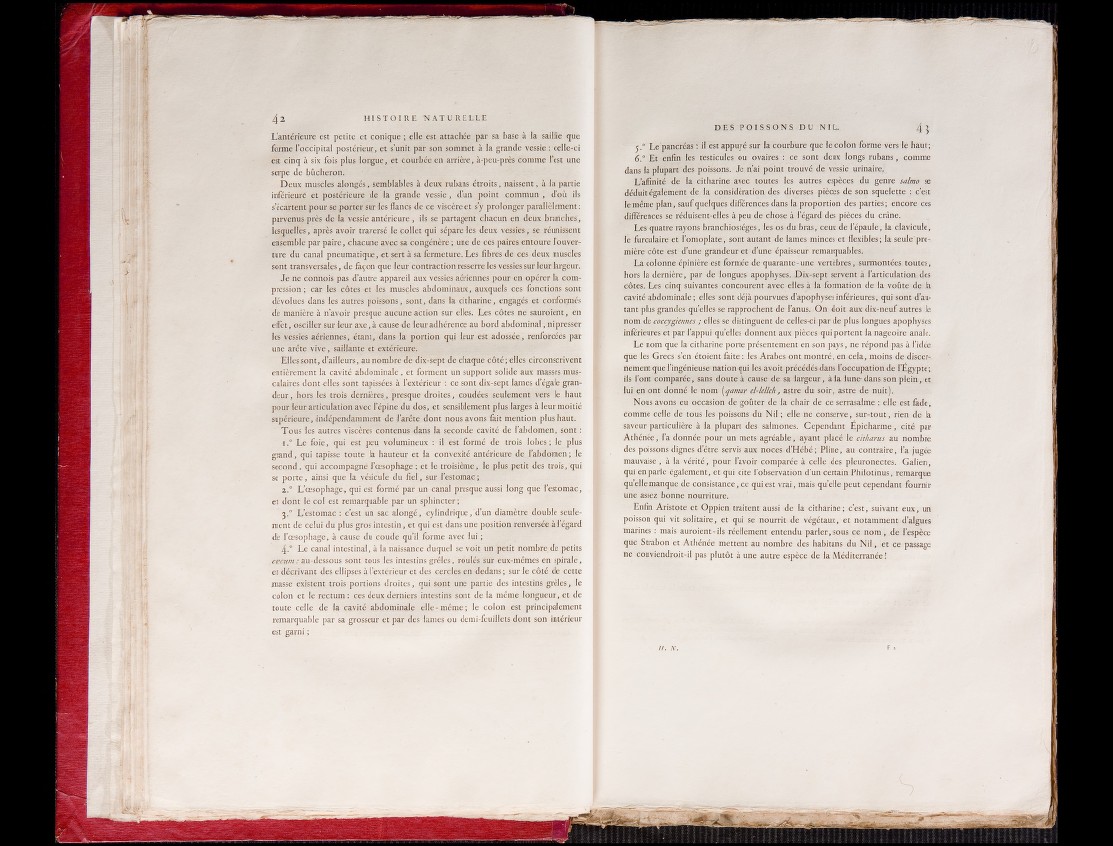
L ’antérieure est petite et conique ; elle est attachée par sa base à la saillie que
forme l’occipital postérieur, et s’unit par son sommet à la grande vessie : celle-ci
est cinq à six fois plus longue, et courbée en arrière, à-peu-près Comme l’est unq
serpe de bûcheron.
Deux muscles alongés, semblables à deux rubans étroits, naissent, à la partie
inférieure et postérieure de la grande vessie , d’un point commun , d’où ils
s’écartent pour se porter sur les flancs de ce viscère et s’y prolonger parallèlement :
parvenus près de la vessie antérieure, ils se partagent chacun en deux branches,
lesquelles, après avoir traversé le collet qui sépare les deux vessies, se réunissent
ensemble par paire, chacune avec sa congénère ; une de ces paires entoure l’ouverture
du canal pneumatique, et sert-à sa fermeture. Les fibres de ces deux muscles
sont transversales, de façon que leur contraction resserre les vessies sur leur largeur.
Je ne connois pas d’autre appareil aux vessies aériennes pour en opérer la compression
; car les côtes et les muscles abdominaux, auxquels ces fonctions sont
dévolues dans les autres poissons, sont, dans la citharine, engagés et conformés
de manière à n’avoir presque aucune action sur elles. Les côtes ne sauroient, en
effet, osciller sur leur axe, à cause -de leur adhérence au bord abdominal, ni presser
les vessies aériennes, étant, dans la portion qui leur est adossée, renforcées par
une arête viv e , saillante et extérieure.
Elles sont, d’ailleurs, au nombre de dix-sept de chaque côté; elles circonscrivent
entièrement la cavité abdominale, et forment un support solide aux masses musculaires
dont elles sont tapissées à l’extérieur : ce sont dix-sept lames d’égale grandeur,
hors les trois dernières, presque droites, coudées seulement vers le haut
pour leur articulation avec l’épine du dos, et sensiblement plus larges à leur moitié
supérieure, indépendamment de -l’arête dont nous avons fait mention plus haut.
Tous les autres viscères contenus dans la seconde cavité de l’abdomen, sont :
i L e foie, qui est peu volumineux : il est formé de trois lobes; le plus
grand, qui tapisse toute la hauteur et la convexité antérieure de l’abdomen ; le
second, qui accompagne l’oesophage ; et le troisième, le plus petit des trois, qui
se porte, ainsi que la vésicule du fie l, sur l’estomac ;
2.0 L ’oesophage, qui est formé par un canal presque aussi long que l’estomac,
et dont le col est remarquable par un sphincter ;
3.° L’estomac : c’est un sac alongé, cylindrique, d’un diamètre double seulement
de celui du plus gros intestin, et qui est dans une position renversée à l’égard
de l’oesophage, à cause du coude qu’il forme avec lui ;
4 -° Le canal intestinal, à la naissance duquel se voit un petit nombre de petits
caecum : au-dessous sont tous les intestins grêles, roulés sur eux-mêmes en spirale,
et décrivant des ellipses à l’extérieur et des cercles en dedans; sur le côté de cette
masse existent trois portions droites, qui sont une partie des intestins grêles, le
colon et le rectum : ces deux derniers intestins sont de la même longueur, et de
toute celle de la cavité abdominale elle-même; le colon est principalement
remarquable par sa grosseur et par des lames ou demi-feuillets dont son intérieur
est garni ;
j.° Le pancréas : il est appuyé sur la courbure que le co lo n forme vers le h a u t;
6 ° Et enfin les testicules ou ovaires : ce sont deux longs rubans, comme
dans la plupart des poissons. Je n’ai point trouvé de vessie urinaire.
L ’affinité de la citharine avec to utes les autres espèces du genre salmo se
déduit également de la considération des diverses pièces de son squelette : c’est
le même p lan , sauf quelques différences dans la p ro p o rtio n des parties; encore ces
différences se réduisent-elles à peu de chose à l’égard des pièces du crâne.
Les quatre rayons branchiostéges, les os du bras, ceux de l’épaule, la clavicule,
le furculaire et l’omoplate, sont autant de lames minces et flexibles; la seule'pre-
mière côte est d’une grandeur et d’une épaisseur remarquables.
La colonne épinière est formée de quarante-une vertèbres, surmontées toutes,
hors la dernière, par de longues apophyses. Dix-sept servent à l’articulation des
côtes. Les cinq suivantes concourent avec elles à la formation de la voûte de la
cavité abdominale ; elles sont déjà pourvues d’apophyses inférieures, qui sont d’autant
plus grandes qu’elles se rapprochent de l’anus. On doit aux dix-neuf autres le
nom de coccygicnnes ; elles se distinguent de celles-ci par de plus longues apophyses
inférieures et par l’appui qu’elles donnent aux pièces qui portent la nageoire anale.
Le nom que la citharine porte présentement en son pays, ne répond pas à l’idée
que les Grecs s’en étoient faite : les Arabes ont montré, en cela, moins de discernement
que l’ingénieuse nation qui les avoit précédés dans l’occupation de l’Egypte;
ils l’ont comparée, sans doute à cause de sa largeur, à la lune-dans son plein, et
lui en ont donné le nom (qamar el-ldleh, astre du soir, astre de nuit).
Nous avons eu occasion de goûter de la chair de ce serrasalme : elle est fade,
comme celle de tous les poissons dû Nil ; elle ne conserve, sur-tout, rien de la
saveur particulière à la plupart des sahnones. Cependant Épicharme , cité par
Athénée, l’a donnée pour un mets agréable, ayant placé le citharus au nombre
des poissons dignes d’être servis aux noces d’Hébé; Pline, au contraire, l’a jugée
mauvaise , à la vérité, pour l’avoir comparée à celle des pleuronectes. Galien,
qui en parle également, et qui cite l’observation d’un certain Philotinus, remarque
qu’elle manque de consistance, ce qui est vrai, mais qu’elle peut cependant fournir
Une assez bonne nourriture.
Enfin Aristote et Oppien traitent aussi de la citharine; c’est, suivant eux, un
poisson qui vit solitaire, et qui se nourrit de végétaux, et notamment d’algues
marines : mais auroient-ils réellement entendu parler, sous ce nom, de l’espèce
que Strabon et Athénée mettent au nombre des habitans du N i l , et ce passage
ne conviendroit-il pas plutôt à une autre espèce de la Méditerranée.'