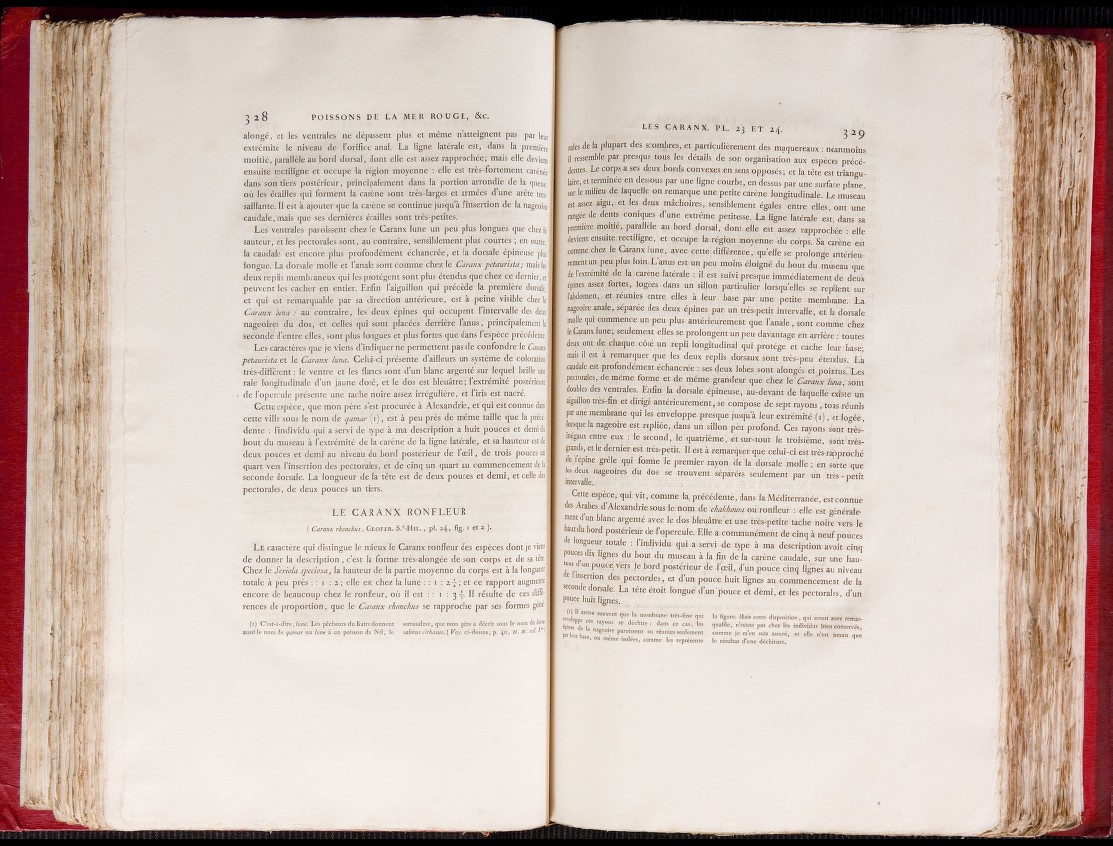
alongé, et les ventrales ne dépassent plus et même n atteignent pas par leur
extrémité le niveau de l’orifice anal. La ligne latérale est, dans la première
moitié, parallèle au bord dorsal, dont elle est assez rapprochée; mais elle devient!
ensuite rectiligne et occupe la région moyenne : elle est très-fortement carénée
dans son tiers postérieur, principalement dans la portion arrondie de la queue,|
où les écailles qui forment la carène sont très-larges et armées d’une arête très-1
saillante. Il est à ajouter que la carène se continue jusqu a l’insertion de la nageoire
caudale, mais que ses dernières écailles sont très-petites.
Les' ventrales paroissent chez le Caranx lune un peu plus longues que chez le I
sauteur, et les pectorales sont, au contraire, sensiblement plus courtes ; en outre,!
la caudale est encore plus profondément échancrée, et la dorsale épineuse plus I
longue. La dorsale molle et l’anale sont comme chez le Caranx petaurista; mais les |
deux replis membraneux qui les protègent sont plus étendus que chez ce dernier, et I
peuvent les cacher en entier. Enfin l’aiguillon qui précède la première dorsale,!
et qui est remarquable par sa direction antérieure, est a peine visible chez le I
Caranx lutta : au contraire, les deux épines qui occupent 1 intervalle des demi
nageoires du dos, et celles qui sont placées derrière lanus, principalement laI
seconde d’entre elles, sont plus longues et plus fortes que dans 1 espece précédente.I
Les caractères que je viens d’indiquer ne permettent pas de confondre le Cmnx
petaurista et Je Caranx luna. Celui-ci présente d ailleurs un système de coloration \
-très-différent : le ventre et les flancs sont d’un blanc argenté sur lequel brille une
raie longitudinale d’un jaune doré, et le dos est bleuâtre ; 1 extrémité postérieure
de l’opercule présente une tache noire assez irrégulière, et liris est nacré.
Cette espèce, que mon père s’est procurée à Alexandrie, et qui est connue dansi
cette ville sous le nom de qamar ( i ) , est à peu près de même taille que la précédente
: l’individu qui a servi de type à ma description a huit pouces et demi du
bout du museau à l’extrémité de la carène de la ligne latérale, et sa hauteur est de
deux pouces et demi au niveau du bord postérieur de 1 oe il, de trois pouces un
quart vers l’insertion des pectorales, et de cinq un quart au commencement de II
seconde dorsale. La longueur de la tête est de deux pouces et demi, et celle des!
pectorales, de deux pouces un tiers.
L E C A R A N X R O N F L E U R
( Caranx rhonchus, G e o f f r . S.’ -H i l . , pl. z 4 > % • i et a ).
L e caractère qui distingue le mieux le Caranx ronfleur des espèces dont je viens
de donner la description, c’est la forme très-alongée de son corps et de sa tete. j
Chez le Seriola speciosa, la hauteur de la partie moyenne du corps est à la longueur]
totale à peu près : : t : z ; elle est chez la lune : : t : 2-j-; et ce rapport augmente
encore de beaucoup chez le ronfleur, où il est : : i : 3 -j-, II résulte de ces diffe- !
rences de proportion, que je Caranx rhonclius se rapproche par ses formes gene-
(1) C’est-à-dire, lune. Les pêcheurs du Kaire donnent serrasalme, que mon père a décrit sous le nom deStnt I
aussi le nom de qamar ou lune à un poisson du Nil, le salinuscitharus. ( Voy. ci-dessus, p. 4° , n. N. vol. !• Il
raies de la plupart des scombres, et particulièrement des maquereaux : néanmoins
¡I ressemble par presque tous les détails de son organisation aux espèces précédentes.
Le corps a ses deux bords convexes en sens opposés ; et la tête est triangul
e , et terminée en dessous par une ligne courbe, en dessus par une surface plane,
sur le milieu de laquelle on remarque une petite carène longitudinale. Le museau
est assez aigu, et les deux mâchoires, sensiblement égales entre elles, ont une
rangée de dents coniques d’une extrême petitesse. La ligne latérale est, dans sa
première moitié, parallèle au.bord dorsal, dont elle est assez rapprochée : elle
devient ensuite rectiligne, et occupe la-¡région moyenne du corps. Sa carène est
comme:chez le Caranx lune, avec cette'différence, qu’elle se. prolonge antérieurement
un peu plus loin. L ’anus est un peu moins éloigne du bout du museau que
de I extrémité de la.carène latérale : il.est suivi presque immédiatement de deux
épines assez fortes, logées dans un siljon particulier lorsqu’elles se replient sur
labdomen, et réunies entre elles à leur base, par une petite membrane. La
nageoire anale, séparée des deux épines par un très-petit intervalle, et la dorsale
molle qui commence un peu plus antérieurement que l’anale , sont comme chez
le .Caranx lune; seulement elles se prolongent un peu davantage en arrière toutes
deux .ont de., chaque côté un repli longitudinal qui protège et cache leur base;
mais il est à remarquer que les deux replis dorsaux sont très-peu étendus. La
.caudale est profondément échancrée : ses deux lobes sont alongés et pointus. Les
pectorales, de même forme et de même grandeur que: chez le'Caranx luna, sont
•doubles des ventrales. Enfin la dorsale épineuse, au-devant de laquelle existe un
aiguillon très-fin et dirigé antérieurement, se compose de sept rayons, tous réunis
par une membrane qui les enveloppe, pesque jusqu’à leur extrémité { i ) , èt logée,
lorsque la nageoire est repliée, dans un sillon pèu profond. Ces rayons sont très-
megaux entre eux : le second, le quatrième, et sur-tout le troisième, sont’ très-
grands, et le dernier est trèsrpetit. Il est à remarquer que celui-ci est très-rapproché
dej épine grêle qui forme le premier rayon de la dorsale molle; en sorte que
les deux nageoires du dos se trouvent séparées seulement par un très - petit
intervalle.,j ¡ ~ , . . . r
. C«tte_ espèce- A« vit, comme la, précédente, dans la Méditerranée, est connue
es. rates:d Alexandrie sous le nom de cliakhoura où ronfleur : elle est généralement
d un blanc argenté avec le dos bleuâtre et une trèsepétite tache noire vers le
autdu bord postérieur de 1 opercule. Elle a communément de cinq à neuf pouces
e ongueur totale : l’individu qui a servi de type à ma description avoit cinq
pouces dix lignes du bout, du museau à la fin de la carène caudale, sur une hauteur
un poucù vers Je fiordpostérieur de l’oeil, d’un pouce cinq lignes au niveau
e insertion des pectorales., et d’un pouce huit lignes au commencement de la
secon e dorsale. La tête étoit longue d’un pouce et dèmi, et les pectorales, d’un
pouce huit lignes.
W Ê Ê Ê m Ë I tIUS. !*, membrane1,très-fine qui la figure. Mais'cette disposition, qui seroit assez femar-
épines de la ■ ’ " : ce cas’ ,es quable, n’diiste pas chez lés individus bien conservés,
Prieur base J * 0' ? Vm ™enc ou «unies seulement comme je m’en suis assuré, et elle n’est jamais que
’ “ mcme 'solees, comme les représente le résultat d’une déchirure.