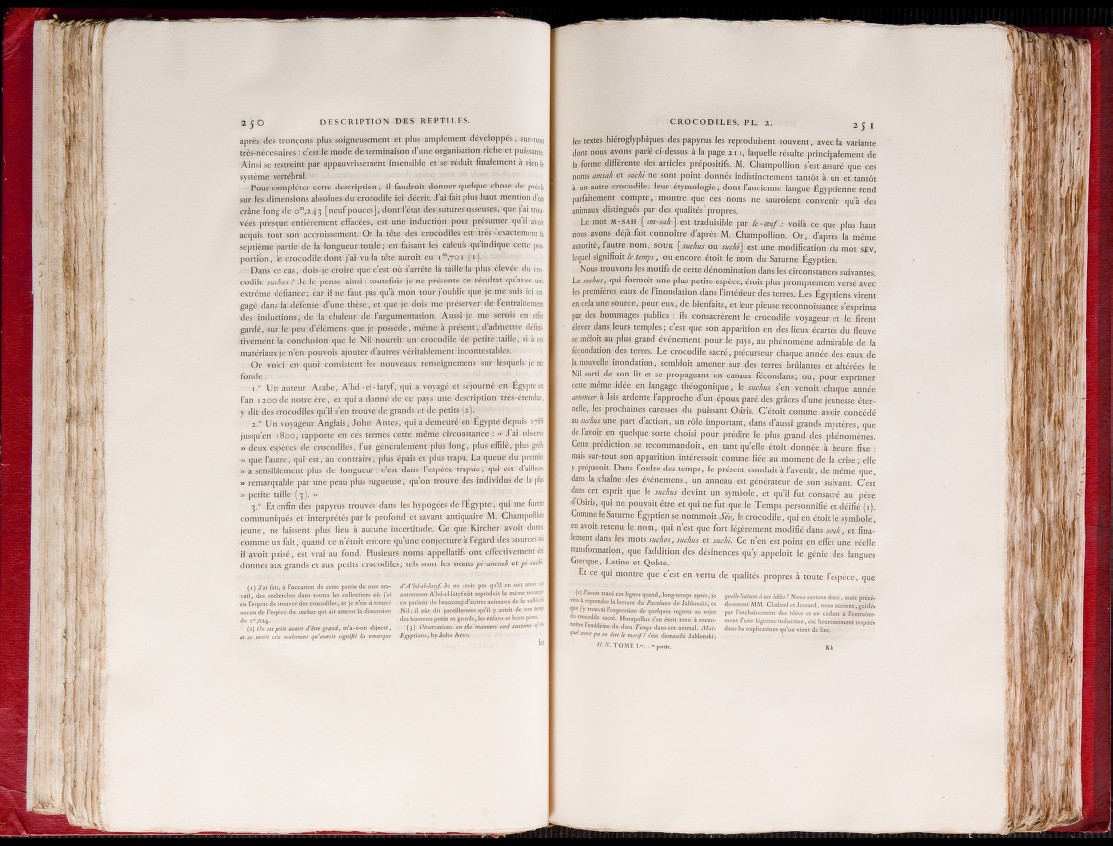
après des tronçons plus soigneusement et plus amplement développés, sur-toui
très-nécessaires : c’est le mode de terminaison d’une organisation riche et puissante.
Ainsi se restreint par appauvrissement insensible et se réduit finalement à rien le
système vertébral.
Pour compléter cette description, il faudroit donner quelque chose de précis
sur les dimensions absolues du crocodile ici décrit. J’ai fait plus haut mention d’un
crâne long de om,a43 [neuf pouces], dont l’état des sutures osseuses, que j’ai trouvées
presque entièrement effacées , est une induction pour présumer qu’il avoit
acquis tout son accroissement. Or la tête des crocodiles est très-exactement la
septième partie de la longueur totale ; en faisant ies calculs qumdique cette proportion
, le crocodile dont j’ai vu la tête auroit eu i'^ yo i ;
Dans ce cas, dois-je croire que c’est où s’arrête la taille la plus élevée du crocodile
suclms! Je le pense ainsi : toutefois je ne présente ce résultat qu’avec une
extrême défiance; car il ne faut pas qu’à mon tour j’oublie que je me-suis ici engagé
dans la défense d’une thèse, et que je dois me préserver de l'entraînement
des inductions, de la chaleur de l’argumentation. Aussi je me serois en effet
gardé, sur le peu d’élémens que je possède, même à présent, d’admettre définitivement
la conclusion que le Nil nourrit un crocodile de petite taille, si à ces
matériaux je n’en pouvois ajouter d’autres véritablement incontestables.
Or voici en quoi consistent les nouveaux renseignemens sur lesquels je mb
fonde :
1.° Un auteur Arabe, A ’bd-el-latyf, qui a voyagé et séjourné en Égypte en
l’an i 200 de notre ère, et qui a donné de ce pays une description très-étendue,
y dit des crocodiles qu’il s’en trouve de grands et de petits (2). "
2.° Un voyageur Anglais, John Antes, qui a demeuré en Egypte depuis 1788
jusqu’en 1800, rapporte en ces termes cette même circonstance -: J’ai observé
» deux espèces de crocodiles, l’un généralement piits long, plus efflé; plus grêle
» que l’autre, qui est, au contraire, plus épais et plus trapu. La queue du premier
» a sensiblement plus de longueur : c’est dans 1 espéGe'trapue; qui est d ailleurs
» remarquable par une peau plus rugueuse, quon trouve des individus deda plus
» petite taille (3). »
3.0 Et enfin des papyrus trouvés dans les hypogées de l’Ëgypte, qui me furent
communiqués et interprétés par le profond et savant antiquaire M. Champollioii
jeune, ne laissent plus lieu à aucune incertitude. Ce que Kircher a v o i t donné
comme un fait, quand ce n’étoit encore qu une conjecture a l égard des sources où
il avoit puisé, est vrai au fond. Plusieurs noms appellatifs ont effectivement été
donnés aux grands et aux petits crocodiles; tels sont les1 noms pi-amsah etpi-suck
(1 ) J’ai fait, à l’occasion de cette partie de mon tra- d*A’ bd-el-latyf. Je ne crois pas qu il en soit a in s i.car
vail, des recherches dans toutes les collections où j’ai autrement A ’bd-el-Iâtyf eût reproduit la même remarque
eu l’ espoir de trouver des crocodiles, et je n’en ai trouvé en parlant de beaucoup d’autres animaux de la vallée u
aucun de l’espèce du suchus qui ait atteint la dimension N il; il eût dit pareillement qu’il y avoit de son temps
de im,Ô24. des hommes petits et. grands, les éhfans et leurs pères.
(2) On est petit avant d’être grand, m’a-t-on objecté, (3) Observations, <mthé manners and- customs o fé
et ce seroit cela seulement qu’auroit signifié la remarque Egyptians, by John Antes.
les textes hiéroglyphiques des papyrus les reproduisent souvent, avec la variante
dont nous avons parle ci-dessus a la page 2 1 1 , laquelle résulte principalement de
la forme différente des articles prépositifs. M. Champollion s’est assuré que ces
noms amsa/i et suchi ne sont point donnés indistinctement tantôt à un et tantôt
à un autre crocodile; leur étymologie, dont l’ancienne langue Égyptienne rend
parfaitement compte, montre que ces noms ne sauroient convenir qu’à des
animaux distingués par des qualités propres.
Le mot m - s a h [ em-sa/i ] est traduisible par le-oe uf : voilà ce que plus haut
nous avons déjà fait connoître d’après M. Champollion. O r, d’après la même
autorité, 1 autre nom, s o u k [ suchus ou suchi] est une modification du mot sË v ,
lequel signifioit le temps, ou encore étoit le nom du Saturne Égyptien.
Nous trouvons les motifs de cette dénomination dans les circonstances suivantes.
Le suchus, qui formoit une plus petite espece, étoit plus promptement versé avec
les premières,¡eaux de l’inondation dans l'intérieur des terres. Les Égyptiens virent
en cela une source, pour eux, de bienfaits, et leur pieuse reconnoissance s’exprima
par, des hommages publics : ils consacrèrent le crocodile voyageur et le firent
élever dans leurs temples; c’est que son apparition en des lieux écartés du fleuve
sse meloit au plus grand evenement pour le pays, au phénomène admirable de la
fécondation des terres. L e crocodile sacré, précurseur chaque année des eaux de
la nouvelle inondation, sembloit amener sur des terres brûlantes et altérées le
Nil sorti de son lit et se propageant en canaux fécondans; ou, pour exprimer
cette meme idée en langage théogonique, le suchus s’en venoit chaque année
annoncer a Isis ardente 1 approche d un époux paré des grâces d’une jeunesse éternelle,
les prochaines caresses du puissant Osiris. C ’étoit comme avoir concédé
m suchus \me part d action, un rôle important, dans d’aussi grands mystères, que
de l’avoir en quelque sorte choisi pour prédire le plus grand des phénomènes.
Cette prédiction se recommandoit, en tant qu’elle étoit donnée à heure fixe :
mais sur-tout son apparition intéressoit comme liée au moment de la crise ; elle
y préparoit. Dans 1 ordre des temps, le présent conduit à l’avenir, de même que,
dans la chaîne des événemens, un anneau est générateur de son suivant. Cest
dans cet esprit que le suchus devint un symbole, et qu’il fut consacré au père
d’Osiris, qui ne pouvoit être et qui ne fut que le Temps personnifié et déifié (1).
Comme le Saturne Égyptien se nommoit Sè'v, le crocodile, qui en étoit le symbole,
en avoit retenu le nom, qui n’est que fort légèrement modifié dans souk, et finalement
dans les mots suchos, suchus et suchi. Ce n’en est point en effet une réelle
transformation, que l’addition des désinences qu’y appeloit le génie des langues
Grecque, Latine et Qobte.
Et ce qui montre que c’est en'vertu de qualités propres à toute l’espèce, que
(0 J avois tracé ces lignes quand, long-temps après, je quelle liaison à ces idées! Nous aurions donc, mais précé-
rePrendre l.u lecture du Panthéon de Jablqnski, et demment MM. Chabrol et Jornard, nous aurions, guidés
]u 'Uouvai, expression de quelques regrets au sujet par l’enchaînement des idées et en cédant à i’entraînennîrro>
r° u - “ T ¡ M É I S 1 étoit renu à « “ n- ment d’une légitime induction, été heureusement inspirés
embleme du dieu Temps dans cet animal. Mais dans les explications qu’on vient de lire
?»« avoit pu en être le motif! s’est demandé Jablonski;
ff-br. TOME I.«, partie. K l