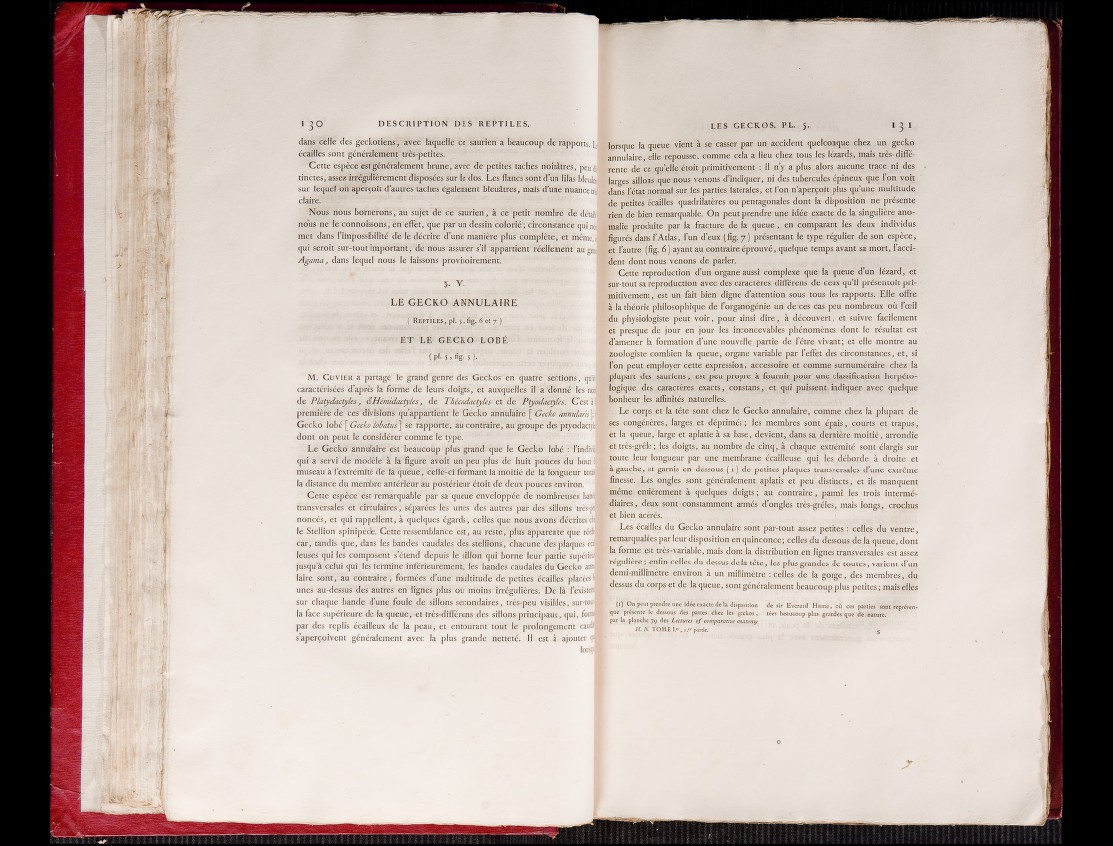
dans ceile des geckotiens, avec laquelle ce saurien a beaucoup de rapports, i l
écailles sont généralement très-petites.
Cette espèce est généralement brune, avec de petites taches noirâtres, peujl
tinctes, assez irrégulièrement disposées sur le dos. Les flancs sont d’un lilas bleultJ
sur lequel on aperçoit d’autres taches également bleuâtres, mais d’une nuancetrèj
claire.
Nous nous bornerons, au sujet de ce saurien, à ce petit nombre de détailjl
nous ne leconnoissons, en effet, que par un dessin colorié ; circonstance qui nol
met dans l’impossibilité de le décrire d’une manière plus complète, et même, 1
qui seroit sur-tout important, de nous assurer s’il appartient réellement au g a i
Agama, dans lequel nous le laissons provisoirement.
§• V .
L E G E C K O A N N U L A IR E
( R e p t i l e s , p l. 5 , f ig . fi e t 7 )
E T LE G E C K O L O B É
( pi- 5 . %■ 5 i-
M. C u v i e r a partagé le grand genre des Geckos en quatre sections, qu’ill
caractérisées d’après la forme de leurs doigts, et auxquelles il a donné les non»
de Platydactyles, d’Hémidactyles, de Thécadactyles et de Ptyodactyles. C’est à I
première de ces divisions qu’appartient le Gecko annulaire [ Gecko anmdaris j; 1
Gecko lobé [ Gecko lobatus\ se rapporte, au contraire, au groupe des ptyodactyltl
dont on peut le considérer comme le type.
L e Gecko annulaire est beaucoup plus grand, que le Gecko lobé : l’indiviij
qui a servi de modèle à la figure avoit un peu plus de huit pouces du bout f l
museau à l’extrémité de la queue, celle-ci formant la moitié de la longueur totilifl
la distance du membre antérieur au postérieur étoit de deux pouces environ.
Cette espèce est remarquable par sa queue enveloppée de nombreuses ban*
transversales et circulaires, séparées les unes des autres par des'sillons très-püB
noncés, et qui rappellent, à quelques égards, celles que nous avons décrites cl®
le Stellion spinipède. Cette ressemblance est, au reste, plus apparente que réclltl
car, tandis que, dans les bandes caudales des stellions, chacune des plaques ccal
leuses qui les composent s’étend depuis le sillon qui borne leur partie supériei®
jusqu’à celui qui les termine inférieurement, les bandes caudales du Gecko anntfl
laire sont, au contraire, formées d’une multitude de petites écailles placées II
unes au-dessus des autres en lignes plus ou moins irrégulières. De là l’existem®
sur chaque bande d’une foule de sillons secondaires, très-peu visibles, sur-toui®
la face supérieure de la queue, et très-différens des sillons principaux, qui, fora®
par des replis écailleux de la peau, et entourant tout le prolongement eau«®
s’aperçoivent généralement avec la plus grande netteté. Il est à ajouter <|®
lorsque la queue vient à se casser par un accident quelconque chez un gecko
annulaire, elle repousse, comme cela a lieu chez tous les lézards, mais très-différente
de ce qu’elle étoit primitivement : il n’y a plus alors aucune trace ni des
larges sillons que nous venons d’indiquer, ni des tubercules épineux que l’on voit
dans l’état normal sur les parties latérales, et l’on n’aperçoit plus qu’une multitude
de petites écailles quadrilatères ou pentagonales dont la disposition ne présente
rien de bien remarquable. On peut prendre une idée exacte de la singulière anomalie
produite par la fracture de la queue , en comparant les deux individus
figurés dans l’Atlas, l’un d’eux (fig. 7 ) présentant le type régulier de son espèce,
et l’autre (fig. 6) ayant au contraire éprouvé, quelque temps avant sa mort, l’accident
dont nous venons de parler.
Cette reproduction d’un organe aussi complexe que la queue d’un lézard, et
sur-tout sa reproduction avec des caractères différens de ceux qu’il présentoit primitivement,
est un fait bien digne d’attention sous tous les rapports. Elle offre
à la théorie philosophique de l’organogénie un de ces cas peu nombreux où l’oeil
du physiologiste peut v o ir , pour ainsi dire, à découvert, et suivre facilement
et presque de jour en jour les inconcevables phénomènes dont le résultat est
d’amener la formation d ’une nouvelle partie de l’être vivant; et elle montre au
zoologiste combien la queue, organe variable par l’effet des circonstances, et, si
l’on peut employer cette expression, accessoire et comme surnuméraire chez la
plupart des sauriens, est peu propre à fournir pour une classification herpéto-
iogique des caractères exacts, constans, et. qui puissent indiquer avec quelque
bonheur les affinités naturelles.
Le corps et la tête sont chez le Gecko annulaire, comme chez la plupart de
ses congénères, larges et déprimés; les membres sont épais, courts et trapus,
et la queue, large et aplatie à sa base, devient, dans sa dernière moitié, arrondie
et très-grêle ; les doigts, au nombre de cinq, à chaque extrémité sont élargis sur
toute leur longueur par une membrane écailleuse qui les déborde , à droite et
à gauche, et garnis en dessous ( 1 ) de petites plaques transversales d’une extrême
finesse. Les ongles sont généralement aplatis et peu distincts, et ils manquent
même entièrement à quelques doigts ; au contraire, parmi les trois intermédiaires,
deux sont constamment armés d’ongles très-grêles, mais longs, crochus
et bien acérés.
Les écailles du Gecko annulaire sont par-tout assez petites : celles du ventre,
remarquables par leur disposition en quinconce ; celles du dessous de la queue, dont
la forme est tres-variable, mais dont la distribution en lignes transversales est assez
reguliere ; enfin celles du dessus de la tete, les plus grandes de toutes, varient d’un
demi-millimètre environ à un millimètre : celles de la gorge, des membres, du
dessus du corps et de la queue, sont généralement beaucoup plus petites ; mais elles
(1) On peut prendre une idée exacte de la disposition de sir Everard Home, où ces parties sont représen-
que présente le dessous des pattes chez les geckos;, . tées beaucoup plus grandes que de nature,
par la planche 79 des Lectures o f comparative anatomy
H. N. TOME I.er, 1 ,rc partie. . ^^,,1. ' ' g