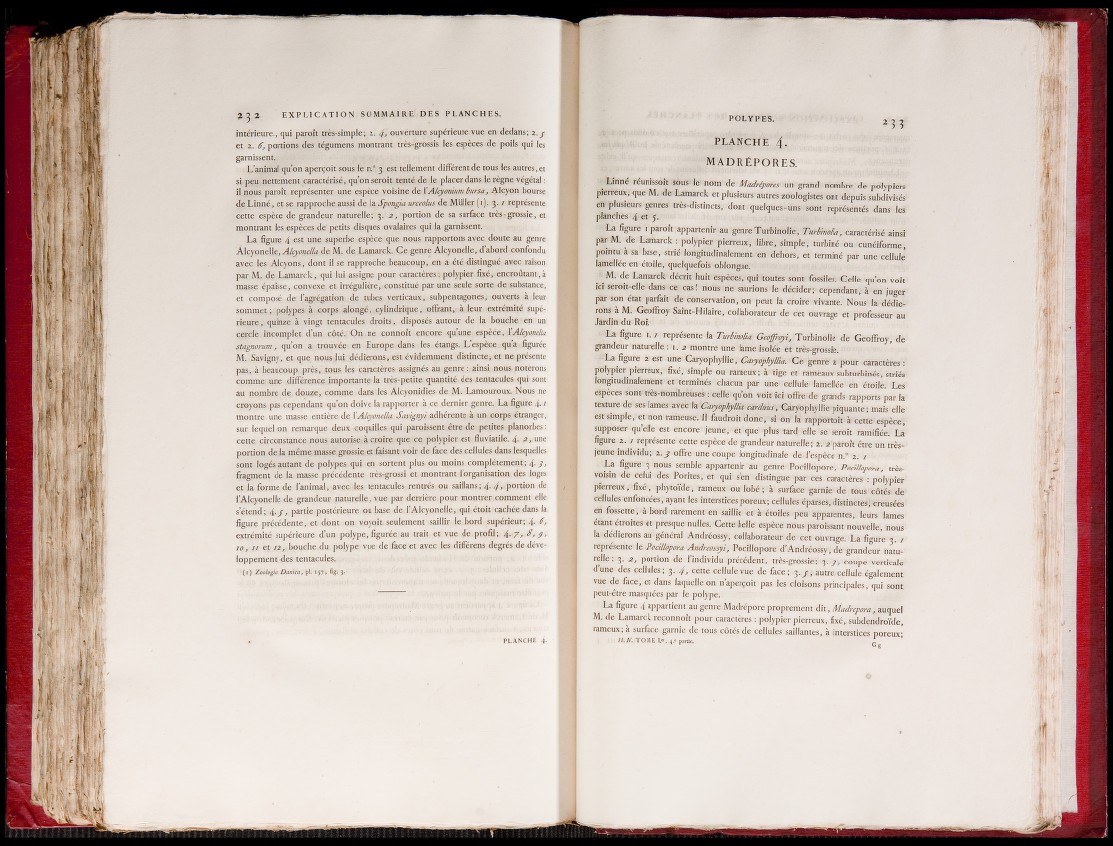
intérieure-, qui paroît très-simple; 2. M ouverture supérieure vue en dedans; 2.y
et 2. tf, portions des tégumens montrant très-grossis les espèces de poils qui les
garnissent.
L ’animal qu’on aperçoit sous le n.° 3 est tellement différent de tous les autres, et
si peu nettement caractérisé, qu’on seroit tenté de le placer dans le règne végétal :
il nous paroît représenter une espèce voisine de l'Alcyonium bursa, Alcyon bourse
de Linné, et se rapproche aussi de la Spongia urceolus de Müller (1). 3. / représente
cette espèce de grandeur naturelle ; 3. 2 , portion de sa surface très - grossie, et
montrant les espèces de petits disques ovalaires qui la garnissent.
La figure 4 est une superbe espèce que nous rapportons avec doute au genre
Alcyonelle, Alcyonella de M. de Lamarck. C e genre Alcyonelle, d’abord confondu
avec les Alcyons, dont il se rapproche beaucoup, en a été distingué avec raison
par M. de Lamarck, qui lui assigne pour caractères: polypier fixé, encroûtant,à
masse épaisse, convexe et irrégulière, constitué par une seule sorte de substance,
et composé de l’agrégation de tubes verticaux, subpentagones, ouverts à leur
sommet; polypes à corps alongé, cylindrique, offrant, à leur extrémité supérieure,
quinze à vingt tentacules droits, disposés autour de la bouche en un
cercle incomplet d’un côté. On ne connoît encore qu’une espèce, l'Alcyonella
Stagnorum, qu’on a trouvée en Europe dans les étangs. L ’espèce qu’a figurée
M. Savigny, et que nous lui dédierons, est évidemment distincte, et ne présente
pas, à beaucoup près, tous les caractères assignés au genre ainsi nous noterons
comme une différence importante la très-petite quantité des tentacules qui sont
au nombre de douze, comme dans les Alcyonidies de M. Lamouroux. Nous ne
croyons pas cependant qu’on doive la rapporter à ce dernier genre. La figure 4-1
montre une masse entière de l'Alcyonella Savignyi adhérente à un corps étranger,
sur lequel on remarque deux coquilles qui paroissent être de petites planorbes :
cette circonstance nous autorise à croire que ce polypier est fluviatile. 4 - 2 , une
portion de la même masse grossie et faisant voir de face des cellules dans lesquelles
sont logés autant de polypes qui en sortent plus ou moins complètement; 4. y ,
fragment de la masse précédente très-grossi et montrant l’organisation des loges
et la forme de l’animal, avec les tentacules rentrés ou saillans; 4- 4> portion de
l ’Alcyonelle de grandeur naturelle, vue par derrière pour montrer comment elle
s’étend; 4. y , partie postérieure ou base de l’Alcyonelle, qui étoit cachée dans la
figure précédente, et dont on voyoit seulement saillir le bord supérieur; 4■ 6,
extrémité supérieure d’un polype, figurée au trait et vue de profil; 4. 7 , 8, y ,
10, 11 et 1 2 , bouche du polype vue de face et avec les différens degrés de développement
des tentacules.
( i ) Zoologia Danica, pi. 1 57, fig. 3.
PLANCHE 4.
P L A N C H E 4 -
MA D R É PO R E S .
| Linné réunissoit sous le nom de Madrépores un grand nombre de polypiers
pierreux, que M. de Lamarck et plusieurs autres zoologistes ont depuis subdivisés
en plusieurs genres très-distincts, dont quelques-uns sont représentés dans les
planches 4 et y.
La figure i paroît appartenir au genre Turbinolie, Turbinolia, caractérisé ainsi
par M. de Lamarck : polypier pierreux, libre, simple, turbiné ou cunéiforme,
pointu a sa base, strié longitudinalement en dehors, et terminé par une cellule
lamellee en etoile, quelquefois oblongue.
i- M. de Lamarck décrit huit espèces, qui toutes sont fossiles. Celle qu’on voit
ici seroit-elle dans ce cas! nous ne saurions le décider; cependant, à en juger
par son état parfait de conservation, on peut la croire vivante. Nous la dédie,
rons à M. Geoffroy Saint-Hilaire, collaborateur de cet ouvrage et professeur au
Jardin du Roi.
L a figure i. / représente la Turbinolia Geoffrqyi, Turbinolie de Geoffroy, de
grandeur naturelle . 1 . 2 montre une lame isolée et très-grossie.
--La figure 2 est une Caryophyllie, Caryophyllia. C e genre a pour caractères :
polypier pierreux, fixé, simple ou rameux; à tige et rameaux subturbinés, striés
longitudinalement et terminés chacun par une cellule lamelfée en étoilé. Les
espèces sont très-nombreuses : celle qu’on voit ici 'offre de grands rapports par la
texture de ses lames avec la Caryophyllia carduiis, Caryophyllie piquante ; mais elle
est simple, et non rameuse. Il faudroit donc, si on la rapportoit à cette espèce,
suppôser quelle est encore jeune, et que plus tard elle se seroit ramifiée. La
figure 2. 1 représente cette espèce de grandeur naturelle ; 2. ¿ paroît être un très-
jeune individu; 2.y offre une coupe longitudinale de l’espèce n.° 2. 1
La figure 3 nous semble appartenir au genre Pociiiopore, Pocillopora, très-
voisin de celui des Porites, et qui s’en distingue par ces caractères : polypier
pierreux, fixé , phytoide, rameux ou lobé; à surface garnie de tous côtés de
cellules enfoncées, ayant les interstices poreux; cellules éparses, distinctes Creusées
en fossette, à bord rarement en saillie et à étoiles peu apparentes, leurs lames
étant étroites et presque nulles. Cette belle espèce nous paroissant nouvelle, nous
la dédierons au général Andréossy, collaborateur de cet ouvrage. La figure 3. 1
lepresente le Pocillopora Andreossyi, Pociiiopore d’Andréossy, de grandeur naturelle
: 3. portion de l’individu précédent, très-grossie; 3. y , coupe verticale
d’une des cellules; 3. 4 , cette cellule vue de face ; 3 . / , autre cellule également
vue de face, et dans laquelle on n’aperçoit pas les cloisons principales, qui sont
peut-être masquées par le polype.
La figure 4 appartient au genre Madrépore proprement dit, Madrepora, auquel
M. de Lamarck reconnoit pour caractères : polypier pierreux, fixé, subdendroïde,
rameux; a surface garnie de tous côtés de cellules saillantes, à interstices poreux-
H .N . TOME L*. 4.“ partie. 5 ’
f g j