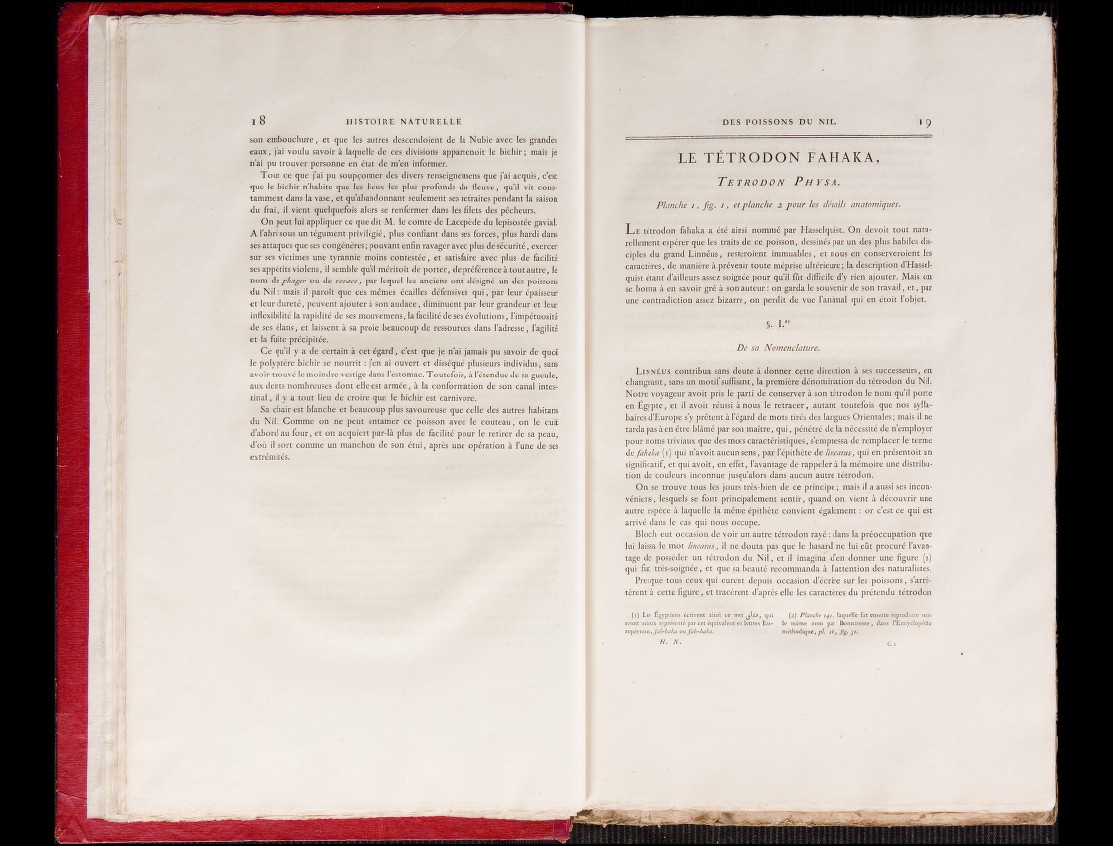
son embouchure, et que les autres descendoient de la Nubie avec les grandes
eaux, j’ai voulu savoir à laquelle de ces divisions appartenoit le bichir ; mais jé
n’ai pu trouver personne en état de m’en informer.
Tout ce que j'ai pu soupçonner des divers renseignemens que j’ai acquis, c’est
que le bichir n’habite que les lieux les plus profonds du fleuve, qu’il vit constamment
dans la vase, et qu’abandonnant seulement ses retraites pendant la saison
du frai, il vient quelquefois alors se renfermer dans les filets des pêcheurs.
On peut lui appliquer ce que dit M. le comte de Lacepède du lepisostée gavial.
A l’abri sous un tégument privilégié, plus confiant dans ses forces, plus hardi dans
ses attaques que ses congénères; pouvant enfin ravager avec plus de sécurité, exercer
sur ses victimes une tyrannie moins contestée, et satisfaire avec plus de facilité
ses appétits violens, il semble qu’il méritoit de porter, de préférence à tout autre, le
nom de phager ou de vorace, par lequel les anciens ont désigné un des poissons
du Nil : mais il paroît que ces mêmes écailles défensives qui, par leur épaisseur
et leur dureté, peuvent ajouter à son audace, diminuent par leur grandeur et leur
inflexibilité la rapidité de ses mouvemens, la facilité de ses évolutions, l’impétuosité
de ses élans, et laissent à sa proie beaucoup de ressources dans l’adresse, l’agilité
et la fuite précipitée.
C e qu’il y a de certain à cet égard, c’est que je n’ai jamais pu savoir de quoi
le polyptère bichir se nourrit ; j’en ai ouvert et disséqué plusieurs individus, sans
avoir trouvé lemoindre vestige dans l’estomac. Toutefois, à l ’étendue de sa gueule,
aux dents nombreuses dont elle est armée, à la conformation de son canal intestinal
, il y a tout lieu de croire que le bichir est carnivore.
Sa chair est blanche et beaucoup plus savoureuse que celle des autres habitans
du Nil. Comme on ne peut entamer ce poisson avec le couteau, on le cuit
d’abord au four, et on acquiert par-là plus de facilité pour le retirer de sa peau,
d’où il sort comme un manchon de son étui, après une opération à l’une de ses
extrémités.
LE T É T R O D O N FAHAKA,
T e t r o d o n P h y s a .
Planche i , Jrg. / , et planche z pour les détails anatomiques.
L e tétrodon fahaka a été ainsi nommé par Hasselquist. On devoit tout naturellement
espérer que les traits de ce poisson, dessinés par un des plus habiles disciples
du grand Linnéus, resteroient immuables, et nous en conserveroient les
caractères, de manière à prévenir toute méprise ultérieure; la description d’Hassel-
quist étant d’ailleurs assez soignée pour qu’il fût difficile d’y rien ajouter. Mais on
se borna à en savoir gré à son auteur : on garda le souvenir de son travail, e t , par
une contradiction assez bizarre, on perdit de vue l’animal qui en étoit l’objet.
§. I ."
D e sa Nomenclature.
L in néus contribua sans doute à donner cette direction à ses successeurs, en
changeant, sans un motif suffisant, la première dénomination du tétrodon du Nil.
Notre voyageur avoit pris le parti de conserver à son tétrodon le nom qu’il porte
en Egypte, et il avoit réussi à nous le retracer, autant toutefois que nos syllabaires
d’Europe s’y prêtent à l’égard de mots tirés des langues Orientales; mais il ne
tarda pas à en être blâmé par son maître, qui, pénétré de la nécessité de n’employer
pour noms triviaux que des mots caractéristiques, s’empressa de remplacer le terme
&& fahaka (i) qui n’avoit aucun sens, par l’épithète de lineatus, qui en présentoit un
significatif, et qui avoit, en effet, l’avantage de rappeler à la mémoire une distribution
de couleurs inconnue jusqu’alors dans aucun autre tétrodon.
On se trouve tous les jours très-bien de ce principe ; mais il a aussi ses incon-
vértiens, lesquels se font principalement sentir, quand on vient à découvrir une
autre espèce à laquelle la même épithète convient également : or c’est ce qui est
arrivé dans le cas qui nous occupe.
Bloch eut occasion de voir un autre tétrodon rayé : dans la préoccupation que
lui laissa le mot lineatus, il ne douta pas que le hasard ne lui eût procuré l’avantage
de posséder un tétrodon du N il, et il imagina d’en donner une figure (2)
qui rut très-soignée, et que sa beauté recommanda à l’attention des naturalistes.
Presque tous ceux qui eurent depuis occasion d’écrire sur les poissons, s’arrêtèrent
à cette figure, et tracèrent d’après elle les caractères du prétendu tétrodon
(1) Les Égyptiens écrivent ainsi ce mot ^ l is , qui (2) Planche 141, laquelle fut ensuite reproduite sous
seroit mieux représenté par cet équivalent en lettres Eu- le même nom par Bonnaterre , dans l’Encyclopédie
royéennes, faft-haka ou fah-haha. . méthodique,^/. ¡6 , fig. p .
H . N . C l