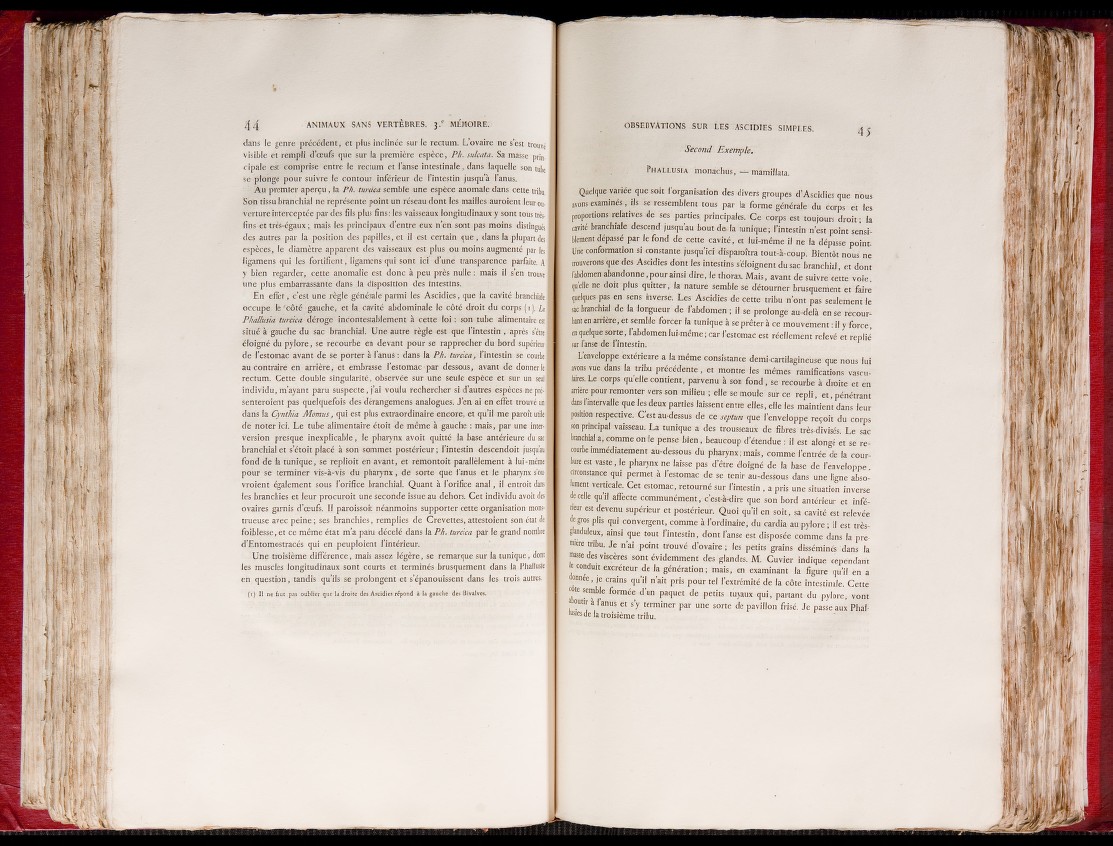
dans le genre précédent, et plus inclinée sur le rectum. L ’ovaire ne s’èst trouvé
visible et rempli d’oeufs que sur la première espèce, P li. sulcata. Sa masse prjn.
cipale est comprise entre le rectum et l’anse intestinale, dans laquelle son tube
Se plonge pour suivre le contour inférieur de l’intestin jusqu’à l’anus.
A u premier aperçu, la Plu turcica semble une espèce anomale dans cette tribu
Son tissu branchial ne représente point un réseau dont les mailles auroient leur ou-
vertureinterceptée par des fils plus fins: les vaisseaux longitudinaux y sont tous très-
fins et très-égaux ; mais les principaux d’entre eux n’en sont pas moins distingues
des autres par la position des papilles, et il est certain que , dans la plupart des
espèces, le diamètre apparent des vaisseaux est plus ou moins augmenté par les
ligamens qui les fortifient, ligamens qui sont ici d’une transparence parfaite. A 1
y bien regarder, cette anomalie est donc à peu près nulle : mais il s’en trouve
une plus embarrassante dans la disposition des intestins.
En e ffet, c’est une règle générale parmi les Ascidies, que la cavité branchiale j
occupe le 'côté gauche, et la cavité abdominale le côté droit du corps ( 1 ). h,
Plialhisia turcica déroge incontestablement à cette loi : son tube alimentaire est
situé à gauche du sac branchial. Une autre règle est que l’intestin , après s’être I
éloigné du pylore, se recourbe en devant pour se rapprocher du bord supérieur
de l’estomac avant de se porter à l’anus : dans la P l. turcica, l’intestin se courbe
au contraire en arrière, et embrasse l’estomac par dessous, avant de donner le
rectum. Cette double singularité, observée sur une seule espèce et sur un seul
individu, m’ayant paru suspecte, j’ai voulu rechercher si d’autres espèces ne pré-
senteroient pas quelquefois des dérangemens analogues. J’en ai en effet trouvé un]
dans la Cynthia Momus, qui est plus extraordinaire encore, et qu’il me paroît utile
de noter ici. Le tube alimentaire étoit de même à gauche : mais, par une interversion
presque inexplicable, le pharynx avoit quitté la base antérieure du sac
branchial et s’étoitplacé à son sommet postérieur; l’intestin descendoit jusqu’au
fond de la tunique, se replioit en avant, et remontoit parallèlement à lui-même
pour se terminer vis-à-vis du pharynx, de sorte que l’anus et le pharynx s’ou-
vroient également sous l’orifice branchial. Quant à l’orifice anal, il entroit dans
les branchies et leur procuroit une seconde issue au dehors. Ce t individu avoit des
ovaires garnis d’oeufs. Il paroissoit néanmoins supporter cette organisation monstrueuse
avec peine; ses branchies, remplies de Crevettes, attestoient son état de
foiblesse, et ce même état m’a paru décelé dans la P l. turcica par le grand nombre
d’Entomostracés qui en peuploient l’intérieur.
Une troisième différence, mais assez légère, se remarque sur la tunique, dont!
les muscles longitudinaux sont courts et terminés brusquement dans la Phallusiej
en question, tandis qu’ils se prolongent et s’épanouissent dans les trois autres. 1
(t) 11 ne faut pas oublier que la droite des Ascidies répond à la gauche des Bivalves.
Second Exemple.
P h a l l u s i a monachus, — mamillata.
Quelque vàriée que soit l’organisation des divers groupes d’Ascidies que nous
avons examinés, ils se ressemblent tous par la forme générale du corps et les
proportions relatives de ses parties, principales. C e corps est toujours droit ; la
cavité branchiale descend jusquau bout de la tunique; l’intestin n’est point sensiblement
dépassé par le fond de cette cavité, et lui-même il ne la dépasse point.
Une conformation si constante jusqu’ici disparoîtra tout-à-coup. Bientôt nous ne
trouverons que des Ascidies dont les intestins s’éloignent du sac branchial, et dont
l’abdomen abandonne, pour ainsi dire, le thorax. Mais, avant de suivre cette voie,
quelle ne doit plus quitter, la nature semble se détourner brusquement et faire
quelques pas en sens inverse. Les Ascidies de cette tribu n’ont pas seulement le
sac branchial de la longueur de 1 abdomen ; il se prolonge au-delà en se recourbant
en arrière, et semble forcer la tunique à se prêter à ce mouvement : il y force,
en quelque sorte, 1 abdomen lui-même ; car l’estomac est réellement relevé et replié
sur l’anse de l’intestin.
L’enveloppe extérieure a la même consistance demi-cartilagineuse que nous lui
avons vue dans la tribu précédente, et montre les mêmes ramifications vasculaires.
Le corps qu’elle contient, parvenu à son fond, se recourbe à droite et en
arrière pour remonter vers son milieu ; elle se moule sur ce repli, e t, pénétrant
dans l’intervalle que les deux parties laissent entre elles, elle les maintient dans leur
position respective. C est au-dessus de ce septum que l’enveloppe reçoit du corps
sôn principal vaisseau. La tunique a des trousseaux de fibres très-divisés. Le sac
branchial a, comme on le pense bien, beaucoup d’étendue : il est alongé et se recourbe
immédiatement au-dessous du pharynx; mais, comme l’entrée de la courbure
est vaste, le pharynx ne laisse pas d’être éloigné de la base de l’enveloppe,
circonstance qui permet à l’estomac de se tenir au-dessous dans une ligne abso-
ument verticale. Cet estomac, retourné sur l’intestin , a pris une situation inverse
de celle qu’il affecte communément, c’est-à-dire que son bord antérieur et infé-
neur est devenu supérieur et postérieur. Quoi qu’il en soit, sa cavité est relevée
de gros plis qui convergent, comme à l’ordinaire, du cardia au pylore; il est très-
ganduleux, ainsi que tout l’intestin, dont l’anse est disposée comme dans la première
tribu. Je n’ai point trouvé d’ovaire ; les petits grains disséminés dans la
masse des viscères sont évidemment des glandes. M. Cuvier indique cependant
e conduit excréteur de la génération ; mais, en examinant la figure qu’il en a
onnee, je crains qu’il n’ait pris pour tel l’extrémité de la côte intestinale. Cette
c te semble formée d’un paquet de petits tuyaux qui, partant du pylore, vont
à 1 anus et s’y terminer par une sorte de pavillon frisé. Je passe aux Phal-
lusies de la troisième tribu.