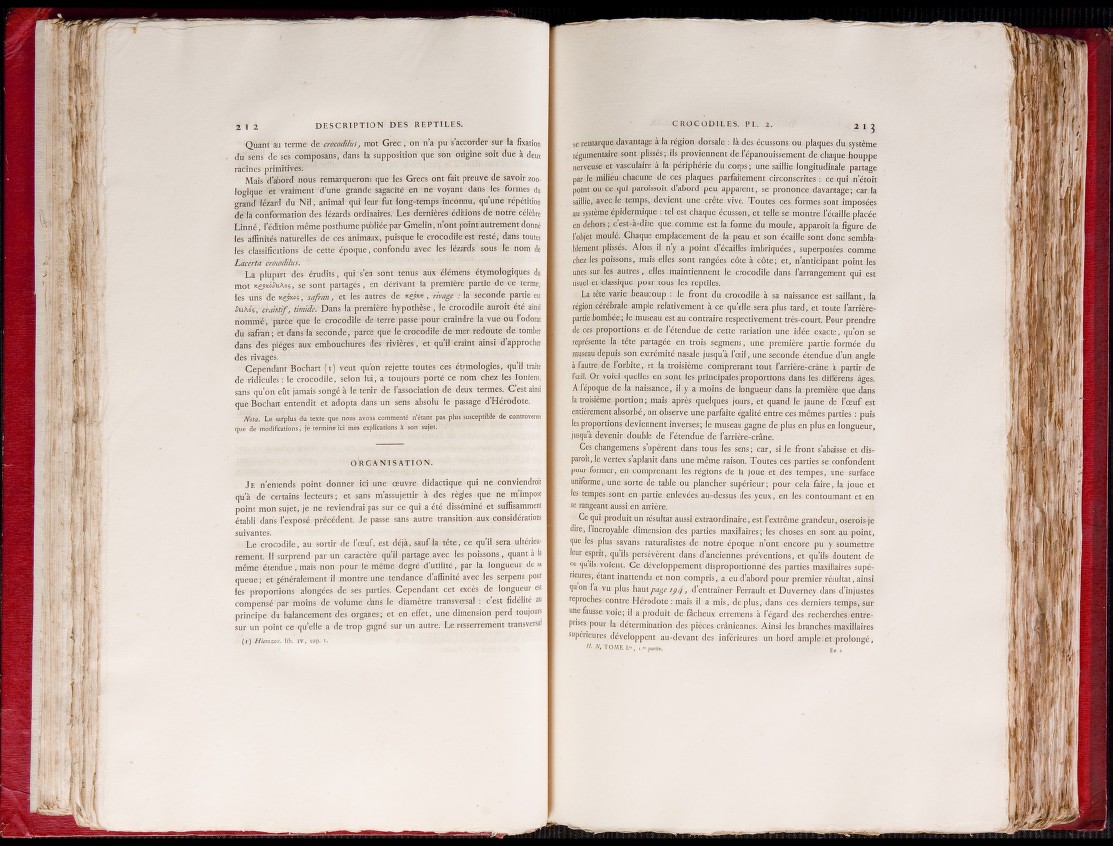
Quant au terme de crocodilus, mot Grec , on n a pu s accorder sur la fixation
du sens de ses composans, dans la supposition que son origine soit due à deux
racines primitives.
Mais d’abord nous remarquerons que les Grecs ont fait preuve de savoir zoologique
et vraiment d’une grande sagacité en ne voyant dans les formes du
grand lézard du N il, animal qui leur fut long-temps inconnu, qu’une répétition
de la conformation des lézards ordinaires. Les dernières éditions de notre célèbre
Linné, l’édition même posthume publiée par Gmelin, n’ont point autrement donné
les affinités naturelles de ces animaux, puisque le crocodile est resté, dans toutes
les classifications de cette époque, confondu avec les lézards sous le nom de
Lacerta crocodilus.
La plupart des érudits, qui s’en sont tenus aux élémens étymologiques du
mot k& xîSiiMs, se sont partagés , en dérivant la première partie de ce terme,
les uns de , safran, et les autres de xfiyxti , rivage : la seconde partie est
itiAo's, craintif, timide. Dans la première hypothèse , le crocodile auroit été ainsi
nommé, parce que le crocodile de terre passe pour craindre la vue ou l’odorat
du safran; et dans la seconde, parce que le crocodile de mer redoute de tomber
dans des pièges aux embouchures des rivières, et qu’il craint ainsi d’approcher
des rivages.
Cependant Bochart (t) veut qu’on rejette toutes ces étymologies, qu’il traite
de ridicules : le crocodile, selon lui, a toujours porté ce nom chez les Ioniens,
sans qu’on eût jamais songé à le tenir de l’association de deux termes. Ce st ainsi
que Bochart entendit et adopta dans un sens absolu le passage d’Hérodote.
Nota. Le surplus du texte que nous avons commenté n’étant pas plus susceptible de controverses
que de modifications, je termine ici mes explications à son sujet.
O R G A N I S A T I O N .
J e n’entends point donner ici une oeuvre didactique qui ne conviendroit
qu’à de certains lecteurs; et sans m’assujettir à des règles que ne m’impose
point mon sujet, je ne reviendrai pas sur ce qui a été disséminé et suffisamment
établi dans l’exposé, précédent. Je passe sans autre transition aux considérations
suivantes.
L e crocodile, au sortir de l’oeuf, est déjà, sauf la tête, ce qu’il sera ultérieurement.
Il surprend par un caractère qu’il partage avec les poissons, quant à la
même étendue, mais non pour le même degré d’utilité, par la longueur de sa
queue ; et généralement il montre une tendance d’affinité avec les serpens pour
les proportions alongées de ses parties. Cependant cet excès de longueur est
compensé par moins de volume dans le diametre transversal t cest fidélité nu
principe du balancement des organes; et en effet, une dimension perd toujours
sur un point ce qu’elle a de trop gagné sur un autre. Le resserrement transversal
( i ) H ie ro zo ic . lib . I V , cap . i .
se remarque davantage à la région dorsale : là des écussons ou plaques du système
tégumentaire sont plissés ; ils proviennent de l’épanouissement de chaque houppe
nerveuse et vasculaire a la périphérie du corps; une saillie longitudinale partage
par le milieu chacune de ces plaques parfaitement circonscrites : ce qui n’étoit
point ou ce qui paroissoit dabord peu apparent, se prononce davantage; car ia
saillie, avec le temps, de vient une crête vive. Toutes ces formes sont imposées
au système épidermique : tel est chaque écusson, et telle se montre lecailleplacée
en dehors ; c’est-à-dire que. comme est la forme, du moule, apparoît la figure de
l’objet moulé. Chaque emplacement de la peau et son écaille sont donc sembla-
blement plissés. Alors il n’y a point d’écailles imbriquées, superposées comme
chez les poissons, mais elles sont rangées côte à côte; et, n’anticipant point les
unes sur les autres, elles maintiennent le crocodile dans l’arrangement qui est
lisuel et classique pour tous les reptiles.
La tete varie beaucoup : le front du crocodile à sa naissance est saillant, la
région cérébrale ample relativement à ce qu’elle sera plus tard, et toute l’arrière-
partie bombée ; le museau est au contraire respectivement très-court. Pour prendre
de ces proportions et de 1 étendue de cette variation une idée exacte, qu’on se
représente la tete partagée en trois segmens, une première partie formée du
museau depuis son. extremite nasale jusqu à loe il, une seconde étendue d’un angle
a l autre de 1 orbite,, et la troisième comprenant tout l’arrière-crâne à partir de
l’oeil. Or voici quelles en sont les principales proportions dans les différens âges.
A l’époque de la naissance, il y a moins de longueur dans la première que dans
la troisième portion; mais après quelques jours, et quand le jaune de l’oeuf est
entièrement absorbe, on observe une parfaite égalité entre ces mêmes parties : puis
les proportions deviennent inverses; le museau gagne de plus en plus en longueur,
jusqu à devenir double de l’étendue de l’arrière-crâne.
Ces changemens s opèrent dans tous les sens; car, si le front s’abaisse et dis-
paroît, le vertex s aplanit dans une même raison. Toutes ces parties se confondent
pour former, en comprenant les régions de la joue et des tempes, une surface
uniforme, une sorte de table ou plancher supérieur; pour cela faire, la joue et
les tempes.sont en partie enlevées au-dessus des yeux, en les contournant et en
se rangeant aussi en arrière.
Ce qui produit un résultat aussi extraordinaire, est l’extrême grandeur, oserois-je
dire, 1 incroyable dimension des parties maxillaires; les choses en sont au point,
que les plus savans naturalistes de notre époque n’ont encore pu y soumettre
leur esprit, quils persévèrent dans d’anciennes préventions, et qu’ils- doutent de
ce quils.voient. Ce développement disproportionné des parties maxillaires supérieures,
étant inattendu et non compris, a eu d’abord pour premier résultat, ainsi
quon la vu plus haut page iÿ4 > d’entraîner Perrault et Duverney. dans d’injustes
reproches contre Hérodote : mais il a mis, de plus., dans ces derniers temps, sur
une fauise voie; il a produit de fâcheux erremens à l’égard des recherches entreprises
pour la détermination des pièces crâniennes. Ainsi les branches maxillaires
supérieures développent au-devant des inférieures un bord ample:et prolongé,
n. N, TOME I.», partie. E . .