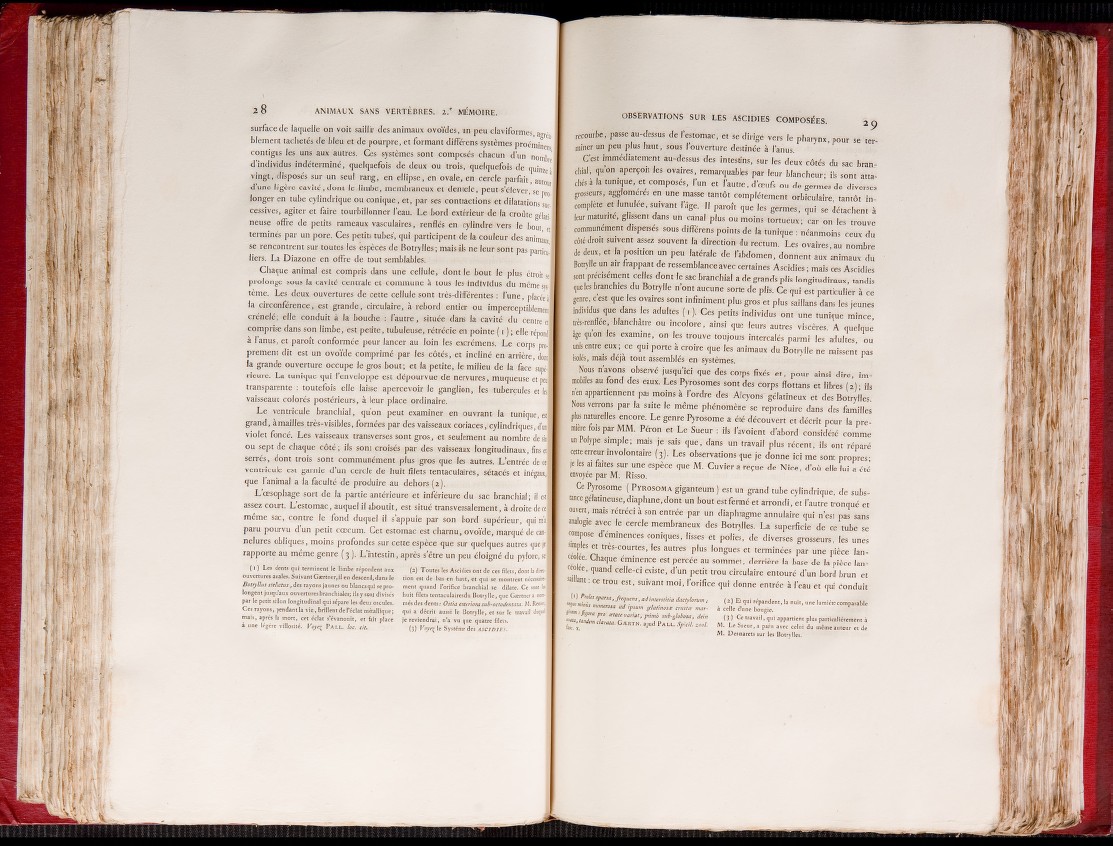
ANIMAUX SAN S V E R T E B R E S . 2 . ' MEMOIRE.
surface de laquelle on voit saillir des animaux ovoïdes, un peu claviformes
blement tachetés de bleu et de pourpre, et formant différens systèmes proéminen
contigus les uns aux autres. Ces systèmes sont composés chacun d’un nonit/
dindividus indéterminé, quelquefois de deux ou trois, quelquefois de quinge'
vingt, disposés sur un seul rang, en ellipse, en ovale, en cercle parfait autou
d une legere cavité, dont le limbe, membraneux et dentelé, peut s’élever, se n
longer en tube cylindrique ou conique, et, par ses contractions et dilatations suc
cessives, agiter et faire tourbillonner 1 eau. Le bord extérieur de la croûte gélatj
neuse offre de petits rameaux vasculaires, renflés en cylindre vers le bout e I
terminés par un pore. Ces petits tubes, qui participent de la couleur des animai
se rencontrent sur toutes les espèces de Botrylles; mais-ils ne leur sont pas H § 1
liers. La Diazone en offre de tout semblables.
Chaque animal est compris dans une cellule, dont le bout le plus étroit se
prolonge sous la cavité centrale et commune à tous les individus du même sys j
tème. Les deux ouvertures de cette cellule sont très-différentes : l’une, placée il
la circonférence, est grande, circulaire, à rebord entier ou imperceptiblement!
crénelé ; elle conduit à la bouche : l’autre, située dans la cavité du centre ctl
comprise dans son limbe, est petite, tubuleuse, rétrécie en pointe ( i ) ; elle répondl
à lanus, et paroît conformée pour lancer au loin les excrémens. Le corps pro-l
prement dit est un ovoïde comprimé par les côtés, et incliné en arrière, dontl
la grande ouverture occupe le gros bout; et la petite, le milieu de la face supél
rieure. La tunique qui l’enveloppe est dépourvue de nervures, muqueuse et peJ
transparente : toutefois elle laisse apercevoir le ganglion, les tubercules et leJ
vaisseaux colorés postérieurs, à leur place ordinaire.
Le ventricule branchial, qu’on peut examiner en ouvrant la tunique, esta
grand, à mailles très-visibles, formées par des vaisseaux coriaces, cylindriques, d’uni
violet foncé. Les vaisseaux transverses sont gros, et seulement au nombre desixl
ou sept de chaque coté ; ils sont croisés par des vaisseaux longitudinaux, fins et|
serrés, dont trois sont communément plus gros que les autres. L ’entrée de ct|
ventricule est garnie d’un cercle de huit filets tentaculaires, sétacés et inégauil
que 1 animal a la faculté de produire au dehors (2).
L ’oesophage sort de la partie antérieure et inférieure du sac branchial ; il est|
assez court. L estomac, auquel il aboutit, est situé transversalement, à droite de ce|
meme sac, contre le fond duquel il s’appuie par son bord supérieur, qui mal
paru pourvu d un petit coecum. Cet estomac est charnu, ovoïde, marqué de can-l
nelures obliques, moins profondes sur cette espèce que sur quelques autres que jel
rapporte au meme genre (3 ). L intestin, après s’être un peu éloigné du pylore, sel
( 1 ) Les dents qui terminent ie limbe répondent aux (2) Toutes les Ascidies ont de ces filets, dont [a direc-B
ouvertures anales. Suivant Gaîrtner,il en descend, dans le tion est de bas en haut, et qui se montrent nécessairc-H
Bolryllus ï!füi<n.‘S, des rayons j au.ors ou blancs qui se pro- ment quand l'orifice branchial se dilate. Ce sont lnfl
longent jusqu aux ouvertures branchiales; ils y son; divisés huit filets tentaculaires du Botrylle, que Gærtner a nom- I
par le petit sillon longitudinal qui sépare les deux oscules. mes des dents : Ostia exteriora sub-octodcntata. M. Renie,I
Ces rayons, pendantla vie, brillentdel'éclat métallique; qui a décrit aussi le Botrylle, et sur le travail duquel I
mats, après la tnort, cet éclat s’évanouit, et fait place je reviendrai, n’a vu que quatre filets,
à une légère villosité. Kqyrj P a l l . lac. cit. (3) Koyaj le Système des a s c id ie s .
O B S E R V A T IO N S SU R LE S A S C ID IE S COM PO SÉ E S -> n
, ’ “
recourbe, passe au-dessus de 1 estomac, et se dirige vers le pharynx, pour se terminer
un peu plus haut, sous l’ouverture destinée à l’anus.
C’est immédiatement au-dessus des intestins, sur les deux côtés du sac branchial,
quon aperçoit les ovaires, remarquables par leur blancheur; ils sont attachés
à la tunique, et composés, l’un et l’autre, d’oeufs ou de germes de diverses
grosseurs, agglomérés en une masse tantôt complètement orbiculaire tantôt incomplète
et lunulee, suivant l’âge. Il paroît que les germes, qui se détachent à
leur maturité, glissent dans un canal plus ou moins tortueux; car on les trouve
communément dispersés sous différens points de la tunique : néanmoins ceux du
côté droit suivent assez souvent la direction du rectum. Les ovaires, au nombre
Je deux, et la position un peu latérale de l’abdomen, donnent aux animaux du
Botrylle un air frappant de ressemblance avec certaines Ascidies ; mais ces Ascidies
sont précisément celles dont le sac branchial a de grands plis longitudinaux, tandis
rpeles branchies du Botrylle n’ont aucune sorte de plis. Ce qui est particulier à ce
genre, c est que les ovaires sont infiniment plus gros et plus saillans dans les jeunes
individus que dans les adultes ( , ). Ces petits individus ont une tunique mince
tres-renflée, blanchâtre ou incolore, ainsi que leurs autres viscères A quelque
âge quon les examine, on les trouve toujours intercalés parmi les adultes, ou
unis entre eux; ce qui porte à croire que les animaux du Botrylle ne naissent pas
isolés, mais déjà tout assemblés en systèmes.
Nous n’avons observé jusqu’ici que des corps fixés e t, pour ainsi dire, immobiles
au fond des eaux. Les Pyrosomes sont des corps flottans et libres (z)- ils
n’en appartiennent pas moins à l’ordre des Alcyons gélatineux et des Botrylle?.
Nous verrons par la suite le même phénomène se reproduire dans des familles
plus naturelles encore. Le genre Pyrosome a été découvert et décrit pour la première
fois par MM. Péron et L e Sueur : ils l’avoient d’abord considéré comme
un Polype simple; mais je sais que, dans un travail plus récent, ils ont réparé
cette erreur involontaire (3). Les observations que je donne ici me sont propres;
Ie 31 faites sur une espèce que M. Cuvier a reçue de Nice, d’où elle lui a été
envoyée par M. Risso.
Ce Pyrosome ( P v r o s o m a giganteum ) est un grand tube cylindrique, de substance
gelatmeuse, diaphane, dont un bout est fermé et arrondi, et l’autre tronqué et
ouvert, mais rétréci à son entrée par un diaphragme annulaire qui n’est pas sans
analogie avec le cercle membraneux des Botrylles. La superficie de ce tube se
compose d’éminences coniques, lisses et polies, de diverses grosseurs, les unes
amples et très-courtes, les autres plus longues et terminées par une pièce lancée
ee. Chaque éminence est percée au sommet, derrière la base de la pièce lancéejee,
quand celle-ci existe, d’un petit trou circulaire entouré d’un bord brun et
saillant: ce trou est, suivant moi, l’orifice qui donne entrée à l’eau et qui Conduit
) . roj es sParsa > frequens, ad interstitia dactylorïim ;
nque minus numerosa ad ipsum gelafinosoe crustoe mar-
S figura pro «tate variai, primo sub-olobosa, dein
clavata' G æ r t n . ?pu.d P a l l . Spicil. zool.
(2) Et qui répandent, la nuit, une lumière comparable
a celle d’une bougie.
(3 ) Ce travail, qui appartient plus particulièrement à
M. Le Sueur, a paru avec celui du même auteur et de
M. Desmarets sur les Botrylles.