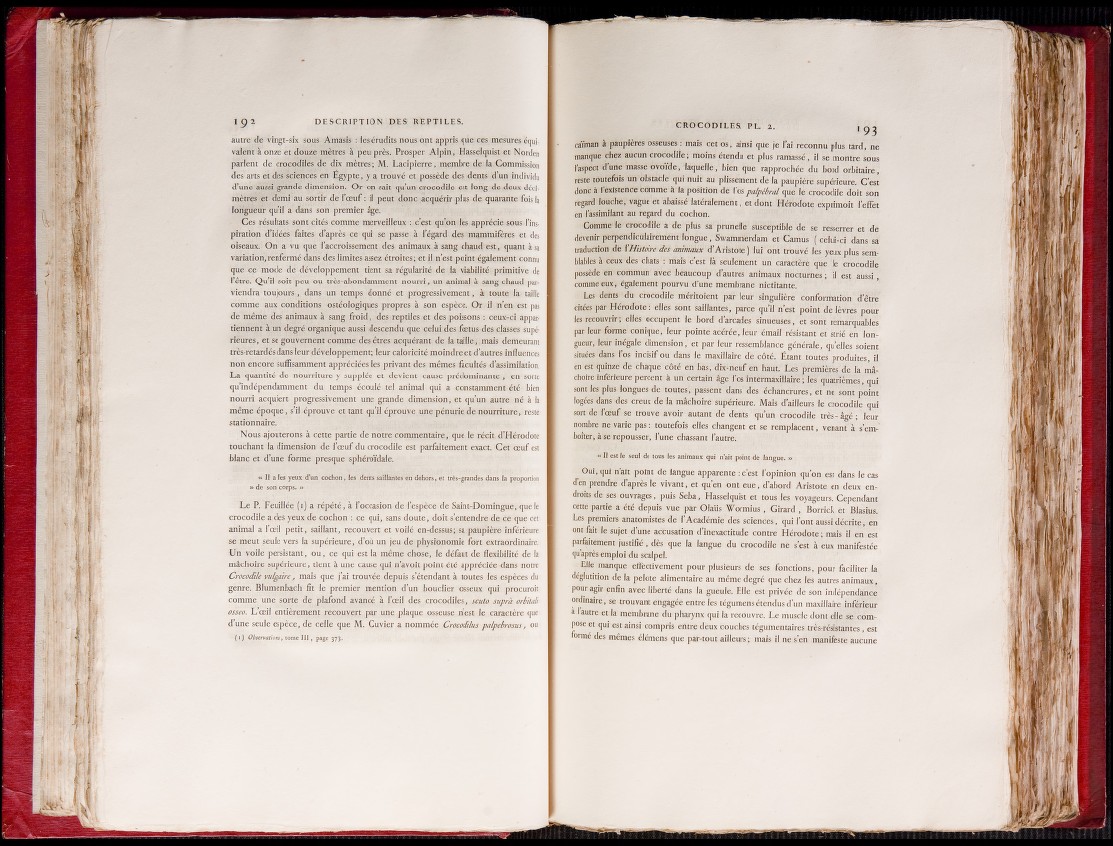
autre de vingt-six sous Amasis : les érudits nous ont appris que ces mesures équivalent
à onze et douze mètres à peu près. Prosper Alpin, Hasselquist et Norden
parlent de crocodiles de dix mètres ; M. Lacipierre, membre de la Commission
des arts et des sciences en Egypte, y a trouvé et possède des dents d’un individu
d’une aussi grande dimension. Or on sait qu’un crocodile est long de deux décimètres
et demi au sortir de l’oe uf : il peut donc acquérir plus de quarante fois la
longueur qu’il a dans son premier âge.
Ces résultats sont cités comme merveilleux : c’est qu’on les apprécie sous l’inspiration
d’idées faites d’après ce qui se passe à l’égard des mammifères et des
oiseaux. On a vu que l’accroissement des animaux à sang chaud est, quant à sa
variation,renfermé dans des limites assez étroites; et il n’est point également connu
que ce mode de développement tient sa régularité de la viabilité primitive de
l’être. Qu’il soit peu ou très-abondamment nourri, un animal à sang chaud parviendra
toujours , dans un temps donné et progressivement, à toute la taille
comme aux conditions ostéologiques propres à son espèce. Or il n’en est pas
de même des animaux à sang fro id , des reptiles et des poissons : ceux-ci appartiennent
à un degré organique aussi descendu que celui des foetus des classes supérieures,
et se gouvernent comme des êtres acquérant de la taille, mais demeurant
très-retardés dans leur développement; leur caloricité moindre et d’autres influences
non encore suffisamment appréciées les privant des mêmes facultés d’assimilation.
L a quantité de nourriture y supplée et devient cause prédominante, en sorte
qu’indépendamment du temps écoulé tel animal qui a constamment été bien
nourri acquiert progressivement une grande dimension, et qu’un autre né à la
même époque, s’il éprouve et tant qu’il éprouve une pénurie de nourriture, reste
stationnaire.
Nous ajouterons à cette partie de notre commentaire, que le récit d’Hérodote
touchant la dimension de l’oeuf du crocodile est parfaitement exact. Cet oeuf est
blanc et d’une forme presque sphéroïdale.
« II a les yeux d’un cochon, les dents saillantes en dehors, et très-grandes dans la proportion
» de son corps. »
L e P. Feuillée (i) a répété, à l’occasion de l’espèce de Saint-Domingue, que le
crocodile a des yeux de cochon : ce qui, sans doute, doit s’entendre de ce que cet
animal a l’oeil petit, saillant, recouvert et voilé en-dessus; sa paupière inférieure
se meut seule vers la supérieure, d’où un jeu de physionomie fort extraordinaire.
Un voile persistant, ou, ce qui est la même chose, le défaut de flexibilité de la
mâchoire supérieure, tient à une cause qui n’avoit point été appréciée dans notre
Crocodile vulgaire, mais que j’ai trouvée depuis s’étendant à toutes les espèces du
genre. Blumenbach fit le premier mention d’un bouclier osseux qui procuroit
comme une sorte de plafond avancé à l’oeil des crocodiles, scuto suprà orlitali
osseo. Loe il entièrement recouvert par une plaque osseuse n’est le caractère que
d’une seule espèce, de celle que M. Cuvier a nommée Crocodilus palpebrosus, ou
( i ) Observations, tome I I I , page 373.
caïman à paupières osseuses : mais cet os, ainsi que je l’ai reconnu plus tard, ne
manque chez aucun crocodile ; moins étendu et plus ramassé, il se montre sous
l’aspect d’une masse ovoïde, laquelle, bien que rapprochée du bord orbitaire,
reste toutefois un obstacle qui nuit au plissement de la paupière supérieure. C ’est
donc a 1 existence comme à la position de I os palpcbral que le crocodile doit son
regard louche, vague et abaissé latéralement, et dont Hérodote exprimoit l’effet
en l’assimilant au regard du cochon.
Comme le crocodile a de plus sa prunelle susceptible de se resserrer et de
devenir perpendiculairement longue, Swammerdam et Camus ( celui-ci dans sa
traduction dé 1 Histoire des animaux d’Aristote ) lui ont trouvé les yeux plus semblables
à ceux des chats : mais c’est là seulement un caractère que le crocodile
possédé en commun avec beaucoup d autres animaux nocturnes ; il est aussi,
comme eux, également pourvu d’une membrane nictitante.
Les dents du crocodile meritoient par leur singulière conformation d’être
citées par Hérodote ; elles sont saillantes, parce qu’il n’est point de lèvres pour
les recouvrir, elles occupent Je bord d arcades sinueuses, et sont remarquables
par leur forme conique, leur pointe acérée, leur émail résistant et strié en longueur,
leur inégale dimension, et par leur ressemblance générale, qu’elles soient
situées dans l’os incisif ou dans le maxillaire de côté. Étant toutes produites, il
en est quinze de chaque coté en bas, dix-neuf en haut. Les premières de la mâchoire
inférieure percent a un certain âge l’os intermaxillaire; les quatrièmes, qui
sont les plus longues de toutes, passent dans des échancrures, et ne sont point
logées dans des creux de la mâchoire supérieure. Mais d’ailleurs le crocodile qui
sort de l’oeuf se trouve avoir autant de dents qu’un crocodile très - âgé ; leur
nombre ne varie pas : toutefois elles changent et se remplacent, venant à s’emboîter,
à se repousser, l’une chassant l’autre.
« II est le seul de tous les animaux qui n’ait point de langue. »
^ Oui, qui n’ait point de langue apparente : c’est l’opinion qu’on est dans le cas
d’en prendre d’après le vivant, et qu’en ont eue, d’abord Aristote en deux endroits
de ses ouvrages, puis Seba, Hasselquist et tous les voyageurs. Cependant
cette partie a été depuis vue par Olaüs Wormius , Girard , Borrick et Blasius.
Les premiers anatomistes de l’Académie des sciences, qui l’ont aussi décrite, en
ont fait le sujet d’une accusation d’inexactitude contre Hérodote ; mais il en est
parfaitement justifié , dès que la langue du crocodile ne s’est à eux manifestée
qu après emploi du scalpel.
Elle manque effectivement pour plusieurs de ses fonctions, pour faciliter la
déglutition de la pelote alimentaire au même degré que chez les autres animaux,
pour agir enfin avec liberte dans la gueule. Elle est privée de son indépendance
ordinaire, se trouvant engagée entre les tégumens étendus d’un maxillaire inférieur
a 1 autre et la membrane du pharynx qui la recouvre. Le muscle dont elle se compose
et qui est ainsi compris entre deux couches tégumentaires très-résistantes, est
ormé des mêmes élémens que par-tout ailleurs ; mais il ne s’en manifeste aucune