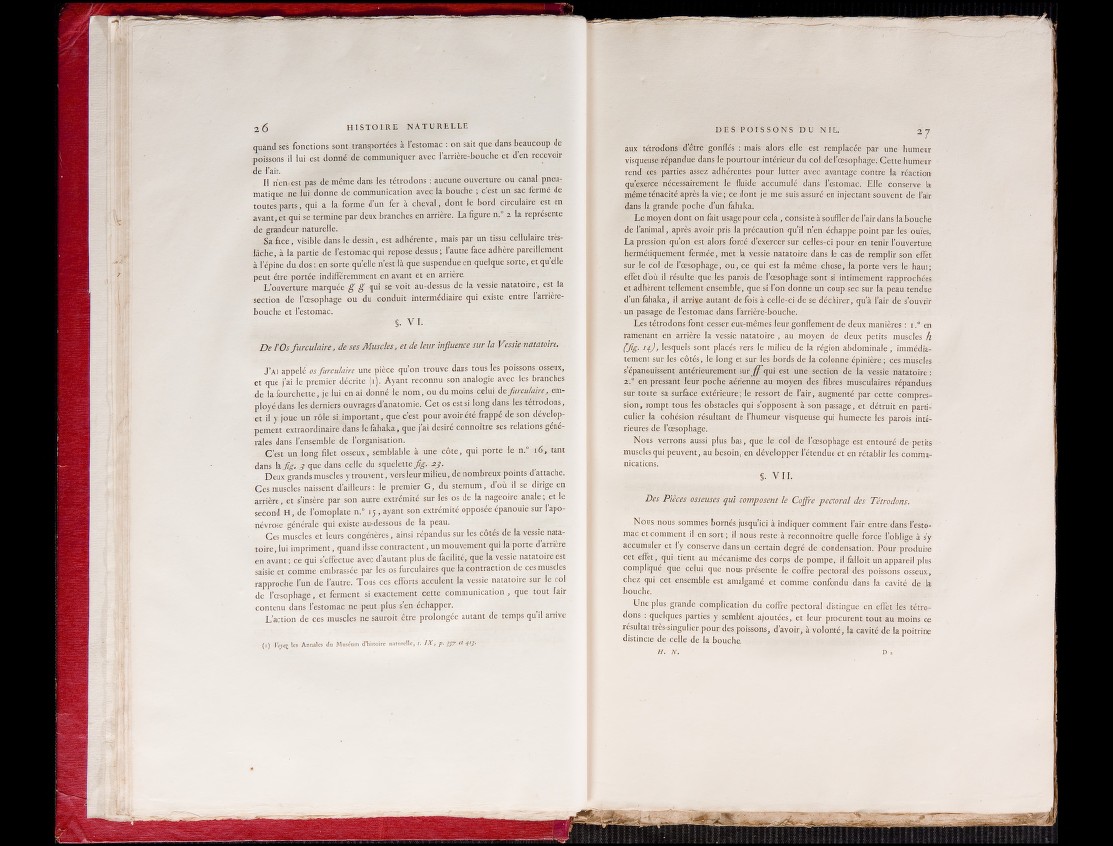
quand ses fonctions sont transportées à l’estomac : on sait que dans beaucoup de
poissons il lui est donné de communiquer avec l’arrière-bouche et d’en recevoir
de l’air. , .
Il n’en est pas de même dans les tétrodons : aucune ouverture ou canal pneumatique
ne lui donne de communication avec la bouche ; c’est un sac fermé de
toutes parts, qui a la forme d’un fer à cheval, dont le bord circulaire est en
avant, et qui se termine par deux branches en arrière. La figure n.° 2 la représente
de grandeur naturelle.
Sa la c e , visible dans le dessin a est adhérente, mais par un tissu cellulaire très-
lâche, à la partie de l’estomac qui repose dessus; 1 autre face adhéré pareillement
à l’épine du dos : en sorte qu elle n’est là que suspendue en quelque sorte, et qu elle
peut être portée indifféremment en avant et en arrière.
L ’ouverture marquée § qui se voit au-dessus de la vessie natatoire, est la
section dé l’oesophage ou du conduit intermédiaire qui existe entre 1 arriere-
bouche et l’estomac.
§. V I .
D e VOs fu rcu la ire, de ses M uscles, et de leur influence sur la Vessie natatoire.
J ’ai appelé os furculaire une pièce qu’on trouve dans tous les poissons osseux,
et que j’ai le premier décrite (i). Ayant reconnu son analogie avec les branches
de la fourchette, je lui en ai donné le nom, ou du moins celui dt furculaire, employé
dans les derniers ouvrages d’anatomie. C e t os est si long dans les tétrodons,
et il y joue un rôle si important, que c’est pour avoir ete frappe de son développement
extraordinaire dans le fahaka, que j’ai désiré connoître ses relations générales
dans l’ensemble de l’organisation.
C ’est un long filet osseux, semblable à une côte, qui porte le n.° 16 , tant
dans la flg . 3 que dans celle du sq u e le tte^ . 23.
Deux grands muscles y trouvent, vers leur milieu, de nombreux points d’attache.
Ces muscles naissent d’ailleurs : le premier G , du sternum, d’où il se dirige en
arrière, et s’insère par son autre extrémité sur les os de la nageoire anale, et le
second H, de l’omoplate n.“ 15 , ayant son extrémité opposée épanouie sur l’aponévrose
générale qui existe au-dessous de la peau.
Ces muscles et leurs congénères, ainsi répandus sur les côtés de la vessie natatoire,
lui impriment, quand ils se contractent, un mouvement qui la porte d arrière
en avant ; ce qui s’effectue avec d’autant plus de facilité, que la vessie natatoire est
saisie et comme embrassée par les os fùrculaires que la contraction de ces muscles
rapproche l’un de l’autre. Tous ces efforts acculent la vessie natatoire sur le col
de l’oesophage, et ferment si exactement cette communication , que tout l’air
contenu dans l’estomac ne peut plus s’en échapper.
L ’a ctio n de ces muscles ne sauroit être prolongée au tan t de temps qu il arrive
(1) B É É les Annales du Muséum d'histoire naturelle, t. I X , p ' et 4 ’J'
aux tétrodons d’être gonflés : mais alors elle est remplacée par une humeur
visqueuse répandue dans le pourtour intérieur du col de l’oesophage. Cette humeur
rend ces parties assez adhérentes pour lutter avec avantage contre la réaction
qu’exerce nécessairement le fluide accumulé dans l’estomac. Elle conserve la
même ténacité après la vie ; ce dont je me suis assuré en injectant souvent de l’air
dans la grande poche d’un fàhaka.
Le moyen dont on fait usage pour ce la , consiste à souffler de l’air dans la bouche
de l’animal, après avoir pris la précaution qu’il n’en échappe point par les ouïes.
La pression qu’on est alors forcé d’exercer sur celles-ci pour en tenir l’ouverture
hermétiquement fermée, met la vessie natatoire dans le cas de remplir son effet
sur le col de l’oesophage, ou, ce qui est la même chose, la porte vers le haut;
effet d’où il résulte que les parois de l’oesophage sont si intimement rapprochées
et adhèrent tellement ensemble, que si l’on donne un coup sec sur la peau tendue
d’un fàhaka, il arrive autant de fois à celle-ci de se déchirer, qu’à l’air de s’ouvrir
■ un passage de l’estomac dans l’arrière-bouche.
Les tétrodons font cesser eux-mêmes leur gonflement de deux manières : 1 en
ramenant en arrière la vessie natatoire , au moyen de deux petits muscles h
(fig. 1 4 ), lesquels sont placés vers le milieu de la région abdominale , immédiatement
sur les côtés, le long et sur les bords de la colonne épinière ; ces muscles
s’épanouissent antérieurement sur f f qui est une section de la vessie natatoire :
2.° en pressant leur poche aérienne au moyen des fibres musculaires répandues
sur toute sa surface extérieure; le ressort de l’air, augmenté par cette compression,
rompt tous les obstacles qui s’opposent à son passage, et détruit en particulier
la cohésion résultant de l’humeur visqueuse qui humecte les parois intérieures
de l’oesophage.
Nous verrons aussi plus bas, que le col de l’oesophage est entouré de-petits
muscles qui peuvent, au besoin, en développer l’étendue et en rétablir les communications.
s. V I I .
Des Pièces osseuses qui composent le Coflre pectoral des Tétrodons.
Nous nous sommes bornés jusqu’ici à indiquer comment l’air entre dans l’estomac
et comment il en sort ; il nous reste à reconnoître quelle force l’oblige à s’y
accumuler et ly conserve dans un certain degré de condensation. Pour produire
cet effet, qui tient au mécanisme des corps de pompe, il fklloit un appareil plus
compliqué que celui que nous présente le coffre pectoral des poissons osseux,
chez qui cet ensemble est amalgamé et comme confondu dans la cavité de la
bouche.
Une plus grande complication du coffre pectoral distingue en effet les tétrodons
: quelques parties y semblent ajoutées, et leur procurent tout au moins ce
résultat très-singulier pour des poissons, d’avoir, à volonté, la cavité de la poitrine
distincte de celle de la bouche.
H . N . D >
I . ï t :i f i s ? i l l f;111 É l L i n i l 11 i-1 sim U f W i l r i l l i J i l i i i