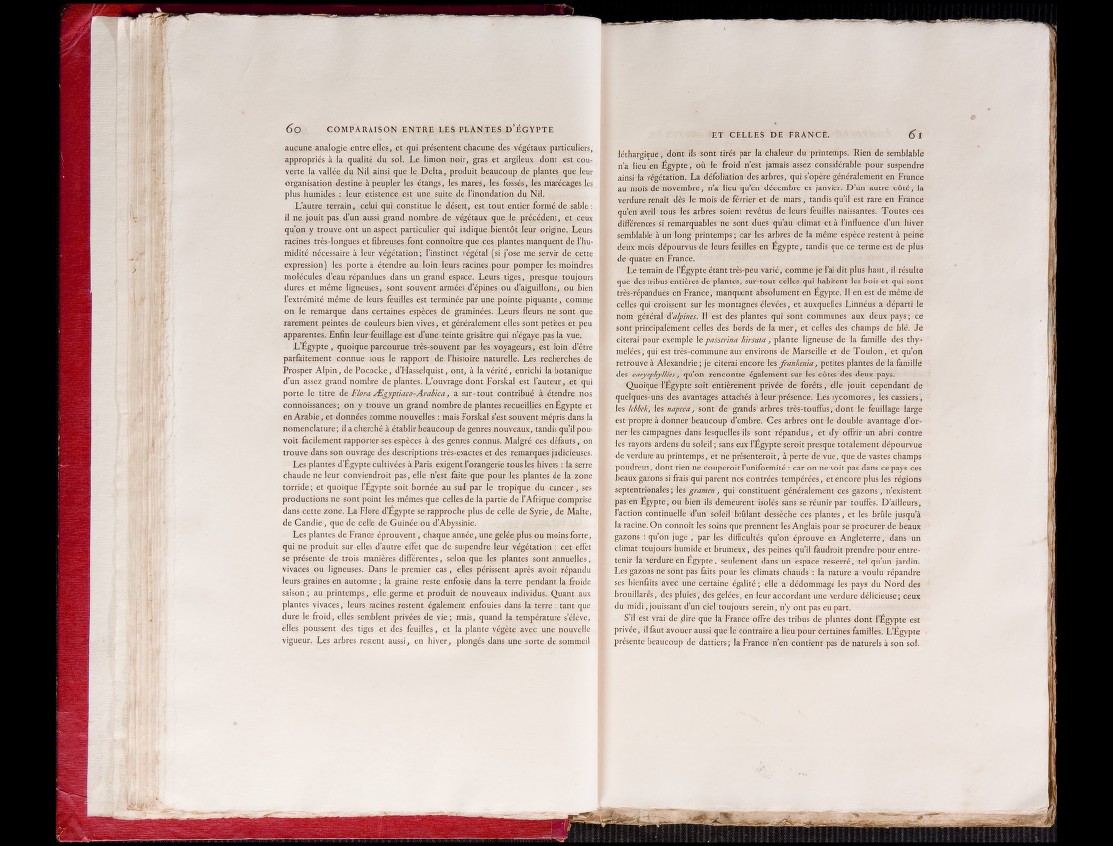
aucune analogie entre elles, et qui présentent chacune des végétaux particuliers,
appropriés à la qualité du sol. Le limon noir, gras et argileux dont est couverte
la vallée du Nil ainsi que le Delta, produit beaucoup de plantes que leur
organisation destine à peupler les étangs, les mares, les fossés, les marécages les
plus humides : leur existence est une suite de l’inondation du Nil.
L ’autre terrain, celui qui constitue le désert, est tout entier formé de sable:
il ne jouit pas d’un aussi grand nombre de végétaux que le précédent, et ceux
qu’on y trouve ont un aspect particulier qui indique bientôt leur origine. Leurs
racines très-longues et fibreuses font connoître que ces plantes manquent de l’humidité
nécessaire à leur végétation; l’instinct végétal (si j’ose me servir de cette
expression) les porte à étendre au loin leurs racines pour pomper les moindres
molécules d’eau répandues dans un grand espace. Leurs tiges, presque toujours
dures et même ligneuses, sont souvent armées d’épines ou d’aiguillons, ou bien
l’extrémité même de leurs feuilles est terminée par une pointe piquante, comme
on le remarque dans certaines espèces de graminées. Leurs fleurs ne sont que
rarement peintes de couleurs bien vives, et généralement elles sont petites et peu
apparentes. Enfin leur feuillage est d’une teinte grisâtre qui n’égaye pas la vue.
L ’Egypte , quoique parcourue très-souvent par les voyageurs, est loin d’être
parfaitement connue sous le rapport de l’histoire naturelle. Lés recherches de
Prosper Alpin, de Pococké, d’Hasselquist, ont, à la vérité, enrichi la botanique
d’un assez grand nombre de plantes. L ’ouvrage dont Forskal est l’auteur, et qui
porte le titre de Flora Ægyptiaco- Arabica, a sur- tout contribué à étendre nos
connoissances ; on y trouve un grand nombre de plantes recueillies en Egypte et
en Arabie, et données comme nouvelles : mais Forskal s’est souvent mépris dans la
nomenclature; il a cherché à établir beaucoup de genres nouveaux, tandis qu’il pou-
voit facilement rapporter ses espèces à des genres connus. Malgré ces défauts, on
trouve dans son ouvrage des descriptions très-exactes et des remarques judicieuses.
Les plantes d’Egypte cultivées à Paris exigent l’orangerie tous les hivers : la serre
chaude ne leur conviendroit pas, elle n’est faite que pour les plantes de la zone
torride ; et quoique l’Egypte soit bornée au sud par le tropique du cancer, ses
productions ne sont point les mêmes que celles de la partie de l’Afrique comprise
dans cette zone. La Flore d’Egypte se rapproche plus de celle de Syrie, de Malte,
de Candie, que de celle de Guinée ou d’Abyssinie.
Les plantes de France éprouvent, chaque année, une gelée plus ou moins forte,
qui ne produit sur elles d’autre effet que de suspendre leur végétation : cet effet
se présente de trois manières différentes, selon que les plantes sont annuelles,
vivaces ou ligneuses. Dans le premier c a s , elles périssent après avoir répandu
leurs graines en automne ; la graine reste enfouie dans la terre pendant la froide
saison ; au printemps , elle germe et produit de nouveaux individus. Quant aux
plantes vivaces, leurs racines restent également enfouies dans la terre : tant que
dure le froid, elles semblent privées de vie; mais, quand la température s’élève,
elles poussent des tiges et des feuilles, et la plante végète avec une nouvelle
vigueur. Les arbres restent aussi, en hiver, plongés dans une sorte de sommeil
E T C E L L E S D E F R A N C E . 6 1
léthargique, dont ils sont tirés par la chaleur du printemps. Rien de semblable
n’a lieu en Egypte, où le froid n’est jamais assez considérable pour suspendre
ainsi la végétation. La défoliation des arbres, qui s’opère généralement en France
au mois de novembre, n’a lieu qu’en décembre et janvier. D ’un autre cô té , la
verdure renaît dès le mois de février et de mars, tandis qu’il est rare en France
qu’en avril tous les arbres soient revêtus de leurs feuilles naissantes. Toutes ces
différences Si remarquables ne sont dues qu’au climat et à l’influence d’un hiver
semblable à un long printemps; car les arbres de la même espèce restent à peine
deux mois dépourvus de leurs feuilles en Egypte, tandis que ce terme est de plus
de quatre en France.
Le terrain de l’Egypte étant très-peu varié, comme je l’ai dit plus haut, il résulte
que des tribus entières de plantes, sur-tout celles qui habitent les bois et qui sont
très-répandues en France, manquent absolument en Egypte. Il en est de même de
celles qui croissent sur les montagnes élevées, et auxquelles Linnéus a départi le
nom général d'alpines. Il est des plantes qui sont communes aux deux pays ; ce
sont principalement celles des bords de la mer, et celles des champs de blé. Je
citerai pour exemple le passerina hirsuta, plante ligneuse de la famille des thy-
melées, qui est très-commune aux environs de Marseille et de Toulon, et qu’on
retrouve à Alexandrie ; je citerai encore les frankenia, petites plantes de la famille
des caryophyllées, qu’on rencontre également sur les côtes des deux pays.
Quoique l’Egypte soit entièrement privée de forêts, elle jouit cependant de
quelques-uns des avantages attachés à leur présence. Les sycomores, les cassiers,
les lebbek, les napeca, sont de grands arbres très-touffus, dont le feuillage large
est propre à donner beaucoup d’ombre. Ces arbres ont le double avantage d’orner
les campagnes dans lesquelles ils sont répandus, et d’y offrir un abri contre
les rayons ardens du soleil ; sans eux l’Egypte seroit presque totalement dépourvue
de verdure au printemps, et ne présenterait, à perte de vue, que de vastes champs
poudreux, dont rien ne couperait l’uniformité : car on ne voit pas dans ce pays ces
beaux gazons si frais qui parent nos contrées tempérées, et encore plus les régions
septentrionales; les gramen, qui constituent généralement ces gazons, n’existent
pas en Egypte, ou bien ils demeurent isolés sans se réunir par touffes. D ’ailleurs,
faction continuelle d’un soleil brûlant dessèche ces plantes, et les brûle jusqu’à
la racine. On connoît les soins que prennent les Anglais pour se procurer de beaux
gazons : qu’on juge , par les difficultés qu’on éprouve en Angleterre, dans un
climat toujours humide et brumeux, des peines qu’il faudrait prendre pour entretenir
la verdure en Egypte, seulement dans un espace resserré, tel qu’un jardin:
Les gazons ne sont pas faits pour les climats chauds : la nature a voulu répandre
ses bienfaits avec une certaine égalité ; elle a dédommagé les pays du Nord des
brouillards, des pluies, des gelées, en leur accordant une verdure délicieuse ; ceux
du midi, jouissant d’un ciel toujours serein, n’y ont pas eu part.
S il est vrai de iJire que la France offre des tribus de plantes dont l’Egypte est
privée, il faut avouer aussi que le contraire a lieu pour certaines familles. L’Égypte
présente beaucoup de dattiers; la France n’en contient pas de naturels à son sol.