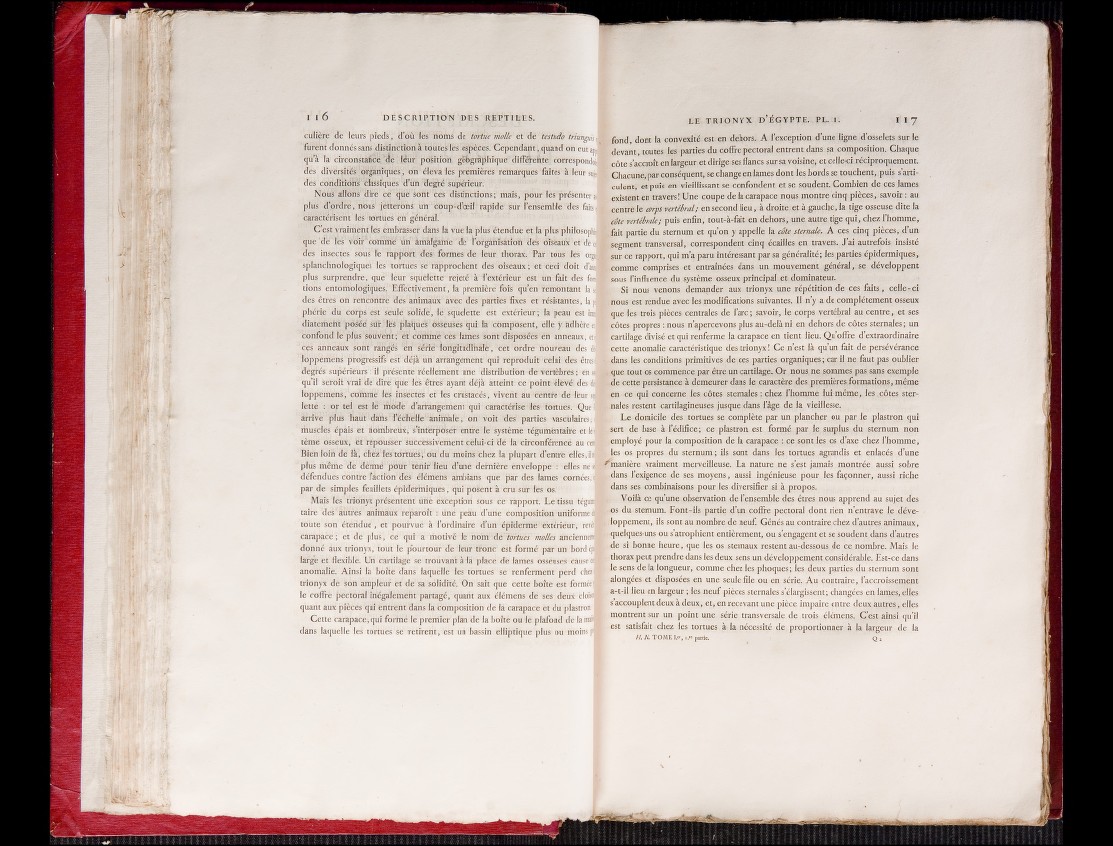
culière de leurs pieds, d’où les noms de tortue molle et de tcstudo trmngu'u i l
furent donnés sans distinction à toutes les espèces. Cependant, quand on e u ta J
qu à la circonstance de leur position géographique différente correspondoiil
des diversités organiques, on éleva les premières remarques faites à leur sujgl
des conditions classiques d’un degré supérieur.
Nous allons dire ce que sont ces distinctions; mais, pour les présenter J
plus d’ordre, nous jetterons un coup-d’oeif rapide sur l’ensemble des faits - |
caractérisent les tortues en général.
C ’est vraiment les embrasser dans la vue la plus étendue et la plus philosop J
que de lès vo'ii‘'comme un amalgame de l'organisation des oiseaux et dè ctB
des insectes sous le rapport des formes de leur thorax. Par tous les orgi|
splanchnologiques les tortues Se rapprochent des oiseaux ; et ceci doit d’auifl
plus surprendre, que leur squelette rejeté à l’extérieur est un fait des fon|
tions entomologiques. Effectivement, la première fois qu’en remontant la sel
des êtres on rencontre des animaux avec des parties fixes et résistantes, la p i
phérie du corps est seule solide, le squelette est extérieur; la peau est imi|
diaterfaeht posée sür lès plaqués osseuses qui la composent, elle y adhère c i|
confond le plus souvent; et comme ces lames sont disposées en anneaux, et®
ces anneaux sont rangés en série longitùdihàle, cet ordre nouveau des d®
loppemens progressifs est déjà un arrangement qui reproduit celui des êtres®
degrés supérieurs : il présente réellement une distribution de vertèbres; en <®
qu’il seroit vrai de dire que les êtres ayant déjà atteint ce point élevé des il®
loppemens, comme les insectes et les cnistacés, vivent au centre de lèur s®
lette : or tel est le mode d’arrangement qui caractérise les tortues. Que |
arrive plus haut dans l ’échelle animale; on voit des' parties vasculaires; |
muscles épais et tiombreux; s’interpOsét entre le système téguinfentaire et le®
tèrne osseux, et repousser successivement celui-ci dé la circonférence au cei®
Bien loin de là, chez les tortues1^ ou du moins chez la plupart d’entrè elles, ilij®
plus même de dèrmé pour tenir lieu d’une dernière enveloppe : elles ne ®
défendues contre fiction des élémens ambians que par des lames cornées; |
par de simples feuillets épidermiques, qui posent à cru sur les os.
Mais lès trionyx présentent uriè exception sous ce rapport. Le tissu tégun®
taire des'autres animaux reparoît : tine peau d’une composition uniforme®
toute son étendue , et pourvue à l’ordinaire d’un épiderme extérieur; revà®
carapace; et de plus, ce qui a motivé le nom de iortues molles anciennes)®
donné aux trionyx, tout le p'ourtour de leur tronc est formé par un bord é(®
large et flexible. Un cartilage se trouvant à la place de lames osseuses cause c®
anomalie. Ainsi la boîte dans laquelle les tortues se renferment perd chet®
trionyx de son ampleur et de sa solidité. On sait que cette boîte est formée®
le coffre pectoral inégalement partagé, quant aux élémens de ses deux dois®
quant aux pièces qui entrent dans la composition de là carapace et du plastron. |
Cette carapace; qui forinë le premier plan de la boîte ou le plafond de la mai®
clans laquelle les tortues se retirent, est un bassin elliptique plus ou moins p®
fond, dont la convexité est en dehors. A l’exception d’une ligne d’osselets sur le
devant, toutes les parties du coffre pectoral entrent dans sa composition. Chaque
côte s’accroît en largeur et dirige ses flancs sur sa voisine, et celle-ci réciproquement.
Chacune, par conséquent, se change en lames dont les bords se touchent, puis s’articulent,
et puis en vieillissant se confondent et se soudent. Combien de ces lames
existent en travers! Une coupe de la carapace nous montre cinq pièces, savoir : au
centre le corps vertébral; en second lieu, à droite. et à gauche, la tige osseuse dite la
cite vertébrale; puis enfin, tout-à-fait en dehors, une autre tige qui, chez l’homme,
fait partie du sternum et qu’on y appelle la cote sternale. A ces cinq pièces, dun
segment transversal, correspondent cinq écailles en travers. J ai autrefois insisté
sur ce rapport, qui m’a paru intéressant par sa généralité; les parties épidermiques,
comme comprises et entraînées dans un mouvement général, se développent
sous l’influence du système osseux principal et dominateur.
Si nous venons demander aux trionyx une répétition de ces faits, celle-ci
nous est rendue avec les modifications suivantes. Il n’y a de complètement osseux
que les trois pièces centrales de l’arc ; savoir, le corps vertébral au centre, et ses
côtes propres : nous n’apercevons plus au-delà ni en dehors de côtes sternales; un
cartilage divisé et qui renferme la carapace en tient lieu. Qu’offre d’extraordinaire
cette anomalie caractéristique des trionyx ! Ce n’est là qu’un fait de persévérance
dans les conditions primitives de ces parties organiques; car il ne faut pas oublier
que tout os commence par être un cartilage. Or nous ne sommes pas sans exemple
de cette persistance à demeurer dans le caractère des premières formations, même
en ce qui concerne les côtes sternales : chez l’homme lui-même, les .côtes sternales
restent cartilagineuses jusque dans l’âge de la vieillesse.
L e domicile des tortues se complète par un plancher ou par le plastron qui
sert de base à l’édifice; ce plastron est formé par le surplus du sternum non
employé pour la composition de la carapace : ce sont les os d’axe chez l’homme,
les os propres du sternum ; ils sont dans les tortues agrandis et enlacés d’une
'manière vraiment merveilleuse. La nature ne s’est jamais montrée aussi sobre
dans l’exigence de ses moyens, aussi ingénieuse pour les façonner, aussi riche
dans ses combinaisons pour les diversifier si à propos.
Voilà ce qu’une observation de l’ensemble des êtres nous apprend au sujet des
os du sternum. Font-ils partie d’un coffre pectoral dont rien n’entrave le développement,
ils sont au nombre de neuf. Gênés au contraire chez d’autres animaux,
quelques-uns ou s’atrophient entièrement, ou s’engagent et se soudent dans d’autres
de si bonne heure, que les os sternaux restent au-dessous de ce nombre. Mais le
thorax peut prendre dans les deux sens un développement considérable. Est-ce dans
le sens de la longueur, comme chez les phoques; les deux parties du sternum sont
alongées et disposées en une seule file ou en série. A u contraire, l’accroissement
a-t-il lieu en largeur ; les neuf pièces sternales s’élargissent; changées en lames, elles
[ s accouplent deux à deux, et, en recevant une pièce impaire entre deux autres, elles
montrent sur un point une série transversale de trois élémens, C ’est ainsi qu’il
est satisfait chez les tortues à la nécessité de proportionner à la largeur de la
H. N. TOME I.er, I.w partie. t Q 2