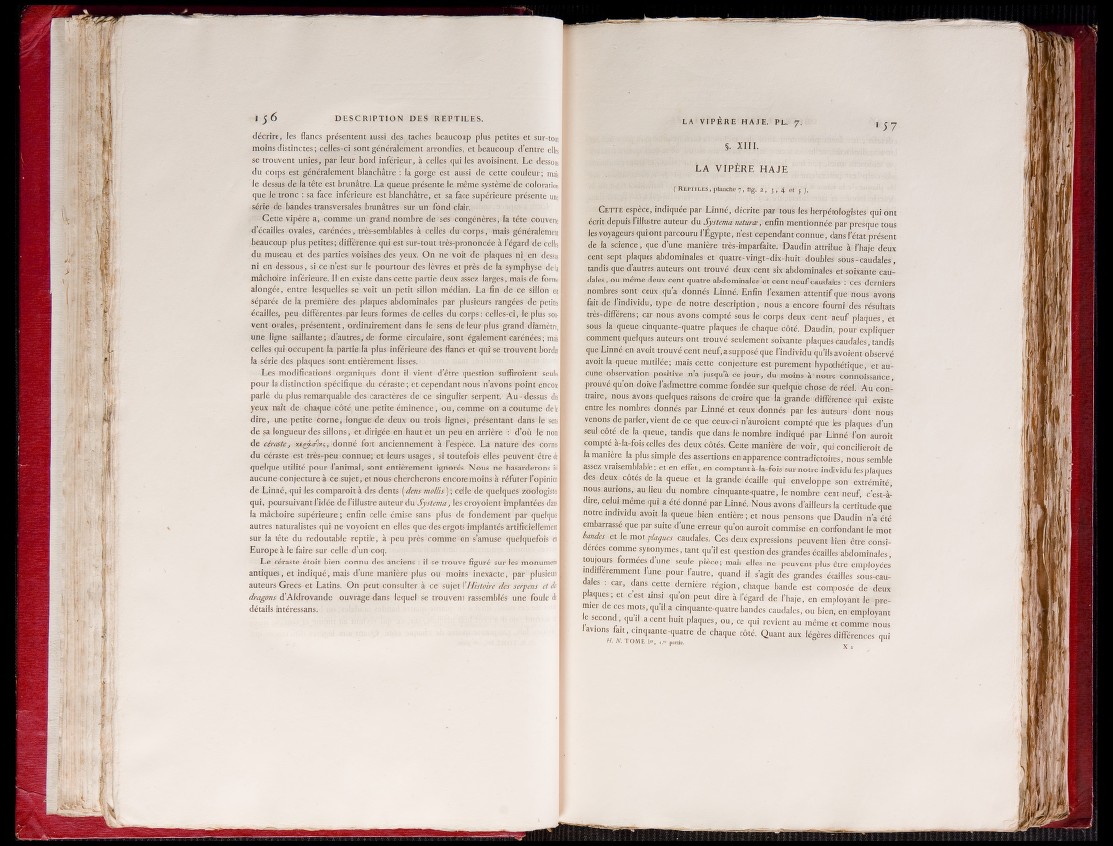
décrire, les flancs présentent aussi des taches beaucoup plus petites et sur-tout
moins distinctes; celles-ci sont généralement arrondies, et beaucoup d’entre elles
se trouvent unies, par leur bord inférieur, à celles qui les avoisinent. Le dessous
du corps est généralement blanchâtre : la gorge est aussi de cette couleur; mais
le dessus de la tête est brunâtre. La queue présente le même système'de coloration I
que le tronc : sa face inférieure est blanchâtre, et sa face supérieure présente une I
série de bandes transversales brunâtres sur un fond clair.
Cette vipère a, comme un grand nombre de ses congénères, la tête couverte
decailles ovales, carénées, très-semblables à celles du corps, mais généralement!
beaucoup plus petites; différence qui est sur-tout très-prononcée à l’égard de celles |
du museau et des parties, voisines des yeux. On ne voit de plaques ni en dessus |
ni en dessous, si ce n’est sur le pourtour des lèvres et près de la symphyse de la |
mâchoire inférieure. Il en existe dans cette partie deux assez larges, mais de forme |
alongée, entre lesquelles se voit un petit sillon médian. La fin de ce sillon est I
séparée de la première des plaques abdominales par plusieurs rangées de petites I
écailles, peu différentes par leurs formes de celles du corps : celles-ci, le plus sou-1
vent ovales, présentent, ordinairement dans le sens de leur plus grand diamètre,!
une ligne saillante; d’autres, de forme circulaire, sont également carénées; mais |
celles qui occupent la partie la plus inférieure des flancs et qui se trouvent border
la série des plaques sont entièrement lisses.
Les modifications organiques dont il vient d’être question suffiraient seules I
pour la distinction spécifique du céraste ; et cependant nous n’avons point encore I
parlé du plus remarquable des caractères de ce singulier serpent. Au-dessus desI
yeux naît de chaque côté une petite éminence, ou, comme on a coutume de le |
dire, une petite corne, longue de deux ou trois lignes, présentant dans le sens |
de sa longueur des sillons, «.dirigée en haut et un peu en arrière : d’où le nom |
de céraste, , donné fort anciennement à l’espèce. La nature des cornes |
du céraste est très-peu connue ; et leurs usages, si toutefois elles peuvent être de |
quelque utilité pour l’animal, sont entièrement ignorés. Nous ne hasarderons ici |
aucune conjecture à ce sujet, et nous chercherons encore moins à réfuter l’opinion |
de Linné, qui les comparait à des dents [dens mollis) \ celle de quelques zoologistes |
qui, poursuivant l’idée de l’illustre auteur du Systema, les croyoient implantées dans |
la mâchoire supérieure ; enfin celle émise sans plus de fondement par quelques |
autres naturalistes qui ne voyoient en elles que des ergots implantés artificiellement |
sur la tête du redoutable reptile, à peu près comme on s’amuse quelquefois en |
Europe à le faire sur celle d’un coq.
L e céraste étoit bien connu des anciens : il se trouve figuré sur les monumens |
antiques, et indiqué, mais d’une manière plus ou moins inexacte, par plusieurs
auteurs Grecs- et Latins. On peut consulter à ce sujet l’Histoire des serpens et Ê
dragons d’Aldrovande ouvrage dans lequel se trouvent rassemblés une foule de
détails intéressans.
§. X I I I .
L a v i p è r e h a j e
f R e p t il e s , planche 7 , fig. 2 , 3 , 4 et j ).
Cette espèce, incîicjuee par Linné, décrite par tous les herpétologistes cjui ont
écrit depuis I illustre auteur du Systema naturoe, enfin mentionnée par presque tous
les voyageurs qui ont parcouru i’Ëgypte, n’est cependant connue, dans l’état présent
de la science, que d’une manière très-imparfaite. Daudin attribue à l’Iiaje deux
cent sept plaques abdominales et quatre-vingt-dix-huit doubles sous - caudales,
tandis que d’autres auteurs ont trouvé deux cent six abdominales et soixante caudales,
ou même deux cent quatre abdominales et cent neuf caudales : ces derniers
nombres sont ceux qua donnés Linné. Enfin l’examen attentif que nous avons
fait de l’individu, type de notre description, nous a encore fourni des résultats
très-differens; car nous avons compté sous le corps deux cent neuf plaques, et
sous la queue cinquante-quatre plaques de chaque côté. Daudin, pour expliquer
comment quelques auteurs ont trouvé seulement soixante plaques caudales, tandis
que Linné en avoit trouvé cent neuf, a supposé que l’individu qu’ils avoient observé
avoit la queue mutilée; mais cette conjecture est purement hypothétique, et aucune
observation positive n a jusqu’à ce jour, du moins à notre connoissance,
prouvé qu’on doive l’admettre comme fondée sur quelque chose de réel. A u contraire,
nous avons quelques raisons de croire que la grande différence qui existe
entre les nombres donnés par Linné et ceux donnés par les auteurs dont nous
venons de parler, vient de ce que ceux-ci- n’auraient compté que les plaques d’un
seul côté de la queue, tandis que dans le nombre indiqué par Linné l’on aurait
compté à-la-fois celles des deux côtés. Cette manière de voir, qui concilierait de
la manière la plus simple des assertions en apparence contradictoires, nous semble
assez vraisemblable; et en effet, en comptant à-la-fois sur notre individu les plaques
des deux côtés de la queue et la grande écaille qui enveloppe son extrémité,
nous.aurions, au lieu du nombre cinquante-quatre, le nombre cent neuf, c’est-à-
dire, celui même qui a été donné par Linné. Nous avons d’ailleurs la certitude que
notre individu avoit la queue bien entière; et nous pensons que Daudin n’a été
embarrassé que par suite d une erreur qu’on aurait commise en confondant le mot
andes et le mot plaques caudales. Ces deux expressions peuvent bien être considérées
comme synonymès, tant qu’il est question des grandes écailles abdominales
toujours formées d’une seule pièce; mais elles ne peuvent plus être employées
indifféremment lune pour l’autre, quand il s’agit des grandes écailles sous-cau-
daies ; car, dans cette dernière région, chaque bande est composée de deux
plaques; et x est ainsi qu’on peut dire à l’égard de l’haje, en employant le premier
de ces mots, qu’il a cinquante-quatre bandes caudales, ou bien, ememployant
le second, qu’il a cent huit plaques, ou, ce qui revient au même et comme nous
avions fait, cinquante-quatre de chaque côté. Quant aux légères différences qui
H. N. TOME I.cr, [,rc partie.