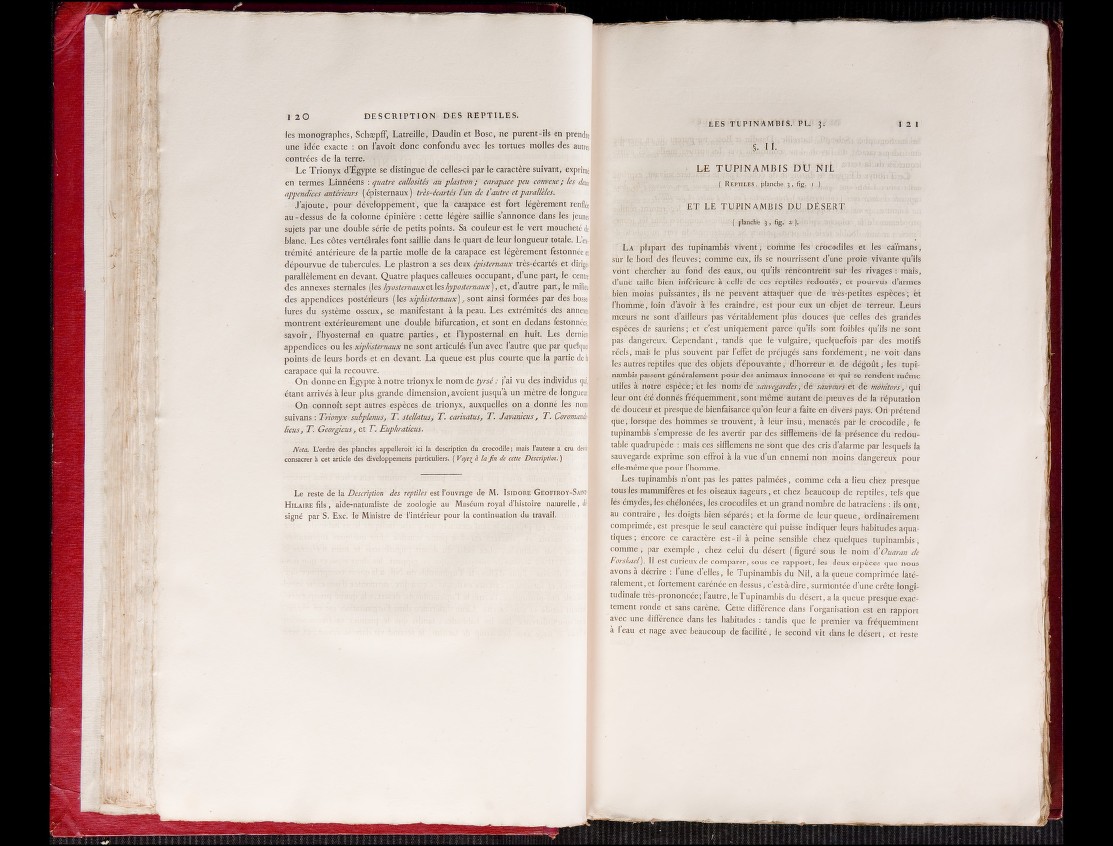
les monographes, Schoepff, Latreille, Daudin et Bosc, ne purent-ils en prendre
une idée exacte : on l’avoit donc confondu avec les tortues molles des autres
contrées de la terre.
L e Trionyx d’Égypte se distingue de celles-ci par le caractère suivant, exprimé
en termes Linnéens : quatre callosités au plastron ; carapace peu convexe ; les deux
appendices antérieurs ( épisternaux ) très-écartés l'un de l ’autre et parallèles.
J’ajoute, pour développement, que la carapace est fort légèrement renflée
au-dessus de la colonne épinière : cette légère saillie s’annonce dans les jeune
sujets par une double série de petits points. Sa couleur est le vert moucheté de
blanc. Les côtes vertébrales font saillie dans le quart de leur longueur totale. L’ex-
trémité antérieure de la partie molle de la carapace est légèrement festonnée et
dépourvue de tubercules. Le plastron a ses deux épisternaux très-écartés et dirigés
parallèlement en devant. Quatre plaques calleuses occupant, d’une part, le centre!
des annexes sternales (les hyosternauxexleslypostemaux), et, d’autre part, le milieu
des appendices postérieurs (les xiphistemaux), sont ainsi formées par des bosse-1
lures du système osseux, se manifestant à la peau. Les extrémités des annexes!
montrent extérieurement une double bifurcation, et sont en dedans festonnées;!
savoir, l’hyosternal en quatre parties, et l’hyposternal en huit. Les dernieisl
appendices ou les xiphistemaux ne sont articulés l’un avec l’autre que par quelques!
points de leurs bords et en devant. La queue est plus courte que la partie de Isj
carapace qui la recouvre.
On donne en Egypte à notre trionyx le nom de tyrsé : j’ai vu des individus qui!
étant arrivés à leur plus grande dimension, avoient jusqu’à un mètre de longue®!
On connoît sept autres espèces de trionyx, auxquelles on a donné les nomil
suivans : Trionyx subplanus, T. stcllatus, T . carinatus, T . Javamcus, T . Coromanà-1
licus, T. Georgicus, et T . Euphraticus.
Nota. L ’ordre des planches appellerait ici la description du crocodile; mais l’auteur a cru deuil
consacrer à cet article des développemens particuliers. ( Voyi^ à la f in de cette Description. )
Le reste de la Description des reptiles est l’ouvrage de M. Isidore G eoffroy-Saint-
Hilaire fils, aide-naturaliste de zoologie au Muséum royal d’histoire naturelle, dé
signé par S. Exc. le Ministre de l’intérieur pour la continuation du travail.
§. I I .
s L E T U P IN A M B I S D U N IL
( R e p t i l e s , p lan ch e 3 , f ig . 1 J. ...
E T LE TU P IN AM B IS DU D É SER T
( p làn ch e ¡}, fig . z ).
L a plupart des tupinambis vivent; cbrhrhe les crocodiles et les caïmans,
sur le bord des Heuves; comme eux, ils se nourrissent d’une proie vivante qu’ils
vdnt chercher au fond des eaux, ou qu’ils rencontrent suf les rivages: mais,
d’une taille Bien inférieure à celle de ces reptilés redoutés, et pourvtis d’armes
bien moins puïssântes, ils né peuvent attaquer que de très-petites espèces ; èt
l’homme, loin davoir à les craindre, est pour eux un objet de terreur. Leurs
moeurs ne sont d’ailleurs pas véritablement plus douces que celles des grandes
espèces de sauriens ; et c’est uniquement parce qu’ils sont foibles qu’ils ne sont
pas dangereux. Cependant, tandis que le vulgaire, quelquefois par des motifs
réels, mais le plus souvent par l’effet de préjugés sans fondement; ne voit dans
les autres reptiles que des objets d’épouvante, d’horreur et de dégoût ; les tupinambis
passent généralement pour des animaux innocens et qui se rendent même
utiles à notre espèce; fet les noms dè sauvegardes, de sauveurs et de tnônitors, qui
leur ont été donnés fréquemment, sont même autant de preuves de la réputation
dé douceur et presque dé bienfaisance qu’on leur a faite en divers pays. Orl prétend
qüe, lorsque des hommes se trouvent, à leur insii, menacés par le crocodile, lé
tupinambis s’empresse de les avertir par des sifHemehs de la présence du redoutable
quadrupède : mais ces sifflemens ne sbnt que des cris d’alarme par lesquels la
sauvegarde exprimé son effroi à la vue d’un ennemi non moins dangereux pour
elle-même que pour l’homme.
Les tupinambis n’ont pas les pattes palmées, comme cela a lieu chèz prfesque
tous les mammifères et les oiseaux nageurs, et chez beaucoup de reptiles, tels que
les émydës, les chélonées, les crocodiles et un grand nombre de batraciens : ils ont,
au contraire, : les doigts bien séparés; et la formé de leur queue, ¡ordinairement
comprimée, ést presque le seul caractère qui puisse indiquer leurs habitudes aquatiques;
encore ce caractère est-il à peine sensible chez quelques tupinambis,
comme ; par exemple , chez celui du désert ( figuré sous le nom A’Ouaran de
Forskael). Il est curieux de comparer, sous ce rapport, les deux espèces que nous
avons a décrire : 1 une d elles, le Tupinambis du Nil, a la queue comprimée latéralement,
et fortement carence en dessus, c est-à-dire, surmontée d’une crête longitudinale
tres-prononcee ; 1 autre, le Tupinambis du désert, a la queue presque exactement
ronde et sans carène. Cette différence dans l’organisation est en rapport
avec une différence dans les habitudes : tandis que le premier va fréquemlnent
à leau et nage avec beaucoup de facilité, le second vit dans le désert, et leste