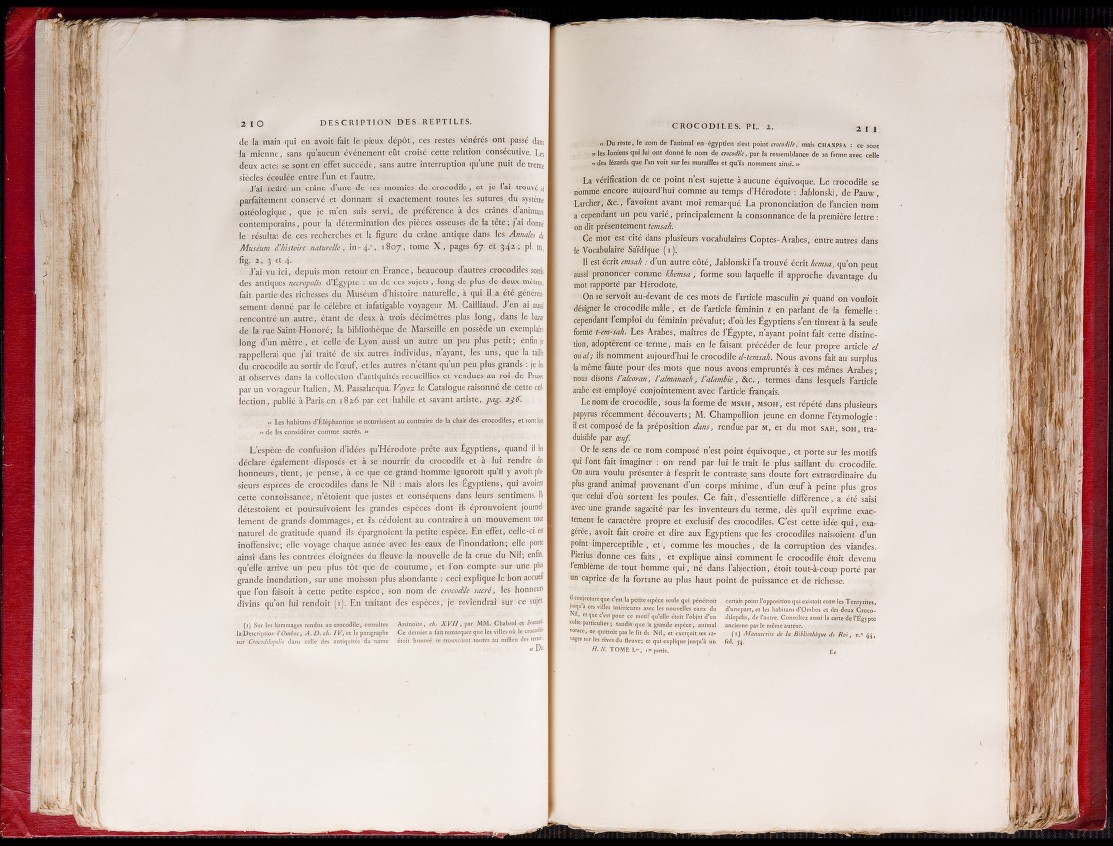
de la main qui en avoit fait le pieux dépôt, ces restes vénérés ont passé dans
la mienne, sans qu’aucun événement eût croisé cette relation consécutive. Les
deux actes se sont eii effet succédé, sans autre interruption qu’une nuit de trente
siècles écoulée entre l’un et l’autre.
J’ai retiré un crâne d’une de ces momies de crocodile , et je l’ai trouvé si I
parfaitement conservé et donnant si exactement toutes les sutures du système I
ostéologique , que je m’en suis servi, de préférence à des crânes d’animaux I
contemporains, pour la détermination des pièces osseuses de la tête ; j’ai donné I
le résultat de ces recherches et la figure du crâne antique dans les Annales du I
Muséum d'histoire naturelle, in -4.°, 1807, tome X , pages 67 et 34 2; pl. ¡¡j. I
fig. 2, 3 et 4.
J’ai vu ici, depuis mon retour en France, beaucoup d’autres crocodiles sortis I
des antiques necropolis d’Égypte : un de ces sujets , long de plus de deux mettes, I
fait partie des richesses du Muséum d’histoire naturelle, à qui il a été généreu- I
sement donné par le célèbre et infatigable voyageur M. Cailliaud. J’en ai aussi I
rencontré un autre, étant de deux à trois décimètres plus long, dans le bazar I
de la rue Saint-Honoré; la bibliothèque de Marseille en possède un exemplaire il
long d’un mètre, et celle de Lyon aussi un autre un peu plus petit ; enfin je I
rappellerai que j’ai traité de six autres individus,- n’ayant, les uns, que la taille I
du crocodile au sortir de l’oeuf, et les autres n’étant qu’un peu plus grands : je les I
ai observés dans la collection d’antiquités recueillies et vendues au roi de Prusse 1
par un voyageur Italien, M. Passalacqua. Voyez le Catalogue raisonné de cette col- I
lection, publié à Paris en 1826 par cet habile et savant artiste, pag. 23G.
Datifs#
« Le s habitans d’ÉIéphantine se nourrissent au contraire de la chair des crocodiles, et sont loin I
sa de les considérer comme sacrés. 55
L ’espèce de confusion d’idées qu’Hérodote prête aux Égyptiens, quand il les I
déclare également disposés et à se nourrir du crocodile et à lui rendre des I
honneurs, tient, je pense, à ce que ce grand homme ignoroit qu’il y avoit plu- I
sieurs espèces de crocodiles dans le Nil : mais alors les Égyptiens, qui avoient I
cette connoissance, n’étoient que justes et conséquens dans leurs sentimens. Ils I
détestoient et poursuivoient les grandes espèces dont ils éprouvoient journel- I
lement de grands dommages, et ils cédoient au contraire à un mouvement tout I
naturel de gratitude quand ils épargnoient la petite espèce. En effet, celle-ci est I
inoffensive; elle voyage chaque année avec les eaux de l’inondation; elle porte I
ainsi dans les contrées éloignées du fleuve la nouvelle de la crue du Nil; enfin, I
qu’elle arrive un peu plus tôt que de coutume, et l’on compte sur une plüs I
grande inondation, sur une moisson plus abondante : ceci explique le bon accueil I
que l’on faisoit à cette petite espèce, son nom de crocodile sacré, les honneurs ■
divins qu’on lui rendoit (i). En traitant des espèces, je reviendrai sur ce sujet. I
(1) Sur les hommages rendus au crocodile, consultez Arsinolte, ch. X V I I , par MM. Chabrol et Joroartl. I
la,Description A’Ombos, A .D . ch. IV , et le paragraphe Ce dernier a fait remarquer que les villes où le crocodile ■
sur Crocodilopolis dans celle des antiquités du nome étoit honoré se trouvoient toutes au milieu des terres: ■
a Du I
« Du reste, le nom de ranimai en-égyptien n’est point crocodile, mais CHAMPSA : ce sont
» les Ioniens qui lui ont donné le nom de crocodile, par la ressemblance de sa forme avec celle
» des lézards que l’on voit sur les murailles et qu’ils nomment ainsi, j »
La vérification de ce point n est sujette à aucune équivoque. Le crocodile se
nomme encore aujourd’hui comme au temps d’Hérodote : Jablonski, de Pauw,
Larcher, &c., 1 avoient avant moi remarqué. La prononciation de l’ancien nom
a cependant un peu varié, principalement la consonnance de la première lettre :
on dit présentement temsah.
Ce mot est cité dans plusieurs vocabulaires Coptes-Arabes, entre autres dans
le Vocabulaire Saïdique ( i ).
Il est écrit emsah : d’un autre côté, Jablonski l’a trouvé écrit hemsa, qu’on peut
aussi prononcer comme hhemsa, forme sous laquelle il approche davantage du
mot rapporté par Hérodote.
On se servoit au-devant de ces mots de l’article masculin p i quand on vouloit
désigner le crocodile mâle, et de l’article féminin t en parlant de la femelle :
cependant l’emploi du féminin prévalut; d’où les Égyptiens s’en tinrent à la seule
forme t-em-sah. Les Arabes, maîtres de l’Égypte, n’ayant point fait cette distinction,
adoptèrent ce terme, mais en le faisant précéder de leur propre article el
ou<cl; ils nomment aujourdhui le crocodile el-temsah. Nous avons fait au surplus
la meme faute pour des mots que nous avons empruntés à ces mêmes Arabes ;
nous disons l ’alcorari, l ’almanach, l ’alambic, & c ., termes dans lesquels l’article
arabe est employé conjointement avec l’article français.
Le nom de crocodile, sous la forme de msah, msoh, est répété dans plusieurs
papyrus récemment découverts ; M. Champollion jeune en donne l’étymologie :
il est composé de la préposition dans, rendue par m, et du mot s ah , so h , tra-
duisible par oeuf.
Or le sens de ce nom composé n’est point équivoque, et porte sur les motifs
qui l’ont fait imaginer : on rend par lui le trait le plus saillant du crocodile.
On aura voulu présenter à l’esprit le contraste sans doute fort extraordinaire du
plus grand animal provenant d’un corps minime, d’un oeuf à peine plus gros
que celui d’où sortent les poules. C e fait, d’essentielle différence, a été saisi
avec une grande sagacité par les inventeurs du terme, dès qu’il exprime exactement
le caractère propre et exclusif des crocodiles. C ’est cette idée qui, exagérée,
avoit fait croire et dire aux Égyptiens que les crocodiles naissoient d’un
point imperceptible , e t , comme les mouches, de la corruption des viandes.
Pierius donne ces faits , et explique ainsi comment le crocodile étoit devenu
1 emblème de tout homme q u i, né dans l’abjection, étoit tout-à-coup porté pat-
un caprice de la fortune au plus haut point de puissance et de richesse.
il conjecture que c est la petite espèce seule qui pénétroit certain point l’opposition qui existoit entre les Tentyrites,
jusqu à ces villes intérieures avec les nouvelles eaux du d’une part, et les habitans d’Ombos et des deux Croco-
1 ’ et cI’^e Cest pour ce motif qu’elle étoit l’objet d’un dilopolis, de l’autre. Consultez aussi la carte del’Égyptp
eu te particulier ; tandis que la grande espèce, animal ancienne par le même auteur.
vorace, ne quittait pas le lit du N il, et exerçoit ses ra- ( i ) Manuscrits de la Bibliothèque du R o i, n.° 44,
vages sur les rives du fleuve; ce qui explique jusqu’à un fol. 54.
H. N. TOME I.er, i.1* partie. jre