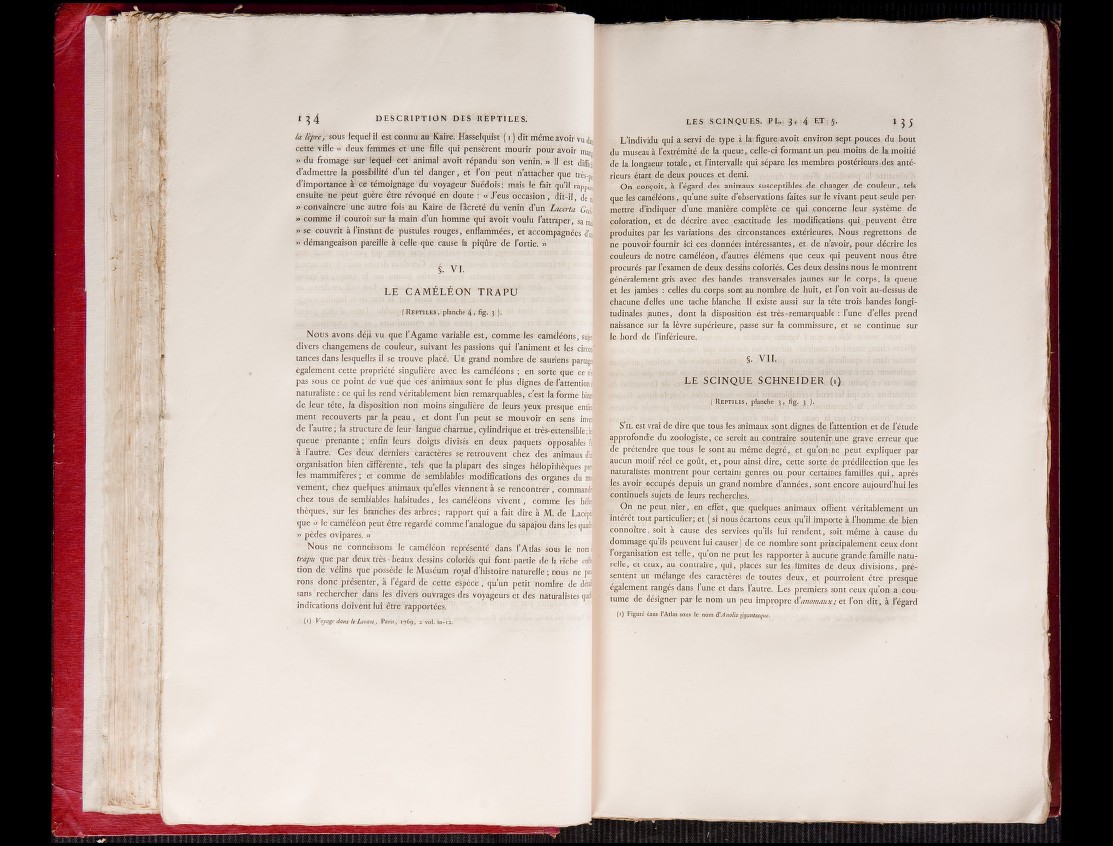
ta lèpre, sous lequel il est connu au Kaire. Hasselquist ( i ) dit même avoir vu (kl
cette ville « deux femmes et une fille qui pensèrent mourir pour avoir man,
» du fromage sur lequel cet animal avoit répandu son venin. » Il est diffa
d’admettre la possibilité d’un tel danger, et l’on peut n’attacher que très-p|
d’importance à ce témoignage du voyageur Suédois; mais le fait qu’il rapp0J
ensuite ne peut guère être révoqué en doute : « J’eus occasion , dit-il, de J
» convaincre une autre fois au Kaire de 1 acreté du venin d’un Laccrta Geàl
» comme il couroit sur la main d’un homme qui avoit voulu l’attraper, sa n^:
» se couvrit à l’instant de pustules rouges, enflammées, et accompagnées d’J
» démangeaison pareille à celle que cause la piqûre de l’ortie. »
Î V I .
L E C A M É L É O N T R A P U
f R e p t i l e s , p lan ch e 4 > f ig - 3 )•
Nous avons déjà vu que l’Agame variable est, comme les caméléons, sujet!
divers changemens de couleur, suivant les passions qui l’animent et les circoj
tances dans lesquelles il se trouve placé. Un grand nombre de sauriens partageJ
également cette propriété singulière avec les caméléons ; en sorte que ce ni
pas sous ce point de vue que ces animaux sont le plus dignes de l’attention!
naturaliste : ce qui les rend véritablement bien remarquables, c’est la forme blzaJ
de leur tête, la disposition non moins singulière de leurs yeux presque entièl
ment recouverts par la peau, et dont l’un peut se mouvoir en sens invtl
de l’autre; la structure de leur langue charnue, cylindrique et très-extensible ;|J
queue prenante ; enfin leurs doigts divisés en deux paquets opposables fi
à l’autre. Ces deux derniers caractères se retrouvent chez des animaux d’J
organisation bien différente, tels que la plupart des singes hélopithèques p«|
les mammifères ; et comme de semblables modifications des organes du mol
vement, chez quelques animaux qu’elles viennent à se rencontrer, coinmanà
chez tous de semblables habitudes, les caméléons viv en t, comme les hélo!
thèques,Sur les branches des arbres; rapport qui a fait dire à M. de Lacépèi
que « le caméléon peut être regardé comme l’analogue du sapajou dans les quadl
» pèdes ovipares. »
Nous ne connoissons le caméléon représenté dans l’Atlâs sous le noml
trapu que par deux très-beaux dessins coloriés qui font partie de la riche colll
tion dé vélins que possède le Muséum royal d’histoire naturelle ; nous ne pol
rons donc présenter, à l’égard de cette espèce, qu’un petit nombre de détail
sans rechercher dans les divers ouvrages des voyageurs et des naturalistes q u e l
indications doivent lui être rapportées.
(1) Voyage dans le Levant, Paris, 1769, 2 vol. in-12.
L ’individu qui a servi de type à la figure avoit environ sept pouces, du bout
du museau à l’extrémité de la queue, celle-ci formant un peu moins de la moitié
de la longueur totale, et l’intervalle qui sépare les membres postérieurs des antérieurs
étant de deux pouces et demi.
On conçoit, à l’égard des animaux susceptibles de changer de couleur, tels
que les caméléons, qu’une suite d’observations faites sur le vivant peut seule permettre
d’indiquer d’une manière complète ce qui concerne leur système de
coloration, et de décrire avec exactitude les modifications qui peuvent être
produites par les variations des circonstances extérieures. Nous regrettons de
ne pouvoir fournir ici ces données intéressantes, et de n’avoir, pour décrire les
couleurs de notre caméléon, d’autres élémens que ceux qui peuvent nous être
procurés par l’examen de deux dessins coloriés. Ces deux dessins nous le montrent
généralement gris avec des bandes transversales jaunes sur le corps, la queue
et les jambes : celles du corps sont au nombre de huit, et l’on voit au-dessus de
chacune d’elles une tache blanche. Il existe aussi sur la tête trois bandes longitudinales
jaunes, dont la disposition êst très-remarquable : l’une d’elles prend
naissance sur la lèvre supérieure, passe sur la commissure, et se continue sur
le bord de l’inférieure.
§. V I I .
L E S C IN Q U E S C H N E ID E R (1)
( R e p t i l e s , p lanche 3 , f ig . 3 j .
S’il est vrai de dire que tous les animaux sppt djgnps> de l’attention et de l’étude
approfondie du zoologiste, ce seroit au contraire soutenir une grave erreur que
de prétendre que tous le sont au même degré, et qu’on ne peut expliquer par
aucun motif réel ce goût, et, pour ainsi dire, cette sorte de prédilection que les
naturalistes montrent pour certains genres ou pour certaines familles qui, après
les avoir occupés depuis un grand nombre d’années, sont encore aujourd’hui les
continuels sujets de leurs recherches,
On ne peut nier, en effet, que quelques animaux offrent véritablement un
intérêt tout particulier; et ( si nous écartons ceux qu’il importe à l’homme de bien
connoitre, soit à cause des services qu’ils lui rendent, soit même à cause du
dommage quils peuvent lui causer) de ce nombre sont principalement ceux dont
1 organisation e?t telle, qu on ne peut les rapporter à aucune grande famille naturelle,
et ceux, au contraire, qui, placés sur les limites de deux divisions, présentent
un mélangé des caracteres de toutes deux, et pourroient être presque
également ranges dans 1 une et dans l’autre. Les premiers sont ceux qu’on a coutume
de designer par le nom un peu impropre d’anomaux ; et l’on dit, à l’égard
(i) Figure dans 1 Atlas sous le nom à? A nolis gigantesque.