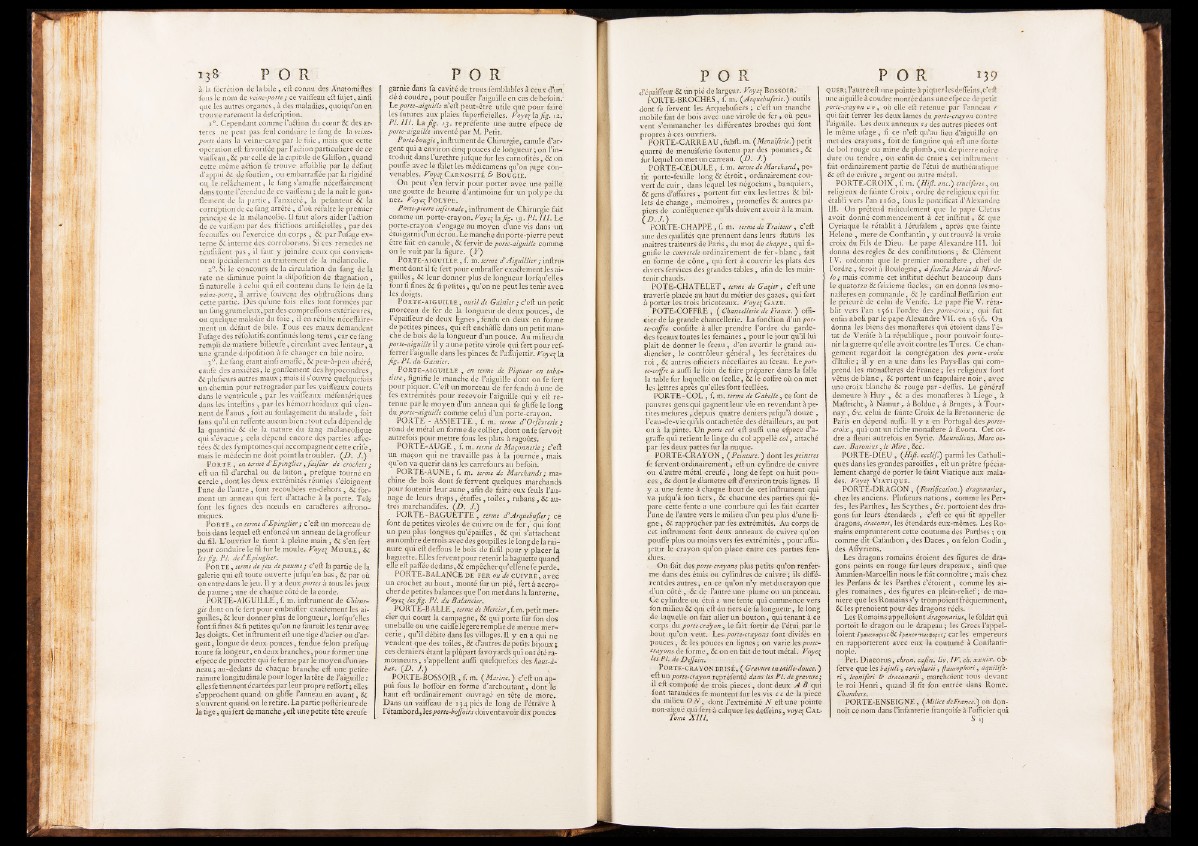
à la fécrétion de la bile , eft connu des Anatomiftes
fous le nom de veine-porte;.ce vailTeau eft fuj et, ainfi
que les autres organes * à des maladies, quoiqu’on en
trouve rarement la delcription.
i ° . Cependant comme l’aêtion du coeur & des artères
ne peut pas feul conduire le fang de la veine-
porte dans la veine-cave par le foie, mais que cette
opération eft favorifée par l’action particulière de ce
vailTeau, & par celle de la capitale de G liffon, quand
cette même aêtion fe trouve affoiblie par le défaut
d’appui &t de foutien, ou embarraffée par la rigidité
ou le relâchement, le fang s’amaffe nécelfairement
dans toute l’étendue de ce vailTeau ; de la naît le gonflement
de la partie, l’anxiété, la pefanteur & la
corruption de ce fang arrêté, d’où réfulte le premier
principe de la mélancolie. Il faut alors aider l’a&ion
de ce vailTeau par des frittions artificielles , par des
feçouffes ou l’exercice du corps , & par l’ufage externe
& interne des corroborans. Si ces remedes ne
réunifient pas , il faut y joindre ceux qui conviennent
fpécialemènt au traitement de la mélancolie.
2°. ,Si le concours de la circulation du fang de la
rate ne diminue point la difpofition de flagnation,
fl naturelle à celui qui eft contenu dans le fein de la
yeine-porre, il arrive fouvent des obftruétions dans
cette partie. Dès qu’une fois elles font formées par
un fang grumeleux, par des comprenions extérieures,
ou quelque maladie du fo ie , il en réfulte néeeflaire-
ment un défaut de bile. Tous ces maux demandent
l’ufage des réfolutifs.continués long-tems, car ce fang
rempli de matière bilieufe, circulant avec.lenteur, a
une grande difpofition à fe changer en bile noire.
- ~ 3 °. Le fang étant ainfi amafle, & peu-à-peu altéré,
çaufe des anxiétés, le gonflement des hypocondres,
& phifieurs autres maux ; mais il s’ouvre quelquefois
un chemin pour rétrograder par les vaifleaux courts
dans le ventricule , par les vaifleaux méfentériques
dans les inteftins , par les hémorrhoïdaux qui viennent
de l’anus , foit au foulagement du malade , foit
fans qu’il en reffente aucun bien : tout cela dépend de
la quantité & de la nature du fang mélancolique
qui s’évacue ; cela dépend encore des parties affectées
& des fymptomes qui accompagnent cette crife,
mais le médecin ne doit point la troubler. (Z>. ƒ.)
PORTE, en terme d’Epinglier ,faifeur de crochets;
eft un fil d’archal ou de laiton, prefque tourné en
ce rc le , dont les deux extrémités réunies s’éloignent
l’une de l’autre , font recoubées en-dehors , & forment
un anneau qui fert d’attache à la porte. Tels
font les lignes des noeuds en cara&eres aftrono-
miques.
Porte , en terme d'Epinglier; c ’eft un morceau de
bois dans lequel eft enfoncé un anneau de lagroffeur
du fil. L’ouvrier le tient à pleine main, & s’en fert
pour conduire le fil fur le moule. P?ye1 Moule , &
Us fig. Pl. de F Epinglier.
Porte , terme de jeu de paume ; c’eft la partie de la
galerie qui eft toute ouverte jufqu’en bas, & par où
©n entre dans le jeu. Il y a deux portes à tous les jeux
de paume ; une de chaque côté de la corde.
PORTE-AIGUILLE, f. m. inftrument de Chirurgie
dont on fe fert pour embraffer exactement les aiguilles,
& leur donner plus de longueur, lorfqu’elles
font fi fines & fi petites qu’on ne fauroit les tenir avec
les doigts. Cet inftrument eft une tige d’acier ou d’argent,
longue de deux« pouces, fendue félon prefque
toute la longeur, en deux branches, pour former une
efpece de pincette qui fe ferme par le moyen d’un anneau;
au-dedans de chaque branche eft une petite
rainure longitudinale pour loger la tête de l’aiguille :
elles fe tiennent écartées par leur propre reffort ; elles
s’approchent quand on gliffe l’anneau en avant, &
Couvrent quand on le retire. La partie poftérieure de
la tige, qui fert de manche , eft une petite tête creufe
g a rn ie d an s f a c a v i t é d e t ro u s fem b là b le s à c e u x d ’u n
d é à c o u d r e , p o u r p o u f fe r l’a ig u ille e n c a s d e b e fo ir i.-
L e porte-aiguille n ’e ft p e u t - ê t r e u t ile q u e p o u r f a i r è
le s fu tu r e s a u x p la ie s fu p e r f ic ie lle s . P o y e i h f i g . 1 2 :
P l . I I / . La fig . 1 3 . re p r é fe n t e u n e a u t r e e fp e c e d e
porte-aiguille in v e n t é p a r M . P e t it .
Porte-bougie, in ft rum e n t d e C h ir u r g ie , c an u le d’a r g
e n t q u i a e n v ir o n c in q p o u c e s d e lo n g u e u r ; o n l’ in t
ro d u it d an s l ’u r e th re ju fq u e fu r le s c a r n o f i t é s , & o n
p o u ffe a v e c lé ft ile t lè s m é d ic am e n s q ii’ ô n ju g e c o n v
e n a b le s . Poye{ CarNosité & Bougie.
O n p e u t s ’ ë n f e r v i r p o u r p o r t e r a v e c u n e p a ille
u n e g o u t t e d e b e u r r e d ’an tim o in e fu r u n p o ly p e d u
n e z . P o y e i P o l y p e .
Porte-pierre infernale, in ft rum e n t d e C h ir u r g ie fa it
c om m e u n p o r t ë - c r a y o n . P o y e i la fig . 19.. P l . I I I . L e
p o r t e - c r a y o n s ’ e n g a g e a u m o y e n d’u n e v i s d an s urt
e tu i g a rn i d’ u n é c r o u . L e m a n ch e d u p o r t e - p ie r r e p e u t
e t r e f a i t e n c a n u l e , & f e r v i r d e porte-aiguille c om m e
o n le v o i t p a r la f ig u r e . ( T )
Porte-aiguille , f . m . terme d 'Aigu illier ; in ft ru m
e n t d o n t i l fe f e r t p o u r em b r a ffe r ' e x a c t em e n t le s a ig
u il le s y & le u r d o n n e r p lu s d e lo n g u e u r lo r fq u ’ e lle s
fo n t f i f in e s & f i p e t i t e s , q u ’o n n e p e u t le s t e n i r a v e c
le s d o ig t s .
P o r t e -a ig u i l l e , outil de G a in ier ; c ’ e ft u n p e t it
m o r c e a u d e f e r d e l a lo n g u e u r d e d e u x p o u c e s , d é
l ’ e p a if fe u r d e d e u x lig n e s , fe n d u e n d e u x e n fo rm é
d e p e t i t e s p in c e s * q u i e ft e n c h â ffé d an s u n p e t it m a n c
h e d e b o is d e la lo n g u e u r d’u n p o l i c e . A u m il ie u d ù
porte-aiguille i l y a u n e p e t i t e v i r o le q u i fe r t p o u r re f-
f e r r e r l’ a ig u ille d an s le s p in c e s & l’a ffu je t t ir . Payez la
fig . P l . du Gainier.
Porte-aiguille , en terme de Piqueur en tabatière
* lig n if ie le m a n c h e d e l ’a ig u il le d o n t o n f e fe r t
p o u r p iq u e r . C ’ e ft u n m o r c e a u d e f e r fe n d u à u n e d é
l e s e x t r ém it é s p o l i r r e c e v o i r l ’a ig u ille q u i y e ft r e te
n u e p a r le m o y e n d’u n an n e a u q u i fe g lifle le lo n g
d u porte-aiguille c om m e c e lu i d ’u n p o r t e - c r a y o n .
P O R T E - A S S I E T T E , f . m . terme d'Orfévrerie ;
r o n d d e m é t a l e n fo rm e d e c o l l i e r , d o n t o n f e f e r v o i t
a u t r e fo i s p o u r m e t t re fo u s le s p la t s à r a g o û t s :
P O R T E - A U G E , f. m . terme de Maçonnerie ; c ’ e l l
u n m a ç o n q u i n e t r a v a i l le p a s à la jo u r n é e , m a is
q u ’ o n v a q u é r ir d an s le s c a r r e fo u r s a il b e fo in .
P O R T E - A U N E , f. m . terme de Marchands ; m a c
h in e d e b o is d o n t f e f e r v e n t q u e lq u e s m a r c h a n d s
p o u r fo u t e n ir le u r a u n e , a fin d e fa i r e e u x fe u l s l ’a u n
a g e d e le u r s d r a p s , é t o f f e s , t o i l e s , r u b a n s , & au t
r e s m a r ch a n d ife s . ( Z ? , ƒ .)
P O R T E - B A G U E T T E , terme d'Arqüebufier; c e
fo n t d e p e t it e s v i r o le s d e c u iv r e o u d e f e r ,' q u i fo n t
u n p e u p lu s lo n g u e s q u ’ é p a i f f e s , & q u i s’ a t t a c h e n t
a u n om b r e d e t ro is a v e c d e s g o u p il le s le lo n g d e la r a in
u r e q u i e f t d e ffo u s le b o is d e fiifil p o u r y p l a c e r lat
b a g u e t t e . E l le s fe r v e n t p o u r r e t e n ir la b a g u e t te q u a n d
e lle e ft p a ffé e d e d a n s , & em p ê c h e r q u ’ e lle n e fe p e r d e .
P O R T E - B A L A N C E de fer ou de cuivre, a v e c
u n c ro c h e t a u b o u t , m o n t é fu r u n p i é , f e r t à a c c r o c
h e r d e p e t it e s b a la n c e s q u e l’o n m e t d an s l a la n t e rn e .
P o y e l le s fig . P l . du Balancier.
P O R T E - B A L L E , terme de Mercier, f. m . p e t it m e r -
e ie r q u i c o u r t la c am p a g n e , & q u i p o r t e f t lr fo n d o s
u n e b a l le o u u n e c a iffe le g e r e rem p lie d e m e n u e m e r c
e r ie , q u ’ i l d é b ite d an s le s v i l la g e s . I l y e n a q u i n e
v e n d e n t q u e d e s t o i le s , & d’a u t r e s d e p e t it s b i jo u x ;
c e s d e rn ie r s é tan t la p lu p a r t f a v o y a r d è q u i o n t é t é ra -
m o n n e u r s , s ’a p p e lle n t a u fl i q u e lq u e fo is d e s haut-à-
bas. {D . J . )
P O R T E - B O S S O I R , f . m . ( Marine. } c ’ e f t u n a p p
u i fo u s le b o f lb i r e n fo rm e d’ a r e b o u t a n t , d o n t i é
h a u t e ft o r d in a i r em e n t o u v r a g é e n t ê t e d e m o r e .
D a n s u n v a if f e a u d e 1 3 4 p ié s d e lo n g d e l’ é t r a v e à
l ’ é t am b o r d , le s porte-bojfoirs d o iv e n t a v o i r d i x p o u c 'e s
d’épaiffeur & un pié de largeur. P y e { BossoiR.-
PORTE-BROCHES, fi m. (.Arquebuferie.) outils
dont fe -fervent les Arquebufiers ; c’eft un manche
mobile fait de bois avec une virole de fer, où peuvent
s’emmancher les différentes broches qui font
propres à ces ouvriers. •
PORTE-CARREAU ,fubft. m. (Menuiferie.) petit
quarré de menuiferie foutenu par des pommes, &
fur lequel on met un carreau. ÇD. J .)
PO R T E -C ÉD U LE , fim. terme deMarchand, petit
porte-feuille long & étroit * ordinairement couvert
de cu ir, dans lequel les négocians, banquiers,
& gens d’affaires , portent fur eüx les lettres & billets
de change , mémoires , promeffes & autres papiers
de conféquence qu’ils doivent avoir à la main.
( D . J . )
PORTE-CHAPPE, f. m. terme de Traiteur , c’eft
.une des qualités que prennent dans leurs ftatuts les
maîtres traiteurs de Paris, du mot de chappe, qui lignifie
le couvercle ordinairement de fe r-b lan c , fait
en forme de cône, qui fert à couvrir les plats des
divers fervices des grandes tables , afin de les maintenir
chauds.
PO T E -CH A T E L ET , terme de Gabier, c’eft une
traverfe placée au haut du métier des gazes, qui fert
à porter les trois bricoteaux. Voyei Gaze.
POTE-COFFRE , ( Chancellerie de France. ) officier
de la grande chancellerie. La fonction d’un porte
coffre confifte à aller prendre l’ordre du garde-
des fceaux toutes les femaines , pour le jour qu’il lui
plaît de donner le fceau, d’en avertir le grand audiencier
, le contrôleur général, les fecrétaires du
r o i , & autres officiers néceflaires au fceau. L e porte
coffre a aufli le foin de faire préparer dans la falle
la table fur laquelle on fcelle, & le coffre où on met
les lettres après qu’elles font fcellées.
PORTE - COL , fi m. terme de GabelleCe font de
pauvres gens qui gagnent leur vie en revendant à petites
mefures ,, depuis quatre deniers jufqu’à douze ,
l’eau-de-vie qu’ils ont achetée des détailleurs, au pot
ou à la pinte. Un porte-col eft aufli une efpece d’a-
graffe qui retient le linge du col appellé col, attaché
par fes deux pattes fur la nuque.
PORTE-CRAYON, ( Peinture. ) dont les peintres
fe fervent ordinairement, eft un cylindre de cuivre
ou d’autre métal creufé , longdelept où huit pouc
e s , & dont le diamètre eft d’environ trois lignes. Il
y a une fente à chaque bout de cet inftrument qui
va jufqu’à fon tiers, & chacune des parties qui fé-
pare cette fente a une courbure qui les fait ecarter
l’une de l’autre vers le milieu d’un peu plus d’une ligne
, & rapprocher par fes extrémités. Au corps de
cet inftrument font deux anneaux de cuivre qu’on
pouffe plus ou moins vers fes extrémités ■, pour affu-
jettir le crayon qu’on place entre ces parties fen-
ilues. -,
On fait des porte-crayons plus petits qu’on renferme
dans des étuis ou cylindres ae cuivre ; ils différent
des autres, en ce qu’on n’y met du crayon que
d’un c ô té , Tk de l’autre une plume Ou un pinceau.
Ce cylindre ou étui a une fente qui commence vers
-fon milieu & qui eft du tiers de fa longueur, le long
de laquelle on fait aller un bouton, qui tenant à ce
corps du porte-crayon, le fait fortir de l’étui par le
•bout qu’on veut. Les-porte-crayons font divilés en
pouces , & les pouces'en lignes ; on varie les porte-
crayons de forme, & on en fait de tout métal. Voyei
les P l. de Dejjêin.
Porte-crayon BRISÉ*:( Gravure entaille-douce.}
•eft un porte-crayon reprélenté dans les P l. de gravure;
•il eft compôfé de trois pièces, dont deux A B qui
font taraudées fe montent fur les vis c c de la piece
du milieu O N , dont l’extrémité A-eft une pointe
non-aiguë qui fert à calquer les defleins, voyez CAL-
Torne X I I I ,
q u ë R; l’autré eft une pointe à piqtier les defleins,c’eft
une aiguille à coudre montée dans une efpece de petit
porte-crayon co , où elle eft retenue par l’anneau t
qui fait ferrer les deux lames du porte-crayon contre
l’aiguille. Les deux anneaux s s des autres pièces ont
le même ufage, fi ce n’eft qu’au lieu d’aiguille on
met des crayons, foit de fanguine qui eft une forte
de bol rouge ou mine de plomb, ou de pierre noire
dure ou tendre , ou enfin de craie; cet inftrument
fait ordinairement partie de l’étui de mathématique
& eft de cuivre, argent ou autre métal.
PO R T E -C RO IX , f. m. (Hijl. anc.) crucifères, ou
religieux de fâinte Croix , ordre de religieux qui fut
établi vers l’an 1 1 6 0 , fous le pontificat d’Alexandre
III. On prétend ridiculement que le pape Cletus
avoit donné commencement à cet inftitut, & que
Cyriaque le rétablit à Jérufalem , après que fainte
Helene , mere de Conftantin, y eut trouvé la vraie
croix du Fils de Dieu. Le pape Alexandre I I I . lui
donna des réglés & des conftitutions ; & Clément
IV . ordonna que le premier monaftere , chef de
l’ordre , feroit à Boulogne , à fancia Maria di Morel-
lo ; mais comme cet inftitut déchut beaucoup dans
le quatorze &c feizieme fiecles, on en donna les mo-
nafteres en commande, & le cardinalBeffaripii eut
le prieuré de celui de Venife. Le pape Pie V . rétablit
vers l’an 15 6 1 l’ordre des porte-croix, qui fut
enfin aboli par le pape Alexandre V II. en 1656. On
donna les biens des monafteres qui étoient dans l’état
de Venife à la république, pour pouvoir foutenir
la guerre qu’elle avoit contre les Turcs. Ce changement
regardoit la congrégation des porte-croix
d’Italie ; il y en a une dans les Pays-Bas qui comprend
les monafteres de France ; les religieux font
vêtus de blanc, & portent un fcapulaire noir, avec
une-croix blanche & rouge par-deffus. Le général
demeure à Huy , & a des monafteres à L ie g e , à
Maftricht, à Namur , à Bolduc, à Bruges, à Tour-
n a y , &c. celui de fainte Croix de la Bretonnerie de
Paris en dépend aufli. T l y a en Portugal des porte-
croix qui ont un riche monaftere à Evora. Cet Ordre
a fleuri autrefois en Syrie. Maurolicus. Marc océan.
Bqronius, le Mire, & c.
PORTE-DIEU, (Hifi. eccléf.} parmi les Catholiques
dans les grandes paroiffes, eft un prêtre fpécia-
lement charge de porter le faint Viatique aux malades.
Voyei Viatique.
PORTE-DRAGON, (Fortification.) dtagonarius,
chez les anciens. Plufietirs nations, comme les Pertes
, les Parthes, les Scythes, &c. portoient des dragons
fur leurs étendards , c’eft ce qui fit appeller
dragons, dracones, les étendards eux-mêmes. Les Romains
empruntèrent- cette coutume des Parthes ; ou
comme dit Cafaubon, des D aces, ou félon Codin,
des Aflyriens.
Les dragons romains étoient des figures de dragons
peints en rouge fur leurs drapeaux, ainfi que
Ammien-Marcellin nous le fait connoître ; mais chez
les Perfans & les Parthes c’étoient, comme les aigles
romaines, des figures en plein-relief ; de maniéré
que les Romains s’y trompoient fréquemment,
& les prenoient pour des dragons réels.
Les Romains appelloiént dragonarius, le foldàt qui
portoit le dragon ou le drapçau ; les Grecs l’appel-
loient l'pa.y.ovctpioç & S'pa.Kov ruotpcpoç; car les empereurs
en rapportèrent avec eux Ta coUtumé àConftanti-
nople.
Pet. Diacorus ,chron. cafin. liv. IP . ch. xxxix. ob-
ferve que 1 es bajuli, cercoflarii, fiaurophori, aquilife-
r i , leoniferi & draconarii, marchoient tous devant
le roi Henri, quand il, fit fon entrée dans Rome.
Charniers.
PORTE-ENSEIGNE, (Milice deFrance.) on don-
noit ce nom dans l’infanterie françoife à l’officier qui
S ij