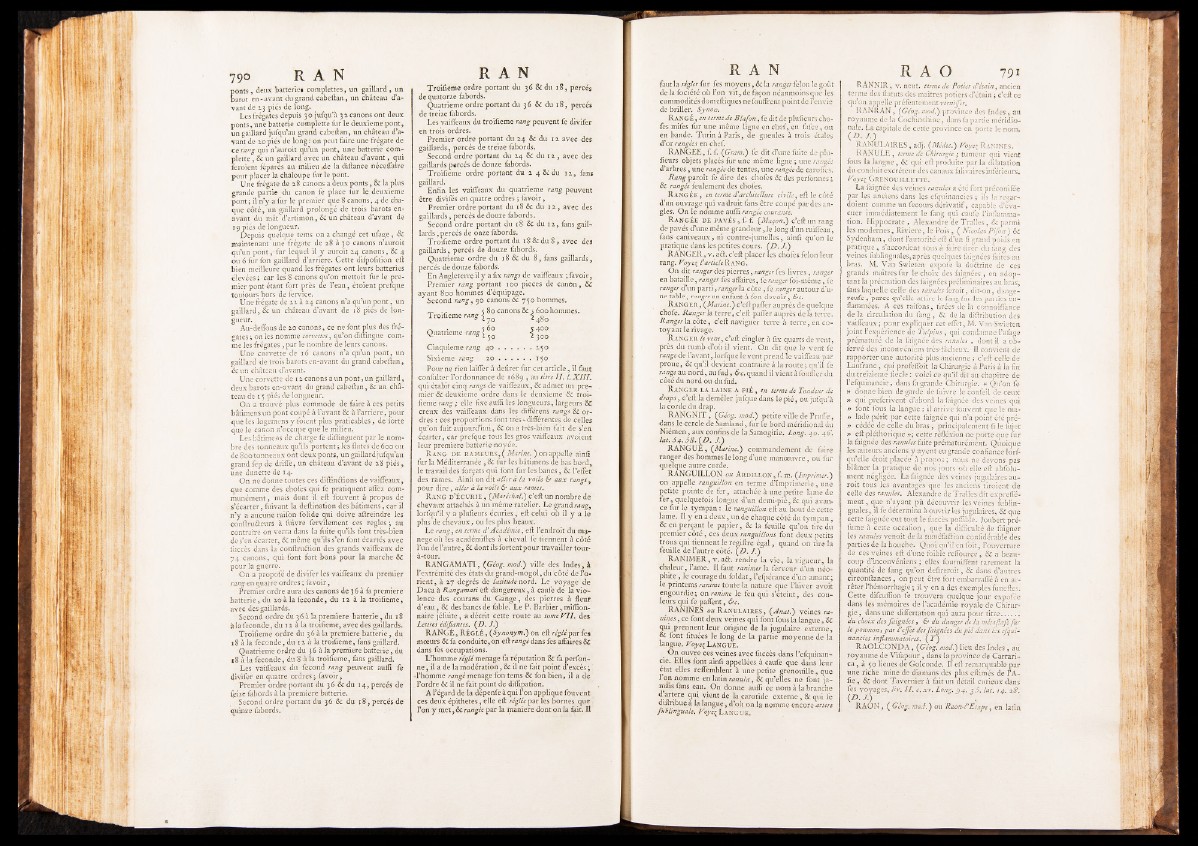
79° R A N
- onts, deux batterie* complettes, un gaillard, un
arot en - avant du grand cabeftan, un château d’avant
de 23 pies de long.
Les frégates depuis 30 jufqu’à 32 canons ont deux
ponts, une batterie complette fur le deuxieme pont,
un gaillard jufqu’au grand cabeftan, un château d’avant
de 20 pies de long : on peut faire une frégate de
ce rang qui n’auroit qu’un pont, une batterie complette
, St un gaillard avec un château d’avant, qui
l'eroient féparés au milieu ,de la diftance néceflaire
pour placer la chaloupe fur le pont.
Une frégate de 28 canons a deux ponts, & la plus
grande partie du canon fe place fur le deuxieme
pont ; il n’y a fur le premier que 8 canons, 4 de chaque
côté, un gaillard prolongé de trois barots en-
avant du mât d’artimon, St un château d’avant de
19 piés de longueur.
Depuis quelque tems on a changé cet ufage, St
maintenant une frégate de 28 à 30 canons n’auroit
qu’un pont, fur lequel il y auroit 24 canons, St 4
ou 6 fur fon gaillard d’arriere. Cette difpofition eft
bien meilleure quand les frégates ont leurs batteries
élevées ; car les 8 canons qu’on mettoit fur le premier
pont étant fort près de l’eau, étoient prefque
toujours hors de ferviee.
Une frégate dp 22 à 24 canons n’a qu’un pont, un
gaillard , St un château d’avant de 18 piés de longueur.
.
Au-deffous de 20 canons, ce ne font plus des frégates
; on les nomme corvettes, qu’on diftingue comme
les frégates, par le nombre de leurs canons.
Une corvette de 16 canons n’a qu’un pont, un
gaillard de trois barots en-avant du grand cabeftan,
& un château d’avant.
Une corvette de 12 canons a un pont, un gaillard,
deux barots en-avant du grand cabeftan, St un château
de 15 piés de longueur.
On a trouvé plus commode de faire à ces petits
bâtimens un pont coupé à l’avant St à l’arriere, pour
que les logemens y foient plus praticables, de forte
que le canon n’occupe que le milieu.
Les bâtimens de charge fe diftinguent par le nombre
des tonneaux qu’ils portent ; les flûtes de 600 ou
de 800 tonneaux ont deux ponts, un gaillard jufqu’au
grand fep de drifl'e, un château d’avant de 28 piés,
une dunette de 14.
On ne donne toutes ces diftinftions de vaifleaux,-
que comme des chofes qui fe pratiquent affez communément,
mais dont il eft fouvent à propos de
s’écarter, fuivant la deftination des bâtimens, car il
n’y a aucune raifon folide qui doive aftreindre les
conftrufteurs à fuivre fervilement ces réglés ; au
contraire on verra dans la fuite qu’ils font très-bien
de s’en écarter, St même qu’ils s’en font écartés avec
fuccès dans la conftruûion des grands vaifleaux de
74. canons, qui font fort bons pour la marche St
pour la guerre.
On a propofé de divifer les vaifleaux du premier
rang en quatre ordres ; favoir,
Premier ordre aura des canons de 36 à fa première
batterie, du 2 0 à la fécondé, du 12 à la troifieme,
avec des gaillards.
Second ordre du 36 à la première batterie, du 18
à la fécondé, du 12 à la troifieme, avec des gaillards.
Troifieme ordre du 36 à la première batterie, du
18 à la féconde, du 12 à la troifieme, fans gaillard.
Quatrième ordre du 36 à la première batterie, du
18 à la fécondé, du 8 à la troifieme, fans gaillard.
Les vaifleaux du fécond rang peuvent aufli fe
divifer en quatre ordres; favoir,
Premier ordre portant du 36 & du 14 , percés de
feize fabords à la première batterie.
, • Second ordre portant du 36 & du 1 8 , percés de
quinze fabords. ‘
R A N
Troifieme ordre portant du 36 & d u 18 , percés
de quatorze fabords.
Quatrième ordre portant du 36 St du 1 8 , percés
de treize fabords.
Les vaifleaux du troifieme rang peuvent fe divifer
en trois ordres.
Premier ordre portant du 24 St du 12 avec des
gaillards, percés de treize fabords.
Second ordre portant du 24 St du 12 , avec des
gaillards percés de douze fabords.
Troifieme ordre portant du 2 4 St du 1 2 , fans
gaillard.
Enfin les vaifleaux du quatrième rang peuvent
être divifés en quatre ordres ; favo ir,
Premier ordre portant du 18 St du 1 2 , avec des
gaillards, percés de douze fabords.
Second ordre portant du 18 St du 1 2 , fans gaillards
, percés de onze fabords.
Troifieme ordre portant du 18 & du 8 , avec des
gaillards, percés de douze fabords.
Quatrième ordre du 18 & du 8 , fans gaillards,
percés de douze fabords.
En Angleterre il y a fix rangs de vaifleaux ; favoir,
Premier rang portant 100 pièces de canon, &
ayant 800 hommes d’équipage.
Second rang, 90 canons St 750 hommes.
Troifieme rang
5 80 canons St
I 7 0
$ 600 hommes.
*480
Quatrième rang
5 60 5 4 0 0
t 300 .
Cinquième rang 40 . . . . . •-Mo
Sixième rang 2 0 .............. . 150
Pour ne rien laiffer à defirer fur■ cet article, il faut
confulter l’ordonnance de 1689 ? au t u r e I- X I I I .
qui étabit. cinq rangs de vaifleaux, St admet un premier
& deuxieme ordre dans le deuxieme & troifieme
rang ; elle fixe aufli les longueurs, largeurs SC
creux des vaifleaux dans les différens rangs & ordres
: ces proportions font très-différentes de celles
qu’on fuit aujourd’hui, St on a très-bien fait de s’en
écarter, car préfque tous les gros vaifleaux avoient
leur première batterie noyée.
R a n g d e r a m e u r s , ( Marine.') on appelle ainfi
fur la Méditerranée , St fur les bâtimens de bas bord,
le travail des forçats oui font fur les bancs, St l ’effet
des rames. Ainfi on dit aller à la voile & aux rangs,
pour dire , aller à la voile & aux rames.
R a n g d ’é c u r i e , (Maréchal,') c ’eft un nombre de
chevaux attachés à un même râtelier. Le grand rang,
lorfqu’il y a plufieurs écuries, eft celui où il y a le
plus de chevaux, ou les plus beaux.
Le rang, en terme d ’Académie, eft l’endroit du manège
où les académiftes à cheval fe tiennent à côté
l’un de l’autre, & dont ils fortentpour travailler tour-
à-tour.
RANG AMATI, (Géog. mod.) ville des Indes, à
l’extrémité des états du grand-mogol, du côté de l’orient
, à 27 degrés de latitude nord. Le' voyage de
Daca à Rangamati eft dangereux, à caufe de la violence
des courans du Gange, des pierres à fleur
d’eau, St des bancs de fable. Le P. Barbier, millionnaire
jéfuite, a décrit cette route au tome V i l . des
Lettres édifiantes. (D . J .)
R A N G É , R é g l é , (Synonym.) on eft réglé par fes
moeurs & fa conduite, on eft. rangé dans fes affaires &
dans fes occupations.
L ’homme réglé ménagé fa réputation & fa perforine
, il a de la modération, St il ne fait point d’excès ;
■l’homme rangé ménagé fon tems St fon bien, il a de
l’ordre St il ne fait point de diflipation.
A l’égard de la dépenfe à qui l’on applique fouvent
ces deux épithetes, elle eft réglée par les bornes que
l’on y met, St rangée par la maniéré dont on la fait. Il
R A N
faut la régler fur fes moyens, St la ranger félon le goût
de la fociété où l’on v it, de façon néanmoins que les
commodités domeftiques ne fouffrent point de l’envie
de briller. Synon.
R an G É, en terme de Blafon, fe di t de plufieu rs chofes
mifes fur une même ligne en chef, en fafce, ou
en bande. Turin à Paris, de gueules à trois étales
d’or rangées en çhef.-
RANG É E , f. f. (Gram.) fe dit d’une flûte de plufieurs
objets placés fur une même ligne ; une rangée
d’arbres, une rangée de tentes, une rangée de caroflcs.
Rang paroît fe dire des chofes St des perfonnes ;
St rangée feulement des chofes.
R a n g é e , en terme d’architecture civile, eft le côté
d’un ouvrage qui va droit fans être coupé par des angles.
On le ncfmme aufli rangée courante.
R a n g é e d e p a v e s , f. f. (Maçon.) c’eft un ran^
de pavés d’une même g ran deur, le long d’un ruiffeau,
fans c an iv e au x , ni con tre-jumelles, ainfi qu’On le
pratique dans les petites cours. (D . J . )
RANG ER , v . a£t. c’eft placer les chofes félon leur
rang. Voye[ Üarticle R a n g .
On dit ranger des pierres, ranger fes liv re s, ranger
en bataille, ranger fes affaires, fe ranger foi-même, fe
ranger d’un parti, ranger \a côte, fe ranger autour d’une
table, ranger un enfant à fon devoir, &c.
R a n g e r , (Marine.) c’eft paflër auprès de quelque
chofe. Ranger la terre, c’eft pafler auprès delà terre.
Ranger la côte, c’eft naviguer terre à terre, en côtoyant
le rivage.
R a n g e r le vent, c’eft cingler à fix quarts de v e n t,
près du rumb d’où il vient. On dit que le v e n t fe
range de l’av an t, lo rfque le vent prend le va ifîe au par
p ro u e , St qu’il d e v ien t contraire à la route,; q u’il fe
range au n o rd , au fu d , &c. quand il v ien t àfouffler du
c ô té du nord ou du fud.
RANGER LA l a in e A PIE , en terme de Tondeur de
draps, c’eft la demêler jufque dans le p ié , ou jufqu’à
la corde du drap.
RANGNIT , (Géog. mod.) petite ville de Prufle,
•dans le cercle de Samland, fur le bord méridional du
Niémen, aux confins de la Samogitie. Long. 40. Æ
lat. 6 4 .58. (D . J .)
R A N G U E , (Marine.) commandement de faire
ranger des hommes le long d’une manoeuvre, ou fur
quelque autre corde.
RANGUILLON ou A r d il lo n , f. m. (Imprimer.)
on appelle ranguillon en terme d’imprimerie, une
petite pointe de fe r, attachée à une petite lame de
Fer, quelquefois longue d’un demi-pié, St qui avance
fur le tympan : le ranguillon eft au bout de cette
lame. Il y en a deux, un de chaque côté du tympan,
& en perçant le papier, St la feuille qu’on tire du
premier côté , ces deux ranguillons font deux petits
trous qui tiennent le regiftre égal, quand on tire la
feuille de l’autre côté. (D . J .)
RANIM ER , v. aéh rendre la v ie , la vigueur, la
chaleur, l’ame. Il faut ranimer la ferveur d’un néo-
phite ,.le courage du foldat, l’efpérance d’un amant;
le printems ranime toute la nature que l’hiver avoit
engourdie ; on ranime le feu qui s’eteint, des couleurs
qui fe paffent, &c.
RANINES ou R a n u l a ir e s , Anat.) ve ine s ra-
nines, ce font deux ve ine s qui font fous la langue, St
qui prennent leur origine de la jugulaire e xterne,
& font fituées le long de- la partie m o yenn e de la
langue. Voye^ L a n g u e .
On ouvre ces veines avec fuccès dans l’efquinan-
çie. Elles font ainfi appellées à caufe que dans leur
état elles reflemblent à une petite grenouille, que
l’on nomme en latin ranula, St qu’elles ne font jamais
fans eau. ^ On donne aufli ce nom à la branche
d artere qui vient de la carotide externe , & qui fe
diftribue à la langue, d’où on la nomme encore artere
fublinguale. Voyt{ L a n g UE.
R A O 791
RANNIR, v. neuf, terme de Potier d?étain, ancien
terme des ftatuts des maîtres potiers d’étain ; c’ eft ce
qu’on appelle préfentement verniffer.
RANR AN, (Géog. mod.) province des Indes, au
royaume de la Cochinchine, dans fa partie méridionale.
La capitale de cette province en porte le nom.
(D . J . H
RANULAIRES, aclj. (Mc./ec.) R a n in e s .
R A N U L E , terme de Chirurgie ; tumeur qui vient
fous la langue, St qui eft produite par la dilatation
du conduit excréteur des canaux falivaires inférieurs.
Voyei G r e n o u il l e t t e .
La faigriée des veines ranules a été fort préconifée
par les anciens dans. les efquinancies ; ils la re^ar-
doient comme un fecours dérivatif, capable d’évacuer
immédiatement le fang qui caufe l’inflammation.
Hippocrate , Alexandre de T ralle s, & parmi
les modernes, Riviere, le Pois , ( Nicolas Pifon ) St
Sydenham, dont l’autorité eft d’un fi grand poids en
pratique, s’accordent tous à faire tirer du iàng des
veines fubliriguales, après quelques faignées faites au
bras. M. Van Swieten expofe la doârine de ces
grands maîtres fur le choix des faignées , en adoptant
la précaution des faignées préliminaires au bras,
fans laquelle celle des ranules feroit, dit-on, dan«e-
reufe , parce qu’elle attire le fang fur les parties enflammées.
A ces raifons, tirées de la connoiflance
de la circulation du fang, S t de la diftribution des
vaifleaux; pour expliquer cet effet, M. Van-Svieten
joint l’expérience de Tulpius, qui condamne l’ufage
prématuré de la faigriée des ranules , dont il a bb-
fervé des inconvéniens très-fâcheux. Il convient de
rapporter une autorité plus ancienne ; c’eft celle de
Lanfranc, qui profefloit la Chirurgie à Paris à la fin
du treizième fiecle : voici ce qu’il dit au chapitre de
l’efquinancie, dans fa grande Chirurgie. « Qu’on fe
» donne bien de garde de fuivre le confeil de ceux
» qui' prefcrivent d’abord la faignée des veines qui
» font fous la langue : il arrive fouvent que le ma-
» lade périt par cette faignée qui n’a point été pré-
» cédée de celle du bras-, principalement fi le fujet
» eft pléthorique »; cette réfléxion ne porte que fur
la faignée des ranules faite prématurément. Quoique
les auteurs anciens y ayent eu grande confiance lorf-
qu’elle étoit placée à propos ; nous rie devons pas
blâmer la pratique de nos jours où elle eft abfolu-
ment négligée. La faignée des veines jugulaires auroit
tous les avantages que les anciens tiroient de
celle des ranules. Alexandre de Tralles dit expreffé-
ment, que n’ayant pu découvrir les veines fublin-
guales, il fe détermina à ouvrir les jugulaires, St que
cette faignée eut tout le fuccès poflible. Joubert préfume
à cette occafion, que la difficulté de faigner
les ranules venoit de la tuméfa&ion confidérable des
parties de la bouche. Quoi qu’il en foit, l’ouverture
de ces veines eft d’une foible reflourçe, St a beaucoup
d’inconvéniens ; elles fourniflent rarement la
quantité de fang qu’on defirerbit, St dans d’autres
circonftances , on peut être fort embarrafle à en arrêter
l’hémorrhagie ; il y en a des exemples frineftes.
Cette difcuflion fe trouvera quelque jour expofée
dans les mémoires de l ’académie royale de Chirurgie
, dans une diflertation qui aura pour titre..........
du choix des faignées , & du danger de la métaflafe fur
le poumon, par l ’effet des faignées du pié dans les efquinancies
inflammatoires. ( Y )
RAOLCON D A , (Géog. mod.) lieu des Indes , au
royaume de Vifapour , dans la province de Carrari-
c a , à 50 lieues de Golconde. Il eft remarquable par
une riche mine de diamans des plus eftimés de l’A-
fie , S t dont Tavernier à fait un détail curieux dans
fes voyages, liv. I I . c. xv. Long. 04. g S . lat. 14. 28. raB| I , a ■ R AO N, ( Géog. mod.) ou Raon-l'Etape, en latin