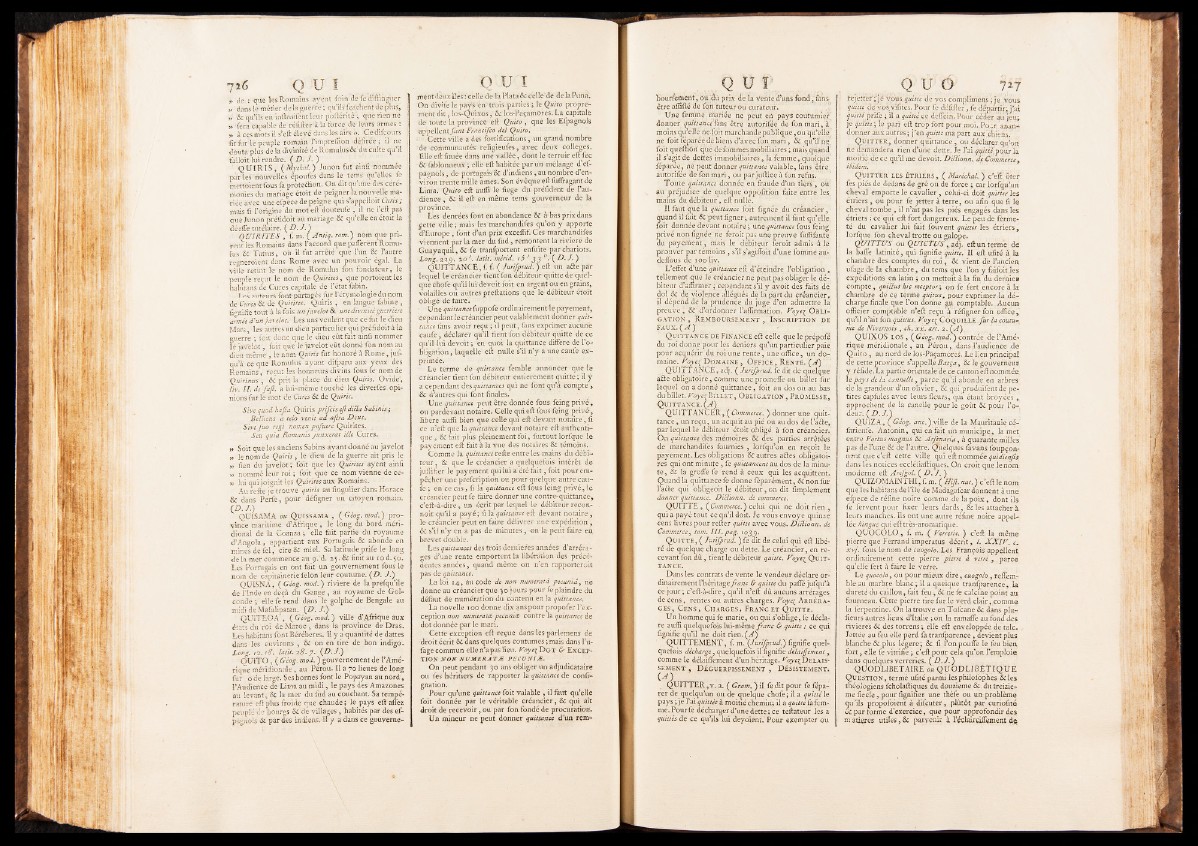
7 2
» de r qiie les Romains ayent foin de fediftifiguer
» dans le métier de la guerre ; qu’ils'leaehent de plus,
>> & qu’ils en-inftruifetit leur do fiente -', que rien ne
» fera capable de rélifrer-àla force de leurs armes :
» à ces mots il s’ eft élevé dans les airs ». 'Gé difcours
fitfur lé peuple romain l’impreffion •défiree ; il ne
douta plus de la divinité de Romulus &'du culte qu’il
falloit lui rendre. ( D . J . ) : . ,
Q U I R I S , ( Uythol. ) Junon fut ainfi nommee
par les nouvelles époufes dans le tèiiis qu elles fè
mettoient fous fa proteélion. On dit qu’une des céré-
mohies du mariage étoit de peigner la nouvelle mariée
avec une efpece de peigne qui s’appelloitCuris ;
mais fi l’origine du mot eft douteufe , il ne l’eft pas
que Junon préfidoit au mariage 6c qu’elle en étoit la
déeffe tutélaire. ( D . J . ) ' . , ;;..
Q U IR IT E S , fim (A n t iq .rom J nom que prirent
lès Romains dans l’aèeord que pafferënt Romu-
lus 6c Tatius, oïi il fut arrêté que Tun 6c l’autre
reoneroient dans Rome avec un pouvoir égal. La
Ville retint le nom de Rortiulus fon fondateur, le
peuple refcut le nom de Quirites, que portoient les
habitans de Cures capitale de l’état fabin.
V Les auteurs font partagés fur l’étymologie du nom
de Cures 6c de Quirites. Quiris , en langue fabine ,
fignifie tout à la fois un javelot & une divinité guerrière
armée d'un javelot. Les uns veulent que ce fut le dieu
Mdrs les- autres un dieu particulier qui préfidoit à la
«merre • foit donc.que le dieu eût fait ainfi nommer
îé javelot, foit que le javelot eût donné fon nom au
dietïmême , le nom Quiris fut honoré à Rome, juf-
qu’à-. ce que RomulïrS’ ayant difparu aux yeux des
Romains ,-reçut les honneurs divins fous le’ nom de
Quirinus -, & prit la place du dieu Quiris. Ovide',
liv. IL de faji. a lui-même touché les drverfès. opinions
fur le mot de Ciires & de Quiris.
Sive quod hajla Qùiris prifeis eft dicta Sabinis.;
Bellicus à telo yenit ad ajhra Dius.
Sivejuo régi nomen pofuere Quirites.
S eu quia Romanis junxerat ille Cures.
» Soit que les anciens Sabins ayant donné au javelot
» le nom de Quiris, le dieu delà guerre ait pris le
„ fien du javelot; foit que les Quirites ayent ainfi
» nommé leur roi ; foit que ce nom vienne de ce-
» lui oui joignit les Quirites aux Romains.
Au refie je trouve quiris au fingulier dans Horace
& dans Perfe, pour défigner un citoyen romain.
(D . J . ) . ;
QUISAMA ou Q u i s s a m a , ( Géog. mod.) province
maritime d’Afrique , le long du bord méridional
de la Coanza ; elle fait partie du royaume
d’Angola, appartient aux Portugais & abonde en
mines de fe l, cire 6c miel. Sa latitude prife le long
de la mer commence au q. d. 25. 6c finit au 10 d. 50.
Les Portugais en ont fait un gouvernement fous le
nom de capitainerie félon leur coutume. (.D . J J
QUISNA, (Géog. mod.j riviere de laprefqu’île
de l’Inde en deçà du Gange , au royaume de Gol-
condè ; elle fe rend dans le golphe de Bengale au
midi de Mafulipatan. (D . J J
QUITEOA , ( Géog. mod. ) ville d’Afrique aux
états du roi de M aroc, dans la province de Dras.
Les habitans font Béréberes. Il y a quantité de dattes
dans les environs , & on en tire de bon indigo.
Long. 12. ÎÈ\ latit. 28• 7. (U . J J
QUITO , ( Géog. mod. ) gouvernement de l’Amérique
méridionale, au Pérou. Il a 70 lieues de long
fur o de large. Ses bornes font le Popayan au nord,
l’Audience de Lima au m idi, le pays des Amazones
au levant, & la mer du fud au couchant. Sa température
efl plus froide que chaude; le pays efl allez
peuplé de bourgs &: de villages , habités par des e spagnols
& par des indiens. Il y a dans ce gouvernementdeux
lies icelle de laPlata&celle'de delaPunà.
On divîfe le p a ÿ sèn trois-parties ; le Quito proprement
d it, los-Qtuxos,' & los-Paçamores. La capitale
de tonte la province efl Quito, qué les Efpagnols
appellent f i n i Frahcifcô dél Quito '. ::
Gélte ville a des fortifications, -un grand nombre
dè'COmmunautés' religieufes, avec deux colleges.
Elle,efl fituée dans une va llé e , dont le terroir efl fec
& fàblonneux ; eÜè efl habitée par un mélange d*ef-
pagnols, de portugais & d’indiens , au nombre d’environ
trente mille âmes; Son évêque eft fiiffragant de
Lima; Quito eft auffi lè fiége du préfident de l’audience
, 6c il eft en même tems •gouverneur de la
province.
Les denrées font en abondance 6c à bas prix dans
pette ville ; maisTesmarchandifes qü’on ÿ apporte
d’Europe, font d’iin prix exceflif. Ces marchandifes
•Viennent par la m er;dii fud, remontent la rivieré dé
Guayaquil, & fe transportent enfuité: par chariots.
L o r i g . d A y i 20-f. I d iii. 'm é r id . i S -3-3'' ■ l - ( D . J . ) 1.
QU IT TAN C E , f. f. ( Jurifprud.) eft un a&e par
lequel lé créancier tient fon débiteur quitte de quelque
Chofe qu’il lui' devoit foit en argent ou en grains,
volailles ou autres preftations que le: débiteur étoit
obligé de faire <
- Une quittancefuppqfe ordinairement le payement,
^cependant le eréan'eierpeut valablement donner quittance
lans avoir reçu ; il peut, fans exprimer aucune
CaUfe, déclarer qu’il tient fon débiteur quitte dé ce
qu’il lui devoit ; en quoi la quittance différé de l’obligation,
laquelle eft nulle s’il n?y-: a une eaufe exprimée.
Le terme de quittance femble annoncer-que le
créancier tient fon débiteur entièrement quitte ; il ÿ
a cependant des quittances qui ne font qù’à compte-,
& d’autres qui font finales.
Une quittance peut être donnée fous feing p rivé,
ou pardevant notaire. Celle qui eft fous feing privé-,
libéré aufli bien que celle qui eft devant notaire, fi
ce n’eft que la qiiittàhcl devant notaire eft authentique
, & fait plus pleinement foi, furtout lorfque le
payement eft fait à la vue des notaires & témoins.
Comme la quittance refte entre les mains du débiteur
, & que le créancier a quelquefois intérêt de
juftifier le payement qui lui a'été f a it , foit pour empêcher
une prefeription-ou pour quelque autre cau-
le ; en ce cas-, fi la quittance eft fous feing privé, le
créancier peut fe faire donner une contre-quittance,
c’eft-à-dire, un écrit par lequel le débiteur recon-
noit qu’il a p ayé; fi la quittance eft devant notaire ,
le créancier peut en faire délivrer une expédition ,
& s’il n’y en a pas de minutes, • on- la peut faire en
brevet double.
L es quittances des trois dernier'es années d’arrérages
d’une rente, emportent la libération des précédentes
années, quand même on ri’en rapporteroit
pas de quittance.
La loi 14 , au code -de non ndmeratâ pecuniâ, ne
donne au créancier que 30 jours pour fe plaindre du
défaut de numération du contenu en la quittance.
La novelle 100 donne dix ans pour propofer l ’exception
non numérota pecuma contre la quittance de
dot donnée par le mari.
Cette exception eft reçue dans lès parlemens de
droit écrit & dans quelques coutumes ; mais dans l’u-
fage commun elle n’a pas lieu. V o y e J D o T & Exception
N O N N U M E R A T Æ P E C V N IÆ .
On peut pendant 30 ans obliger un adjudicataire
ou fes héritiers de rapporter la quittance de confi-
gnation.
Pour qu’une quittance foit valable , il faut qu’elle
foit donnée par le véritable créancier, & qui ait
droit de recevoir, ou par fon fondé de procuration.
Un mineur ne peut donner quittance d’un rem-
.. Q U T.
bourfetiïent, ôü'dû prix de la vente d’uns fond, fanS-
être affifté de fort tuteur ou curâteurï
Une femme ; mariée né peut en pays coiïtumief
donner quittance fans être autorifée dé fon mari, a
moins qu’elle ne-foit marchande publique, ou qu’elle
ne foit fépàréè dé biens d’avec fon m ari, 6c qü’il ne,
foit queftiôii' que de fommes mobiliaires ; mais quand’
il s’agit de dettes immobiliaires, la femme, quoique
fépâree, ne peut donner quittance valable, fans être,
autorifée de fon mari, ou par jiiftiçe à fon refus.
Toute quittance donnée én fraude d’un tiers*, ou’’
au préjudice dé ^quelque, oppofition faite entre, les’,
mains du débiteur, eft nulle.’.......
Il faut qiié la quittance foit fignée du Créancier,
quand il fait &'peut ligner; autremént il faut qu’elle
foit donnée devant notaire ; une, quittance fous feing
privé non lignée'ne feroit pas une preuve riïffifante’
du payement, -niais le débiteur leroit admis à le
prouver par témoins , s’il s’agifloit d’une fom’mé au-
deflbüs de 10 0 'liv.
L ’effet d’une quittance ell d’éteindre l’obligation ,
tellement qiïé lë'çreàncief ne peut pas obliger le débiteur
d’affirmer ; cependant s’il y avoit des, faits.'de'
dol 6C de, violence allégués dë la part du créancier,:
il dépend dé la prudence du juge d’en admettre la
preuve ,’ d’ordonner l’affirmation. Voye^ O b l i g
a t i o n , R e m b o u r s e m e n t , 'T n s c r i p t ïÔn d e
FAÜX. ( A )'
Q u it t a n c é dè F in a n c e eft celle que le prépofé
du roi donne pour les deniers qifun particulier paie,
pour acquérir du roi une rente, une office , un domaine.
y o y e j D o m a in e , O f f i c e , R e n t e . (A )
QUITTANCÉ ,.açlj. •( Jurijprüd. fe dit de quelque
a£le obligatoire, comme une promeffe ou billet fur
lequel on a donné quittance, foit au dos ’oü au bas
du billet. F o y e iB i l l e t , O b l ig a t io n , P r o m e s s e ,
Q u it t a n c e . (A )
Q U IT TAN C ER , ( Commerce. ) donner une quittance
, un reçu , un acquit au pié ou au dos de l’aéle,
par lequel le débiteur étoit obligé à fon créancier»
On quittance des mémoires & des parties arrêtées
de marchandifes fournies , lorfqu’on en reçoit le
payement. Les obligations &• autres aéles obligatoires
qui ont minute , fe quittancent au .dos de la minute
, & la grofie fe rend à ceux qui les acquittent..
Quand la quittance fe donne féparément, & non fur
l’aéte qui obligéoit le débiteur, on dit Simplement
donner quittance. Diçlionn. de commerce.
QUITTE , ( Commerce. ) celui qui ne doit rien ,
qui a-payé tout ce qu’il doit. Je vous envoyé quinze'
cens livres pour relier quitte avec vous. Diçlionn. de
Commerce, tom. I I I . pag, togg.
Q u i t t e , ( Jurifprud. ).fc dit de celui qui eft libéré
de quelque charge ou dette. L e créancier, en recevant
fon dû, tiént le débiteur quitte. Voyt1 Q u i t t
a n c e .
Dans les contrats de vente le vendeur déclare ordinairement
l’héritage franc & quitte du paffé jufqu’à
ce jour ; c’ eft-,à-dire, qu’il n’eft dû aucuns arrérage^
de cens, rentes ou autres charges. Voye^ A r r é r a g
e s , C e n s , C h a r g e s , F r a n c e t Q u i t t e .
Un homme qui fe marie, ou qui s’oblige, fe déclare
aufli quelquefois lui-même franc & quitte : ce qui1
fignifie qu’il ne doit rien. (A')
QU ITTEM EN T, f. m. (Jurifprudj fignifie quelquefois
décharge, quelquefois il fignifie dclaijjement,
comme le délaiffement d’un héritage, v ^ ^ D é la is sem
i -* ) HH ■ ■ i Q U IT T E R , y . a. ( Gram. ) il fe dit pour fe réparer
en t , D ég uer pissem ent , D és ist em en t .
de quelqu’un ou de quelque chofe; il a quitté le
pays ; je l’ai quittée à moitié chemin; il a quitté fafem-
me. Pour fe décharger d’une dette; ce teftateur lésa
quittés de ce qu’ils lui deyoient. Pour exempter qu
Q U O 7 * 7
fëjëtté.r i j e ÿoùs.quitte de vos complîmens ; je .vous
quitte^ çle yps vïfites. Pour fe d é ifie r , fe départir; j’ax
y u it ié jù k ; il z quitté ,c;e deffein. Pour céder au jeu;
je quitte | le pari eft trop fort pour moi..Pd!;r, anan--
dpnnef aux autres ; j ’en quitte ma part aux chiens.’"
Q u it t e r , donner quittance , ou déclarer.qu’on
ne demandera rien d’une dette. Je l’ai qtfitt^^po.ur ja
moitié de ce qu’il me devoit. Diçlionn. de Commerce%
ibidem.
Q u it t e r lès é t r i e r s , ( Maréchal, j ç V ff otef
fes pies de dedans de gré ou de force ; car lorfqiî’ûn
cheval emporte le cavalier , celui-ci doit quitter les
étriers , ou pour fe jetter à terre, ou afin que fi le
cheval tombe , il n’ait pas lés piés engagés dans les
étriers : cë qui eft fort dangereux. Le peu de férme-
té du cavalier lui fait fou vent quitter les étriers,
lorfque fon cheval trotte ou galope.
QUITTUS ou Q U IC TU S ,,%$). eftun terrne.de
la baffe latinité, qui fignifie quitte. Il eft ûfité à la
chambre des comptes du r o i & vient dè Panciea
ûfage de la chambre, du tems que l’on y faifpities
expéditions en latin ; on mettoit à la fin du dernie»
compte, qüiclus hic receptor; on fe. lert encore à la
chambre dé ce terme quitus, pour exprimer .la décharge
filiale que l’on donne ap comptable. Aucun
officier comptable n’eft. reçu a réfigner fon office,
qu’il n’ait fon quittus. Fpye{C6Q\jiLLE.furîa co'utur,
me de Nivernais ,,c/i. x ÿ . art. 2. (A J.
QUIXÔS LOS , ( Géog. mod’. ) contrée, de l ’Amérique
méridionale, au Pérou, dans l’audience de
Quito , ail nord de los-Paçamôfès. ,Le lieu principal,
dé cette province s’appelle Baeça , & le gouverneur
y réfide. La partie orientale dë ce canton eft nommée
le pays de la cannelle, parce qu’il abonde-en arbres
de la grandeur d’un o liv ie r, & qui produifent de pe-,
tites capfules avec leurs fleurs, qui étant broyées ,
approchent de la canelle pour l w m i ■■ ■e g foûKt &M pour l’o- QU1Z A , ( Geog. a ne. ).ville de la Mauritanie ce-
farienfe. Antonin, qui en'fait un municipe * la met
entre Portas inagnus & Arjcnaria, à quarante milles
pas dé l’une & de l’autre. Quelques favans. foupçon*
nent que c’eft cette ville qui eft nommée qüidienft.jj
dans les notices eceiéfiaftiques-. On croit que.lenom.
moderne eft Arej'gol. ( D. J . )
QUIZOMAINTHI, fi m. ( Jftjl- nat> ) c ’eft le nom
que les habitans de l’île de Madàgafcar donnent à une
efpece de réfine noire comme de la poix , dont ils
fe fervent pour fixer leurs dards, & les attacher à
leurs manches. Ils ont une autre réfine noire appel-1
lee hingue qui eft très-aromatique.
QUOCOLO, fi m. ( Verrerie» ) c’eft la même
pierre que Ferrand imperatus décrit, L. X X IV . c.
x vj. fous le nom de cüogolo. Les François appellent
ordinairement cette pierre pierre à verre , parce
qu’elle" fert à faire le verre.
Le quocolo, ou pour mieux dire, cuogolo, reffem-
ble.au marbre blanc; il a quelque tranfparen.ee, la
dureté du caillou, fait feu , 6c ne fe calcine point au
fourneau. Cbtte pierre tire fur le verd clair,,comme
la ferpentine. On la trouve enTofcane & dans plu-r
fleurs autres lieux d’Italie ; on la ramaffe au fond des
rivières 6c des torrens ; elle eft enveloppée de talc. ,
Jettée au feu elle perd fa tranfparence j devient plus,
blanche 6c plus légère; 6c fi l’on pouffe le feu bien
fo r t, elle fe vitrifie ; c’eft poür cela qu’on l’emploie
dans quelques verreries. ( D . J J
QUODLIBETAIR E 0« Q U O D L IB Ê T IQ U E
Q u e s t io n , termé ufité parmi les philofophes & les
théologiens fcholaftiques du douzième 6c du treizième
ficelé, pour figniner une thèfe ou un-problème
qu’ils propofoient à difeuter, plûtôt par curiofité
6c par forme d’exercice, que pour approfondir des
m atieres utiles, 6c parvenir à l’éclairciffement d$