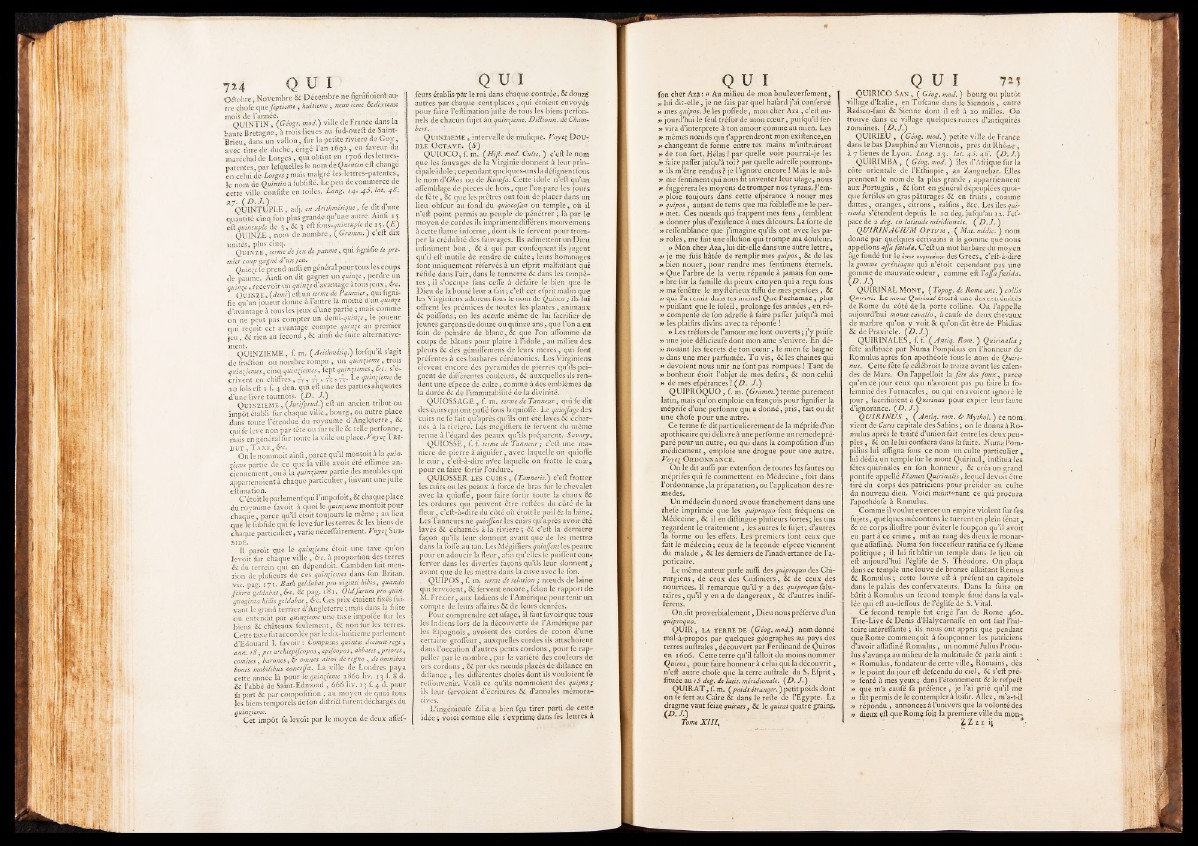
7*4 Q U I
OÉtohre, Novembre & Décembre ne lignifioient-au- I
tre choie que fiptimc , huititmc, nmv imu Scdixteme ■
moibde l’année. . ' i ' S
QU1NTIN , (G ‘ °g'- moi.) ville de France dans-la !
Uaute Bretagne, à trois lieues au fud-oueft de.Saint-
ï r ie u , dans un.vallon „ fu r la petite rivieré deiGoy^ ;
avec titre dé duché, érigé l’an 16 9 2 , en faveur du
maréchal de Lorges , qui obtint en 1706 des lettres- i
patentes, par lefquelles le nom de.Quintin eft change ;
en celui de-Lorges ; mais maigre lesdettres-patentes, ;
le nom de Quintin a fubfifté. Le peu de commerce de ,
cette ville confifte en toiles. Long. 14. 4 b . lau 48.
^Q U IN T U P L E , adj. en Arithmétique, fe dit d’une
quantité cinq fois plus grande.qu’une autre. Ainfi 15
eft quintuple d e . 3 ,& 3 eft fous-quintuple de
QUINZE , nom de nombre, (Gramm. ) c élt dix
unités^ plus. cinq.
Q u in z e , terme de jeu de.paume, qui lignifie U premier
coup gagné d'un jeu. ■■ .!
Quinze fe prend aufli en général pour tous les coups
de paume- Ainfi on dit’ gagner un î»ùiçe „perdre: un
.recevoir un quinze d’avantage àîous jcu\-, &c.
QUIRZ.E, ( 4m i ) eft un termedc Palmier^ qui fignii
fie qu’un joueur donne à l ’autre krmôitiéd’un fu in y
-d’avantage à: tous les jeux d’une partie ; mais comme
on ne peut pas compterjun.i4emi^u/uje, lejoueur
qui reçoit cet avantage compte quinze au premier
jeu , & r i e n au fécond, & ainfi de fuite alternativement.
- , . 1
QUINZIEME, f. m, ( Anthmiuq. } lortqu il s agit
de fiaàion ou nombre rompu , un. qumqicme ,„trois
quinzièmes, cinq quinzièmes, feptquin-(amee, &c. décrivent
en chiffres , ÿ à r f e i è u Tf- Le quinzième de
a o fols eft 1 f, 4den. qui eft une dés parties aliquotes
d’une livre tournois. (D . J . ) , , :
Q u in z i è m e , ( Jurifprud.) eft un ancien tribut ou
impôt établi fur chaque v ille , bourg, ou autre place
dans toute l’ étendue du royaume d Angleterre, &
quife leve non par tête ou fur telle & telle perfonne,
mais en général fur toute la ville ou place. Voyez T r i -
j îu t , T a x e , & c. .
On le nommoit ainfi, parce qu’il montoit à la quinzième
partie de ce que la ville av.oit été eftimée anciennement
,ou à la quinzième partie des meubles qui
appartenoient à chaque particulier, fuivant unejufte
eftimation.
C’étoit le parlement- qui l’impofoit, & chaque place
du royaume favoit à quoi 1 e quinzième montoit pour
chaque, parce qu’il étoit toujours le meme ; au lieu
que le fubfide qui fe leve fur les terres & les biens de
chaque particulier, varie néceffairement. Su b s
id e . S 1
Il paroit que le quinzième etoit une taxe qu on
levoit fur chaque ville , &c. à proportion des terres
& du terrein qui -en depe-ndoit. Cambden fait mention
de plufieurs de ces quinzièmes dans fon Britan.
viz. ,pag. 1 7 1 . Bath geldabat pro viginti hibis, quando
fchlragildabat, &c. & pag. I $ i . Oldfarum pro quin-
quaginta hidïs geldabat, &c. Ces prix étoient fixés fuivant
le grand terrier d’Angleterre ; mais dans la fuite
on entendit par quinzième une taxe impofee fur les
biens & châteaux feulement , & non fur les terres.
Cette taxe fut accordée parle dix-huitieme parlement
d’Edouard I. favoir : Computus quintee decimoe régi ,
ann. 18 , per archiepifcopos, epifeopos, abbates ,priâtes,
comités barones, & omnes alios de regno , de omnibus
bonis mobilibus concejfoe. La ville de Londres paya
cette année là pour le quinzième 2860 liv. 13 f.,8 d.
& l’abbé de Saint-Edmond , 666 liv. 13 f. 4 d. pour
fa part & par compofition ; au moyen de quoi tous
jes biens temporels de fon diftrid furent déchargés du
quinzième.. .
Cet impôt fe levoit par le moyen de deux afief- |
Q u 1
fe u r s é t a b l i s p â r l e r o i d an s c h a q u e .c o n t r é e , & d o u z ë
a u t r e s p a r c h a q u e c e n t p la c e s , q u i é to ie n t e n v o y é s
p o u r f a i r e l’ e ft im a t io n j iifte d e to u s le s b ie n s p e r fo n -
n e ls d e c h a c u n fu je t a u quinzième. Diclionn. de Charniers.
;
Q U IN Z IE M E , in t e r v a l le de . m u fiq u e . D o u b
l e .Q ç t av e -. ( .ÿ ) .- -
QUIOCO, f. m. ( Hifl. moi. Culte. ) c’eft le nom
.que les fauvagés de la. Virginie'donnent à leur prin-
cipale-idole ; cependant quelques-uns la défignentfous
le nom d'Okos ou de Kioufa. Cette idole n’eft qu’un
affemblage de, pièces de bois;, que l’on paré les jours
de fê te , & que les prêtres ont foin de placer dans-un
lieu ohfcur au fond du quiocofan ou temple, où il
n’ eft point permis au : peuple'de pénétrer ; là par le
moyen de cordes ils imprimentdifférens mouvemens
à cette ftatue informe, dont ils fe fervent pour tromper
la crédulité, des fauvagés. Ils admettent un Dieu
infiniment bon , & à qui- par conféquent ils ; jugent
qu’il eft’inutile de rendre de culte; leurs'hommages
font uniquement réfervés à un efprit malfaifant qui
réfide dans l’air, dans le tonnerre & dans les tempêtes
; il s’occupe fans ceffe à défaire le bien que le
Dieu de la bonté leur a fait;, c’ eft cet efprit malin que
les Virginiens adorent fous le nom de Quioco ; ils lui
offrent les prémices de toutes les plantes , animaux
& poiffons; on les accufe même de lui facrifier de
jeunes garçons de douze ou quinze ans, que l’on a eu
foin de peindre de b lan c ,& que l’on affomme de
coups de bâtons pour plaire à l’id ole, au milieu des
pleurs & des gémiffemens de leurs meres;-;qui font
préfentes à ces barbares cérémonies. Les Virginiens
élevent encore des pyramides de.pierres qu’ils peignent
de différentes couleurs, & auxquelles ils rendent
une efpece de culte, comme à des emblèmes de
la durée & de l’immutabilité de la divinité.
QUIOSSAGE , f. m. terme de Tanneur, qui fe dit
des cuirs qui ont paffé fous la quioffe. Le quiojfage des
'cuirs ne fe fait qu’après qu’ils ont été lavés 6c. échar-
nés à la riviere. Les mégifliers fe fervent du même
terme à l’égard des peaux qu’ils préparent. Savary.
QUIOSSE, f. f. terme de Tanneur ; c’eft une maniéré
de pierre à aiguifer, avec laquelle on quioffe
le cu ir , c’eft-à-dire avec laquelle.on frotte le cuir^
•pour en faire fortir l’ordure.
QUIOSSER LES C U IR S , (Tannerie.') c’eft frotter
les cuirs, ou les peaux à force de bras fur le chevalet
avec la quioffe, pour faire fortir toute la chaux 6c
les ordures qui peuvent être reftées du côté de la
fleur, c’eft-à-dire du côté où étoit le poil & la laine;
Les Tanneurs ne quiojfent les cuirs qu’après avoir été
lavés & écharnés à la riviere ; & c’eft la derniere
façon qu’ils, leur donnent avant que de les mettre
dans la foffe au tan. Les Mégifliers quiojfent les peaux
pour en adoucir la fleur, afin qu’elles fe puiffent con-
î'erver dans les diverfes façons qu’ils leur donnent,
avant que de les mettre dans la cuve avec le fon.
QUIPOS, f. m. terme de relation ; noeuds de laine
qui fervoient, & fervent encore, félon le rapport de
M. Frezier, aux Indiens de l’Amérique pour tenir un
compte de leurs affaires & de leurs denrées.
Pour comprendre cet ufage, il faut favoir que tous
les Indiens lors de la découverte de l’Amérique par
les Efpagnols, avoient des cordes de coton d’une
certaine groffeur, auxquelles cordes ils attachoient
dans l’occafion d’autres petits cordons, pour fe rap-
peller par le nombre, par la variété des couleurs de
ces cordons , & par des noeuds placés de diftance en
diftance , les différentes chofes dont ils vouloient fe
reffouvenir. Voilà ce qu’ils nommoient des quipos ;
ils leur fervoient d’écritures 6c d’annales mémora-
tives.,. ■,.,,,
L’ingénieufe Zilia a bien fçu tirer parti de cette
idée ; yoici comme elle s’exprime dans fes lettres, à
Q U ï
fon cher Aza : « Au milieu de mon bouleverfement,
» lui dit-elle, je ne fais par quel hafard j’ai confervé
» mes quipos. 'Je les poffede, mon cher Àza , c’eft au-
» jourd’hui le feul tréfor de mon coeur, puifqu’il fer-
» vira d’interprete à ton amour comme au mien. Le.s
» mêmes noeuds qui t’apprendront mon exiftence,en
» changeant de forme entre tes mains m’inftruiront
» de ton fort. Hélas ! par quelle voie pourrai-je les
» faire paffer jufqu’à toi ? par quelle adreffe pourront-
» ils m’être rendus ? je l’ignore encore 1 Mais le mê-
» me fentiment qui nous fit inventer leur ufage,,nous
>» fuggérerales moyens detrpmper nos tyrans. J ’em-
» ploie toujours dans cette efpérance à nouer mes
» quipos, autant de tems que ma foibleffe me le per-
» met. Ces noeuds qui frappent mes fens , femblent
» donner plus d’exiftence à mes difeours. La forte de
» reffemblance que j’imagine qu’ils ont avec les pa-
» rôles, me fait une illufion qui trompe ma douleur.
» Mon cher A za, lui dit-elfe dans une autre lettre,
.» je me fuis hâtée de remplir mes quipos, & de les
» bien nouer, pour rendre mes fentimens éternels.
» Que l’arbre de la vertu répande à jamais fon .om-
» bre fur la famille du pieux citoyen qui a reçu fous
» ma fenêtre le myftérieux tiffu de mes penfées , &
» qui l’a remis dans tes mains! Que'Pachamac, plus
» puifl’ant que le foleil, prolonge fe-s.années, en,ré-
» compenfe de fon adreffe à faire paffer jufqu’à moi
» les plaifirs divins avec ta réppnfe !.
» Les tréfors de l’amour me font ouverts ; j ’y puife
» une joie délieieufe dont mon ame s’enivre. En dé-
» nouant les fecrets de ton coeur, le mien fe baigne
» dans une mer parfumée. T u v i s , & le s chaines qui
» dévoient nous unir ne font pas rompues ! Tant de
» bonheur, étoit l’objet de mes defirs , & non celui
» de mes efpérances ! (D . J . )
QUIPROQUO, f. m. (Gramm.) terme purement
latin, mais qu’on emploie en françois pour fignifier la
méprife d’une perfonne qui a donné, p ris, fait ou dit
une chofe pour une autre. >
Ce terme fe dit particulièrement de la méprife d’un
apothicaire qui délivre à une perfonne un remede préparé
pour-un autre ; ou qui dans la compofition d’un
médicament, emploie une drogue pour une autre.
Voyez Or d o n n a n c e .
On le dit aufli par extenfion de toutes les fautes ou
méprifes qui fe commettent en Médecine , foit dans
l’ordonnance,1a préparation,ou l’application des re-
medes.
Un médecin du nord avoue franchement dans une
thefe imprimée que les quiproquo font fréquens en
Médecine, & il en diftingue plufieurs fortes; les uns
regardent le traitement, les autres le fujet; d’autres
Ta forme ou les effets. Les-premiers font ceux que
fait le médecin ; ceux de la fécondé efpece viennent
du malade , & les derniers de l’inadvertance de l’a-
poticaire.
Le même auteur parle aufli des quiproquo des Chirurgiens
, de ceux des Cuifiniers, & de ceux des
nourrices. Il remarque qu’il y a des quiproquo falu-
taires, qu’il y en a de dangereux, & d’autrés indif-
férens.
On.dit proverbialement, Dieu nous préferve d’un
• quiproquo.
Q U IR , l a TERRE d e (Gèog. mod.) nom donné
mal-à-propos par quelques géographes au pays des
terres auftrales, découvert par Ferdinand de Quiros
en 1606. Cette terre qu’il ralloit du moins.nommer
Quiros, pour faire honneur à celui qui la découvrit,
n’eft autre chofe que la terre auftrale du S. Efprit,
fituce au ib deg. de latit. méridionale. (D . J . )
QU1R A T , f. m. (poids étranger. ) petit poids dont
on fe fert au Caire & dans le refte de l’Egypte. La
dragme vaut feize quirats. &c le quirat quatre grainç.
(D .V )
Tome X I I I% '
Q U I 7*î
QUIRICO San , ( Gèog. mod. ) bourg ou plutôt
village d’Italie, en Tofcàne dans le Siennois , entre
Radico-fani & Sienne dont il eft à 20 milles» On
trouve dans ce village quelques ruines d’antiquités
romaines. (D . J .) -
QUIRIEU , (Gèog. mod.) petite ville de î*râhce
dans le bas Dauphiné au Viennois, près du Rhône ,
à 7 lieues de Lyon. Long. 2 3 . lat. 4S. 46 . JD . J S
QUIRIMBA, ( Gcog. mod. ) îles d’A frique fur la
côte orientale de l’Ethiopie, au Zanguebar. Elles
prennent le nom de la plus grande , appartiennent
aux Portugais , & font en général dépeuplées quoi**
que fertiles en gras pâturages. & en fruits , comme
dattes, oranges, citrons , raifms, &c. Les îles qui*
rimba s’étendent depuis le 10 deg. jufqu’au iz . l’ef*
pace de 2 deg. en latitude méridionale. ( D . J . )
QUIR IN À CIUM Op iu m , ( Mat. mèdic. ) nom
donné par quelques écrivains à la gomme que nous
appelions ajjd foetida. C ’eft un mot barbare du moyen
âge fondé fur le birov nuptvi*Kov des G recs, c’eft-à-dire
la gomme cyrèniaque qui,n’ étoit cependant pas une
gomme de mauvaife odeur, comme eft Yaffa foetida. tpry QUIRlNAL Mon t, ( Topog. de Rome anc. ) collis
Quirini. Le mont Quirinal étoit à une des extrémités
de Rome du côté de la porte colline. On l’appelle
aujourd’hui monte cavallo,, à caufe de deux chevaux
de marbre qu’on y voit & qu’on dit être de Phidias
& de Praxitèle. (D . J .)
QUIRINALES, f . f . {A p tiq , Rom.) Q uirinalia j
fête inftituée par Numa Pompilius en l’honneur de
Romulus après fon apothéofe fous le nom de Quiri-
nus. Cette fête fe célébroit le treize avant les calendes
de Mars., On l’appelloit la fête des fo u x , parce
qu’en ce jour ceux qui n’avoient pas pu faire la fo-
lemnité des Fornacales, ou qui en avoient ignoré le
jour , facrifioient à Quirinus pour expier leur faute
d’ignorance. (D . J . )
Q U IR IN U S , (Antiq. rom. & Mythol. ) ce nom
vient de Cures capitale des Sabins ; on le donna à Romulus
après le traité d’union fait entre les deux peuples
, & on le lui confacra dans la fuite. Numa Pomr-
pilius lui aflîgna fous ce nom un culte particulier ,
lui dédia un temple fur le mont Quirinal , inftitua les
fêtes quirinales en fon .honneur, & créa..un grand
pontife appellé Flamen Quirinalis, lequel devoit être
tiré du corps des patriciens pour prefider au culte
du nouveau dieu. Voici maintenant ce qui procura
l’apothéofe à Romulus.
Comme il voulut exercer un empire violent fur fes
fujets, quelques mécontens le tuerent en plein fénat,
& ce corps illuftre pour éviter le foupçon qu’il avoit
eu part à ce crime, mit au rang des dieux le monarque
affafliné. Numa fon fuccefleur ratifia ce fyftème
politique ; il lui fit bâtir un temple dans le lieu où
eft aujourd’hui l’églife dé S. Théodore. On plaça
dans ce temple une louve de bronze allaitant Remus
& Romulus; cette louve eft à préfentau capitole
dans le palais des confervateurs. Dans’ la fuite on
bâtit à Romulus un fécond temple fitué dans la vallée
qui eft au-deffous de l’églife de S. Vital.
Ce fécond temple fut érigé l’an de Rome 460,
Tite-Live & Denis d’Haly.carnaffe en ont fait l’hif-
toire intéreffante ; ils nous ont appris que pendant
que Rome.commençoit àfoupçonner les patriciens
d’avoir affafliné Romulus , un nommé Julius Procu-
lus s’ avança au milieu de la multitude & parla ainfi r
« Romulus, fondateur de cette ville, Romains, dès
» le point du-jour eft defeendu du ciél, & s’eft pré-
» fente à mes y eux ; dans l’étonnement & le refpeft
» que m’a caufé fa préfence, je l’ai prié qu’il me
» fut permis de le contempler à loifir. Allez, m’a-t-il
» répondu, annoncez à l’univers que la volonté des
» dieux eft que Rome foit la première ville du mon-
Z Z z Z ij *■;