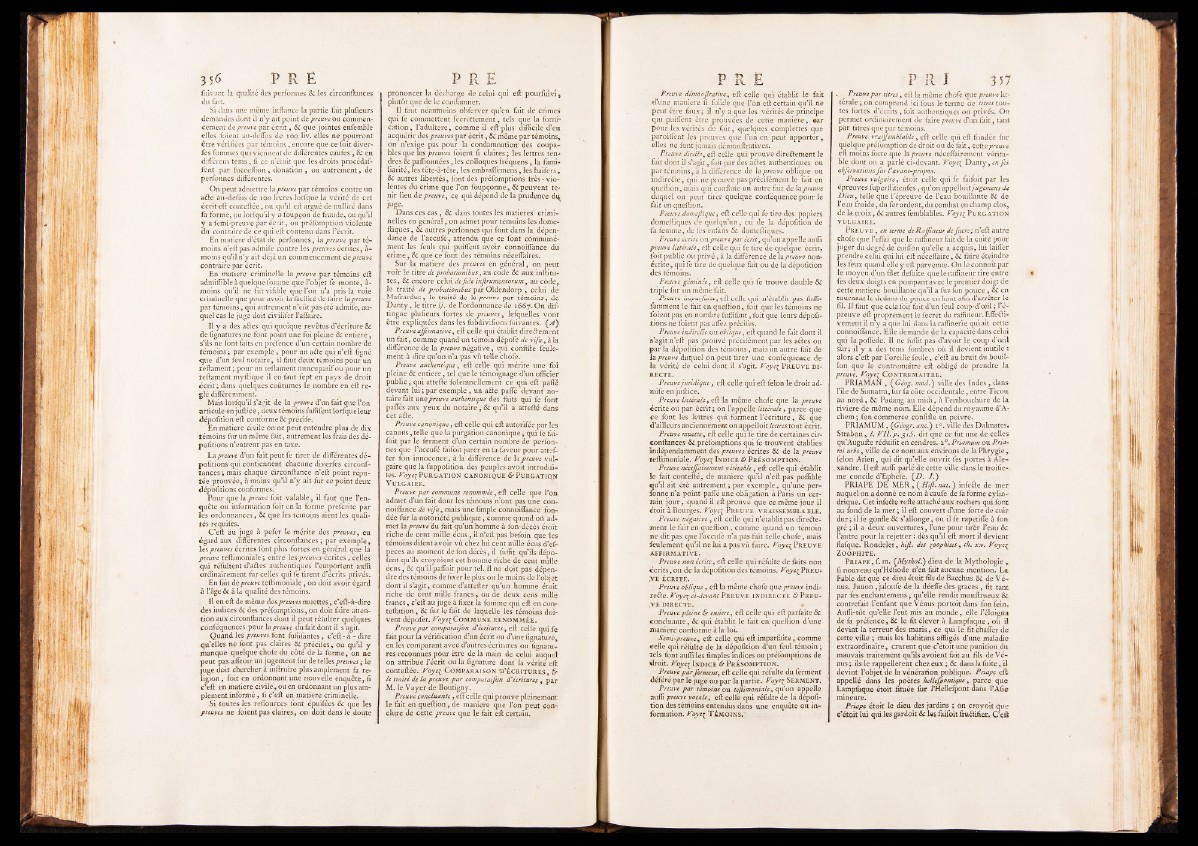
fuivant la (Qualité des perfonnes & les circonftances
du fait.
Si clans une même inftance la partie fait plufieurs
demandes dont il n’y ait point de preuve ou commencement
de preuve par é c rit, & que jointes enfemble
elles foient au-deflus de ioo, liv. elles ne pourront
être vérifiées par témoins, encore que ce foit diver-
fes fommes qui viennent de différentes caufes , & en
différens tems, fi ce n’étoit que les droits procédaf-
sfent par fucceffion, donation , ou autrement, de
perfonnes différentes.
On peut admettre la preuve par témoins contre un
afte au-deffus de ioo livres lorfque la vérité de cet
écrit eft conteftée, ou qu’ il eft argué de nullité dans
fa forme, ou lorlqu’il y a foupçon de fraude, ou qu’il
y a femi-preuve par écrit, ou préfomption violente
du contraire de ce qui eft contenu dans l’écrit.
En matière d’état de perfonnes, la preuve par témoins
n’eft pas admife contre les preuves écrites, à-
moins qu’ il n’y ait déjà un commencement de preuve
contraire par écrit.
En matière criminelle la preuve par témoins eft
admiflible à quelque fomme que l’objet fe monte, à-
moins qu’il ne fut vifible que l’on n’a pris la voie
criminelle que pour avoir la facilité de faire la preuve
par témoins, qui autrement n’eut pas été admife, auquel
cas le juge doit civilifer l’affaire.
Il y a des aftes qui quoique revêtus d’écriture &
de fignatures ne font point une foi pleine & entière,
s’ils ne font faits en préfence d’un certain nombre de
témoins ; par exemple, pour un aôe qui n’eft ligné
que d’un feul notaire, il faut deux témoins pour un
teftament ; pour un teftament nuncupatif ou pour un
teftament myftique il en faut fept en pays de droit
écrit ; dans quelques coutumes le nombre en eft réglé
différemment.
Mais lorfqu’il s’agit de la preuve d’un fait que l’on
articule en juftice, deux témoins fuffifent lorfque leur
dépolition eft conforme & précife.
En matière civile on ne peut entendre plus de dix
témoins fur un même fait, autrement les frais des dépolirions
n’entrent pas en taxe.
La preuve d’un fait peut fe tirer de différentes dé-
pofitions qui contiennent chacune diverfes circonf-
tances ; mais chaque circonftance n’eft point réputée
prouvée, à moins qu’il n’y ait fur ce point deux
dépolirions conformes.
Pour que la preuve foit valable, il faut que l’enquête
ou information foit en la forme prefcrite par
les ordonnances, & que les témoins aient les qualités
requil’es.
C ’eft au juge à pefer le mérite des preuves, eu
égard aux différentes circonftances ; par exemple,
les preuves écrites font plus fortes en général que' la
preuve teftimoniale ; entre les preuves écrites, celles
qui réfultent d’attes authentiques l’ emportent aulïi
ordinairement liir celles qui fe tirent d’écrits privés.
En fait de preuve teftimoniale, on doit avoir égard
à l’âge & à la qualité des témoins.
Il en eft de même des preuves muettes, c’eft-à-dire
des indices & des préfomptions, on doit faire attention
aux circonftances dont il peut réfulter quelques
conféquences pour la preuve du fait dont il s’agit.
Quand les preuves font fufîifantes, c’eft - à - dire
qu’elles ne font pas claires & précilès, ou qu’il y
manque quelque chofe du côté de la forme, on ne
peut pas affeoir un jugement fur de telles preuves ; le
juge doit chercher à inftruire plus amplement fa religion,
foit en ordonnant une nouvelle enquête, fi
c’eft en matière civile, ou en ordonnant un plus amplement
informé, fi c’eft en matière criminelle.
Si toutes les reffources font épuifées & que les
preuves ne foient pas claires , on doit dans le doute
prononcer la décharge de celui qui eft potiriiuvi,
plutôt que de le condamner.
Il faut néanmoins obferver qu’en fait de crimes
qui fe commettent fecrettement, tels que la forni»
cation, l’adultere, comme il eft plus difficile d’en
acquérir des preuves par écrit, & même par témoins,
on n’exige pas pour la condamnation* des coupables
que les preuves foient fi claires ; les lettres tendres
& pafiionnées, les colloques fréquens, la familiarité,
les tête-à-tête, les embraffemens, les baifers,
autres libertés, font des préfomptions très - violentes
du crime que l’on foupçonne, & peuvent tenir
lieu de preuve, ce qui dépend de la prudence dq^
juge.
Dans ces ca s, &c dans toutes les matières criminelles
en général, on admet pour témoins les dôme-
ftiques, & autres perfonnes qui font dans la dépendance
de l’accufé, attendu que ce font communément
les feuls qui puiffent avoir connoiflance du
crime, & que ce font des témoins néceffaires.
Sur la matière des preuves en général, on peut
voîr le titre de probationibus, au code &C aux inftitu-
tes, & encore celui de fide injlrumentorum, au code, •
le traité de probationibus par Oldendorp , celui de
> Mafcardus, le traité de la preuve par témoins, de
Danty, le titre ij. de l’ordonnance de 1667. On distingue
plufieurs fortes de preuves, lefquelles vont
être expliquées dans les fubdivifions fuivantes. ( ^ )
Preuve affirmative, eft celle qui établit direftement
un fait, comme quand un témoin dépofe de v ifu, à là
différence de la preuve négative, qui confifte feulement
à dire qu’on n’a pas vît telle chofe.
Preuve authentique, eft celle qui mérite une foi
pleine & entière, tel que le témoignage d’un officier'
public, qui attefte folemnellement ce qui eft pafîé
devant lui ; par exemple, un a&e paffé devant notaire
fait une preuve authentique des faits qui fe font
paffés aux yeux du notaire , & qu’il à âttefté' dans
cet aâe.
Preuve canonique, eft celle qui eft autorifée par les
canons, telle que la purgation canonique, qui fe fai-
foit par le ferment d’un certain nombre de perfon-
nes-que l’accufé faifoit jurer en fa faveur pour attef-
ter fon innocence, à la différence de la preuve vulgaire
que la fuppofition des peuples avoit introduites.
Voye^ Purgation canonique & Purgatiqn
Vulgaire.
Preuve par Commune renommée, eft celle que l’on
admet d’un fait dont les témoins n’ont pas une con-
noiffance de vifu, mais une fimple connoiflance fondée
fur la notoriété publique, comme quand ori admet
la preuve du fait qu’un homme à fon décès étoit
riche de cent mille écus, il n’eft pas befoin que les
témoins difient avoir vu chez lui cent mille écus d’ef-
peces au moment de fon décès, il fuffit qu’ ils dépo.*
lent qu’ils croyoient cet homme riche de cent mille
écus, & qu’il paffoit pour tel. Il ne doit pas dépens
dre des témoins de fixer le plus ou le moins de l’objet
dont il s’agit, comme d’attefter qu’un homme étoit
riche de cent mille francs , ou de deux cens mille
francs, c’eflr au juge à fixer la fomme qui eft en con-
teftation, & fur le fait de laquelle les témoins doivent
dépofer. Voye[Commune renommée.
Preuve par comparaifon d'écritures, eft celle qui fe
fait pour la vérification d’un écrit ou d’une fignature,
en les comparant avec d’autres écritures ou fignatiw
res reconnues pour être de la main de celui auquel
on attribue l’écrit ou la fignature dont la vérité eft
conteftée. Voye[ Comparaison *d’écritures, &
le traité de la preuve par comparaifon d'écritures , par
M. le Vayer de Boutigny.
Preuve concluante, eft celle qui prouve pleinement
le fait en queftion, de maniéré que l’on peut con-i
dure de cette preuve que le fait eft certain,
Preuve démonjlrative, eft celle qui établit le fait
d’une mamere fi folide que l’on eft certain qu’il .ne
peut être faux; il n’y a que les vérités de principe
qui puiffent être prouvées de cette maniéré, ear
pour les vérités de fait, quelques complettes que
paroiffent les preuves que l’on en peut apporter,
■ elles ne font jamais démonftratives.
Preuve directe, eft celle qui prouve directement le
■ fait dont il s’agit, foit par des actes authentiques ou
par témoins, à la différence de la preuve oblique ou
indirecte, qui ne prouve pas précifément le fait en
queftion, mais qui conftate un autre fait de la preuve
duquel on peut tirer quelque conféquence pour le
fait en queftion.
Preuve domeflique, eft celle qui fe tire des papiers
domeftiques de quelqu’un, ou de la dépofition de
fa femme, de fes enfans & domeftiques.
Preuve écrite ou preuve par écrit, qu’on appelle aufli
preuve littérale, eft celle qui fe tire de quelque écrit,
foit public ou privé, à la différence de la preuve non-
écrite, qui fe tire de quelque fait ou de la dépofition
des témoins.
Preuve géminée, eft celle qui fe trouve double &
triple fur un même fait.
Preuve imparfaite, eft celle qui n’établit pas fufiî-
famment le fait en queftion, foit que les témoins ne
foient pas en nombre fuffifant, foit que leurs dépolirions
ne foient pas affez précifes.
Preuve indirecte ou oblique, elt quand le fait dont il
s’agit n’eft pas prouvé précifément par les aCtes ou
par la dépofition des témoins, mais un autre fait de
la preuve duquel on peut tirer une conféquence de
la vérité de celui dont il s’agit. Voye£ Preuve di-.
RECTE.
Preuve juridique, eft celle qui eft félon le droit ad-
mife en juftice.
Preuve littérale , eft la. même chofe que la preuve
écrite ou par écrit ; on l’appelle littérale, parce que
çe fout les lettres qui forment l’écriture, & que
d’ailleurs anciennement on appelloit lettres tout écrit.
- Preuve muette, eft celle qui fe tire de certaines circonftances
& préfomptions qui fe trouvent établies
indépendamment des preuves écrites & de la preuve
teftimoniale. Voye^ Indice & Présomption.
Preuve nèceffiairement véritable, eft celle qui établit
le fait contelté, de maniéré qu’il n’eft pas poflible
eu’il ait été autrement ; par exemple, qu’une per-
fonne n’a point paffé une obligation à Paris un certain
jour, quand il eft prouve que ce même jour il
étoit à Bourges. Voye[ Preuve vraissemblable.
Preuve négative , eft celle qui n’établit pas directement
le fait, en queftion, comme quand un témoin
ne dit pas que l’accufé n’a pas fait telle chofe, mais
feulement qu’il ne lui a pas vu faire. Voye^ Preuve
affirmative.
Preuve non écrite, eft celle qui réfulte de faits non
écrits, ou de la dépofition des témoins. Voyeç Preuv
e écrite.
. Preuve oblique, eft la même chofe que preuve indirecte.
Voyeç ci-devant Preuve indirecte & Preuv
e directe. •
Preuve pleine & entière, eft celle qui eft parfaite &
concluante, & qui établit le fait en queftion d’une
maniéré conforme à la loi.
Semi-preuve, eft celle qui eft: imparfaite, comme
celle qui réfulte de la dépofition d’un feul témoin ;
tels font aufli les Amples indices ou préfomptions de
•droit. Voyei Indice & Présomption.
Preuve par Jirment, eft celle qui réfulte du ferment
déféré par le juge ou par la partie. Voye^ Serment.
Preuve par témoins ou teftimoniale, qu’on appelle
aufli preuve vocale, eft celle qui réfulte de la dépofition
des témoins entendus dans une enquête ou information.
VCryei TÉMOINS.'
Preui'e par titres, eft la même chofe que preuve littérale
; on comprend ici fous le terme de titres toutes
fortes d’écrits, fpit authentiques ou privés.. On
permet ordinairement de faire preuve d’un fa it, tant
par titres que par témoins.
Preuve vraisemblable, eft celle qui eft fondée fur
quelque préfomption de droit ou de fait, cette preuve
eft moins forte que là preuve néceffairement véritable
dont on a parlé ci-devant. Voye^ Danty, en fes
obfervations fu r l 'avant-propos.
Preuve vulgaire, étoit celle qui fe faifoit par les
epreuves fuperftitieufes, qu’on appelloit jugemens de
Dieu, telle que l’épreuve de l’eau bouillante & de
l’eau froide, du fer ardent, du combat en champ clos,
de la c roix, &c autres femblables. Voye1 Purgation
vulgaire»
Preuve , en terme de Paffineur de fucre; n’eft autre
chofe que l’effai que le raffineur fait de la cuite pour
juger du degré de cuiffon qu’elle a acquis, lui laiffer
prendre celui qui lui eft neceffaire, & faire éteindre
les feux quand elle y eft parvenue. On le connoît par
le moyen d’un filet defuite que le raffineur tire entre
fes deux doigts en pompant avec le premier doigt de
cette matière bouillante qu’il a fur- fon pouce, & en
tournant le dedans du pouce en haut afin d’arrêter le
fil. Il faut que cela foit fait d’un feul coup-d’oeil ; l’épreuve
eft proprement le fecret du raffineur. Effectivement
il n’y a que lui dans la raffinerie qui ait cette
connoiflance. Elle demande de la capacité dans celui
qui la poflede. Il ne fuffit pas d’avoir le coup d’oeil
sûr; il y a des tems fombres oii il devient inutile :
alors ç’eft par l’oreille feule, c’eft au bruit du bouillon
que le contremaître eft obligé de prendre la
preuve. Voye{ CONTREMAITRE.
PRIAMAN , ( Géog. mod. ) ville des Indes, dans
l^le de Sumatra, fur fa côte occidentale, entre Ticou
au nord, & Padang au midi, à l’embouchure de la
riviere de même nom. Elle dépend du royaume d’A-
chem ; fon commerce Confifte en poivre.
PRIAMUM, (Géogr. ancé) i ° . ville des Dalmates*
Strabon, l, V IL p. 3 / J. dit que ce fut une de celles
qu’Augufte réduifit en cendres. z °. Priamum ou Pria-
mi urbs, ville de ce nom aux environs de la Phrygie ,
félon Arien, qui dit qu’elle ouvrit fes portes à Alexandre.
Il eft aufli parlé de cette ville dans le troifie-.
me concile d’Ephèfe. (Z>. / .)
PRIAPE D E M E R , ( Hifi. nat. ) infefte de mer;
auquel on adonné ce nom à caufe de fa forme cylindrique.
Cet infeéte refte attaché aux rochers qui font
au fond de la mer ; il eft couvert d’une forte de cuir
dur ; il fe gonfle & s’allonge, ou il fe rapetifle à fon
gré ; il a deux ouvertures, l’une pour tirer l’eau &:
l’autre pour la rejetter : dès qu’il eft mort il devient
flafque. Rondelet, hijl. des [oophites, ch. x x. Voye^
ZOQPHITE.
Priapé, f. m. (Mythol.) dieu de la Mythologie,
fi nouveau qu’Héfiode n’en fait aucune mention. La
Fable dit que ce dieu étoit fils de Bacchus & de V énus.
Juuon, jaloufe de la déeffe des grâces , fit tant
par fes enchantemens, qu’elle rendit monftrueux &
contrefait l’enfant que Vénus portoitdans fon foin.
Aufli-tôt qu’elle l’eut mis au monde, elle l’éloigna
de fa préfence, & le fit élever à Lampfaque, où il
devint la terreur des maris, ce qui le fit chaffer de
cette ville ; mais les habitans affligés d’une maladie
extraordinaire, crurent que c’étoit une punition du
mauvais traitement qu’ils avaient fait au fils de Vénus
; ils le rappellerent chez eux ; & dans la fuite, il
devint l’objet de la vénération publique. Priape eft
appelle dans les poètes hellefpontique, parce que
Lampfaque étoit fituée fur l’Hellefpont dans l’Afie
mineure.
Priape étoit le dieu des jardins ; on croyoit que
e’étoit lui qui les gardoit & Usffaifoit fru&ifier. C’eft