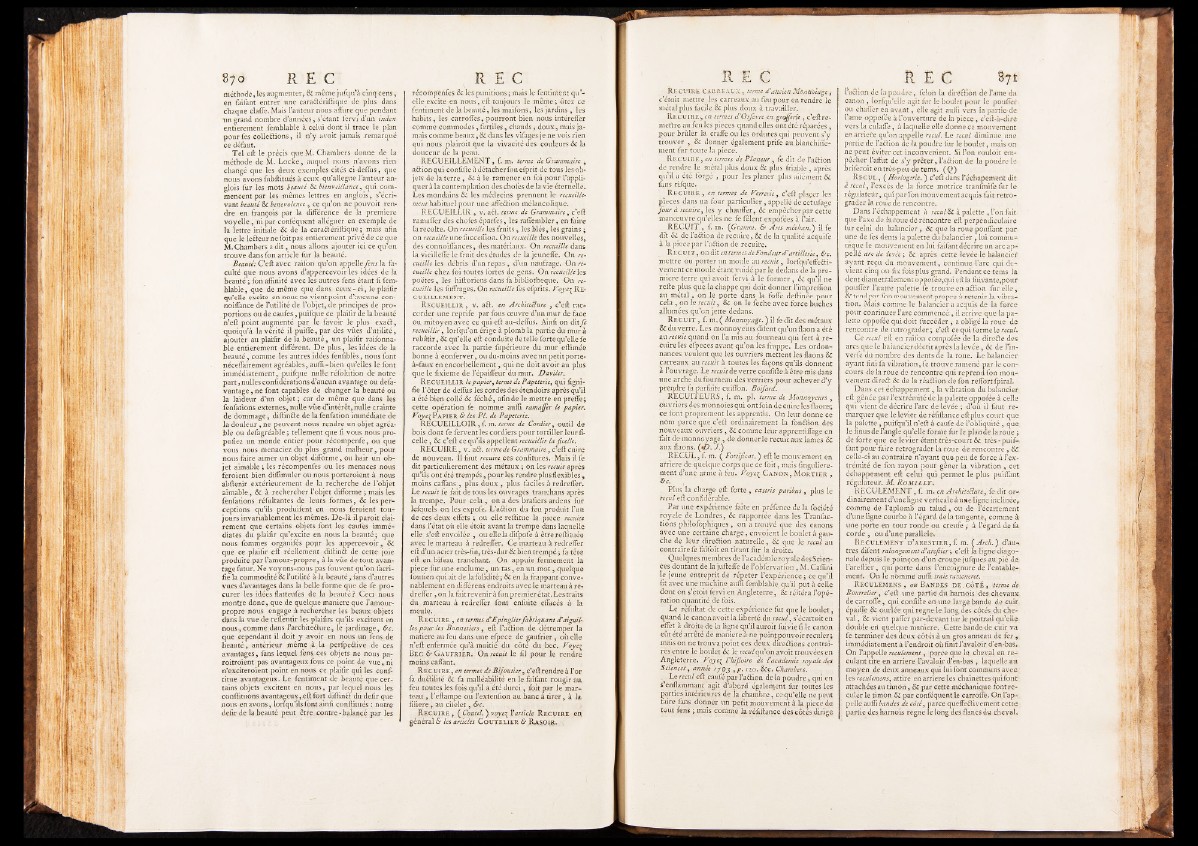
méthode, les augmenter, & même jufqu’à cinq cens,
en faifant entrer une caraélériftique de plus dans
chaque claffe. Mais l’auteur nous allure que pendant
-un grand nombre d’années, s’étant fervi d’un index
entièrement femblable à celui dont il trace le plan
pour fes colle rions, il n’y avoit jamais remarqué
ce défaut.
Te l eft le précis queM. Chambers donne de la
méthode de M. Locke, auquel nous n’avons rien
changé que les deux exemples cités ci deflus , que
nous avons fubftitués à ceux qu’allegue l’auteur an-
glois fur les mots beauté 8c bienveillance, qui commencent
par les mêmes lettres en anglois, s’écrivant
beauté 8c benevolence , ce qu’on ne pouvoit rendre
en françois par la différence de la première
v o y e lle , n i par conféquent alléguer en exemple de
la lettre initiale 8c de la caraûériftique; mais afin
que le lefteur ne foitpas entièrement privé de ce que
M. Chambers a d it, nous allons ajouter ici ce qu’on
trouve dans fon article fur la beauté.
Beauté: C’ eft avec raifon qu’on appelle fens la faculté
que nous avons d’appercevoir les idées de la
beauté ; fon affinité avec les autres fens étant fi femblable,
que de même que dans c e u x -c i, le plaifir
qu’elle excite en nous ne vient point d’aucune con-
noiffance de l’utilité de l’objet, de principes de proportions
ou de caufes, puifque ce plaifir de la beauté
n’eft point augmenté par le favoir le plus e x aft,
quoiqu’à la vérité il puiffe, par des vues d’utilité,
ajouter au plaifir de la beauté, un plaifir raifonna-
ble entièrement different. De plus , les idées de la
beauté, comme les autres idées fenfiblës, nous font
néceffairement agréables, auffi-bien qu’elles le font
immédiatement, puifque nulle réfolution de notre
part, milles confédérations d’aucun avantage ou defa-
vantage, né font capables de changer la beauté ou
la laideur d’un objet; car de même que dans les
fenfatïons externes, nulle vue d’ intérêt, nulle crainte
de dommage, diftinfte de la fenfation immédiate de
la douleur , ne peuvent nous rendre un objet agréable
ou defagréable ; tellement que fi vous nous pro-
pofiez un monde entier pour récompenfe, ou que
vous nous menaciez du plus grand malheur, pour
nous faire aimer un objet difforme, ou haïr un objet
aimable ; les récompenfes ou les menaces nous
feroient bien diflimuler ou nous porteroient à nous
abftenir extérieurement de la recherche de l ’objet
aimable, & à rechercher l’objet difforme ; mais les
fenfations réfultantes de leurs formes, & les perceptions
qu’ils produifent en nous feroient toujours
invariablement les mêmes. De-là il paroit clairement
que certains objets font les caufes immédiates
du plaifir qu’excite en nous la beauté ; que
nous fommes organifés pour les appercevoir, 8c
que ce plaifir eft réellement diftinô de cette joie
produite par l’amour-propre, à la vue de tout avantage
futur. Ne voyons-nous pas fouvent qu’on facri-
fie la commodité & l’utilité à la beauté ,■ fans d’autres
vues d’avantages dans la belle forme que de fe procurer
les idées flatteufes de la beauté ? Ceci nous
montre donc, que de quelque maniéré que l’ainour-
propre nous engage à rechercher les beaux objets
dans la vue de refléntir les plaifirs qu’ils excitent en
nous, comme dans l’architefture, le jardinage, &c.
que cependant il doit y avoir en nous un fens de
beauté, antérieur même jà la perfpe&iye de ces
avantages, fans lequel fens, ces objets ne nous pa-
roitroient pas avantageux fous ce point de vue, ni
n’exciteroient point en nous, ce plaifir qui les conf-
titue avantageux. Le fentiment de beauté que certains
objets excitent en nous, par lequel nous les
conftituons avantageux,eft,fort diftinâ: du defir que
nous en avons, lorfqu’ilsfont ainfi conftitués : notre
defir de la beauté peut être, contre-balancé par les
récomp'ènfes êc lés punitions ; mais îe fentiniènt qu’elle
excite en nous, eft toujours le même; ôtez ce
fentiment de la beauté, les maifons, les jardins , les
habits, les carroffes, pourront bien nous intéreflér
comme commodes, fertiles, chauds, doux, mais jamais
comme beaux, & dans les vifages je ne vois rien
qui nous plairoit que la vivacité des couleurs 8c la
douceur de la peau.
RECU E ILLEMENT, f. m. terme de Grammaire
aftionqui confifte à détacher fon efprit de tous les oh-
jets de la terre , Sd à le ramener en foi pour l’appliquer
à la contemplation des chofes de la vie éternelle.
Les mondains 8c les médecins prennent le recueillement
habituel pour une affeâion mélancolique.
RECU E ILL IR , V. a<ft. terme de Grammaire, c’eft
ramafl'er des chofes éparfes, les rafièmbier, en faire
la récolté. On recueille les fruits, les.blés, les grains ;
on recueille une fiicceffion. On recueille des nouvelles,
des connoiflances, des matériaux. On recueille dans
la vieilleffe le fruit des études de la jeuneffe. On recueille
les débris d’un repas , d’un naufrage. On recueille
chez foi toutes fortes de gens. On recueille les
poètes, les hiftoriens dans fa bibliothèque. On recueille
les fuffrages. On recueille fes efprits. Voye^ R ec
u e i l l e m e n t .
R e c u e i l l ir , y . aft. en Architecture , c’ eft raccorder
une reprife par fous oeuvre d’un mur de face
ou mitoyen avec ce qui eft au-deflus. Ainfi on dit fe
recueillir, lorfqu’on érige à plomb la partie du mur à
rebâtir, & qu’elle eft conduite de telle forte qu’elle fe
raccorde avec la partie fupérieure du mur eftimée
bonne à conferver, oudu-moins avec un petit porte-
à-faux en encorbellement, qui ne doit avoir au plus
que le fixieme de l’épaiffeur du mur. Daviler.
RECUEILLIR le papier, terme de Papeterie, qui lignifie
l ’ôter de deflus les cordes des étçndoirs après qu’il
a été bien collé 8c féché, afin de le mettre en prefle;
cette opération fe nomme auffi ramaffer le papier.
Voye\ P a p i e r & les PL de Papeterie.
R ECU E ILLO IR , f. m. terme de Cordier, outil de
bois; dont fe fervent les cordiers pour tortiller leur ficelle
, & c’eft ce qu’ils appellent recueillir la ficelle.
R E C U IR E , v . ad. termede Grammaire, c’eft cuire
de nouveau. I l faut recuire ces confitures. Mais il fe
dit particulièrement des métaux ; on les recuit après
qu’ils ont été trempés, pour les rendre plus flexibles,
moins caftans , plus d ou x , plus faciles à redreflér.
Le recuit fe fait de tous les ouvrages tranchans après
la trempe. Pour c e la , on a des brafiers ardens fur
lefquels on les expofe. L ’a&ion du feu produit l’un
de ces deux effets ; ou elle reftitue la piece recuits
dans l’ état où elle étoit avant la trempe dans laquelle
elle s’eft envoilée , ouelleladifpofe à être reftituée
avec le marteau à redreffer. Ce marteau à. redreffer
eft.d’un acier très-fin, très-dur 8cbien trempé; fa tête
eft en.bifeau tranchant. On appuie fermement la
piece fur une enclume, un tas, en un mot, quelque
ïoutien qui ait de lafoiidité; 8c en la frappant convenablement
en différens endroits avec le marteau à redreffer
, on la fait revenir à fon premier état. Les traits
du marteau à redreffer font enfuite effacés à la
meule.
RECUIRE , en termes diEpinglierfabriquant d?aiguilles
pour les Bonnetiers, eft l’atfion de détremper la
matière au feu dans une efpece de gaufrier, oh. elle
n’eft enfermée qu’à moitié du côté du bec. Voyez
B e c & G a u f r i e r . Ôn recuit le fil pour le rendre
moins caffant.
R é c u i r e , en termes de Bijoutier, ç’eftrendre à l’or
fa duâilité 8c fa malléabilité en le faifant rougir au.
feu toutes les fois qu’il a été durci, foit par le marteau
, l ’eftampe ou l’extenfion au banc a tirer, à la
filiere, au cifelet, &c.
R e c u i r e , ( Coutel. ) ,y q y ^ Y article R e c u i r e en
général & les articles COUTELIER & R a so ir .
R e c u ir e c a r r e a u x , terme d'ahcienMbnfioiage,
c’étoit mettre , les carreaux au feu pour en rendre le
métal plus facile & plus doux à travailler.
R e c u i r e , en termes d'Gtfevre en groffe/ie, c’eftre-
met'tre au feu les pièces quand elles ont été réparées,
pour brûlèr la craffe ou les ordures qui peuvent, s’y
trouver , 8c donner également prife au blanchiffe4
ment fur toute la piece.
R e c u i r e , en termes de Planeur, fe dit de l’aélion
de rendre -le métal plus doux 8c plus friable , après
qu'il a été forgé , pour les planer plus aifément 8c
fans rifque.
R e c u i r é , eh termes de Verrerie, c’eft placer les
pièces dans Un four particulier, appelle de cetufage
four à recuire, les y chauffer, 8c empêchér par cette
manoeuvre qu’elles ne fe fêlent expôféesà l’air.
R ECU IT , fi m. (Gramm. & Arts médian.) il fe
dit & . de l’a â io n de re cu ire , 8c de la qualité acquifé
a là piece pa r i’attion de re cuite.
R E C U IT , on dit en termes de Fondeur d'artillerie, &c.
mettre ou porter un moule au recuit, lorfqu’effeûi«-
vement ce moule étant vuidé par le dedans de la première
terre qui avoit ie rvi à le former , 8ç qu’il ne
refte plus que la chappe qui doit donner l’impreffion
au métal, on le porte dans la foffe deftinée pour
cela , on le recuit, 8c on le feche avec force bûches
allumées, qu’on jette dedans.
R e c u i t , fi m. ( Monnayage. ) il fe dit des métaux
8c du verre. Les monnoyeurs difent qu’un flaon a été
au recuit quand on fa mis au fourneau qui fert à recuire
les efpeces avant qu’on les frappe. Les ordonnances
veulent que les ouvriers mettent les flaons 8c
carreaux au recuit à toutes les façons qu’ils donnent
a l’ouvrage. Le recuit de verre confifte à être mis dans
une arche dufourheau des verriers pour achever d’y
prendre fa parfaite cuïflbn. Boifard.
RECUI1 E U R S , fi m. pl. terme de Monnoyeurs ,
ouvriers des monnoies qui ont foin de cuire les flaons;
ce font proprement les apprentis. On leur donne ce
nom parce que, c’eft ordinairement la fon&ion des
nouveaux ouvriers , 8c comme leur apprentiffage en
fait de monnoyage, de donner le recuit aux lames 8c
aux fla,ons. (fiD. J.')
R È C Ü L , f. m. ( Fortifient. ) eft le mouvement en
arriéré de quelque corps que ce Toit, mais finguliere-
ment d’une arme à feu. Voyez C anon , Mo r t i e r ,
&c. ,
Plus la charge eft forte , cceteris parïbus , plus le
recul eft considérable.
, Par une expérience faîte en préfence de la fociété
royale dé Londres, 8c rapportée dans les Tranfae-
tions philofôphiques , on a trouvé que des canons
avec une certaine charge, envoient le boulet à gauche
de leur dire&ion naturelle, 8c que le recul au
contraire fe faifoiten tirant fur la droite.
Quelques membres de l’académie royale des Sciences
doutant de la jufteffe de i’obfervation, M. Gafîini
le jeune entreprit de répéter l’expérience ; ce qu’il
fit avec une machine auffi femblable qu’il put à celle
dont on s’étoit fervi en Angleterre, 8c réitéra l’opération
quantité de fois.
Le réfulfiat de cette eXpérience fut que le boulet,
quand le çanon.avoit la liberté du recul, s'écartait en
effet à droite de la ligne qu’il auroit fiiivie fi le canon
eût été arrêté de maniéré à ne point pouvoir reculer;
mais on ne trouva point ces deux direûiôns contraires
entre le boulet 8c le recul qu’on avoit trouvées en
Angleterre. Vl>ye[ l'hifloire de Ûacademie royale des
Sciences, année \j q $ rp.'i2o. <kç. Chambers.
. Le recul eft. caufé par l’aftion de la poudre, qui en
S’ enflammant agit d’abord égalen'jent fur toutes les
parties intérieurès de îa chambre, ce qu’elle ne peut,
faire fans donner un petit mouvement à la.piece de
tout fens ; mais comme la réfiftance des côtes dirige
I aclion de îa poudre, félon là. direfHôn de l’attie du
canon, lorfqu’elle agit fur le boulet pour le pouffer
ou chaffer en avant, elle agit auffi vers la partie'de
1 ame oppofé'e à l’ouverture de la p iece, e’eft-à-dirô
vers la culafle, à laquelle elle donne ce mouvement
en arriefe qu’on appelle recul. Le recul diminue une
partie de l’aâion de la poudre fur le boulet, mais on
ne peut éviter cet inconvénient. Si l’on vouloit empêcher
l’affiit de s’y prêter, l’aôiort de la poudre le
briferoit en très-peu de tems. ( Q)
R e c u l , ( Horlogerie. ) e’eft dans l’échapem'ent dit
a recul, l’excès de la force motrice tranlmife fur le
regulateür, qui par fon mouvement acquis fait rétrograder
la roue de rencontre.
Dans l’échappement à récà/8c à palette , l’ôn fait
que l’axe de la roue dé rènçôritre eft pefpéndiculaire
fur celui du balancier, 8c que la roue pouffant par
une de fes dents la palette du balancier , lui commit*
nique le mouvement en lui faifant décrire un arc ap^
pelle arc de levée ; 8c après cette levée le balancier
ayant reçu du mouvement, continue -l’arc qui de-4
vient cinq ou fix fois plus grand. Pendant ce tems la
dent diamétralement oppofée,qui eft la fuivante,pour
pouffer l ’autre palette fe trouve en a&ion fur elle,
8c tend par fon mouvement propre à retenir, la vibration.
Mais comme le balancier a acquis de la force
pour conrinüer l’arc commencé., il arrive que la palette
oppofée qui doit fuccéder -, a obligé la roue de
rencontre de rétrograder ; c’eft ée qui forme le recul-.
Ce recul eft en raifon compofée de la direéfe des
arcs que le balancier décrit après la le v é e , 8c de l’in-
verfe du nombre des dents de la ro.ue. Le balancier
ayant fini fa vibration, fe trouve ramené par le concours
de la roue de rencontre qui reprend fon mouvement
direét 8c de la réaétion de fon reffortfpiral.
Dans cet échappement, la vibration du balanciez
eft gênée par l’extrémité de la palette oppofée à celle
qui vient de décrire l’arc de levée ; d*où il faut remarquer
que le levier de réfiftance eft plus court que
la palette , puifqu’il n’eft à caufe de l’obliquité , que
le finus de l’angle qu’elle foriAe furie plan de. la roue ;
de forte que ce levier étant très-court 8c très - puif-4-.
fant pour faire rétrograder la roue de rencontre , 8c
celle-ci au contraire n’ayant qiie peu de force à l’extrémité
de fon rayon pour gêner la vibration , cet
échappement eft celui qui permet le plus puiffanfe
régulateur. M. R o m il l Yi
R ECU LEM EN T , f. m. en Architecture, fe dit or-4
dinairement d’uneligne verticale à une ligne inclinée,
comme de l’aplomb au talud, ou de l’écartement
d’uneligne courbe à l’égard de la tangente, comme à
une porte en tour ronde ou creufe } à l’égard de fa
corde , ou d’une parallelei .
R e g u l e m e n t d ’a r e s t i é R , fi m. ( Arch. ) d’au-«,
très, difent ralongenïent diarefiier ; g’eft l'a ligne diagonale
depuis le poinçon d’un croupe jufques au pie d e
l’areftier, qui porte dans l’encoignure de l’entablement.
On le nommé auffi irait ràmcneret,
R e c u l em e n s , ou B a n d e s d e .c ô t é , terme dè
Bourrelier, c’eft une partie .du harnois des chevaux
de carrofle , qui confifte eri. une large bande de cuir
épaiffè 8c ourlée qui régné le long des. côtés du che-4
val ', 8c vient paffer par-devant fur le .poitrail qu’elle
double eri quelque maniéré. Cette bande, de cuir va
fe terminer des, deux côtés à un gros anneau de fer ,
immédiatement à l’ endroit oh finit l ’avalôir d’en-bas.
On l’appelle reculement, parce que Iq .chevaf en re.-4
culant tire en arriéré l’avaloir d’en-bas , laquelle au
moyen de deux anneaux qui lui font commurts avec ‘
les reculemens, attiré en arriéré, jes chaînéttes qui font
attachées au timOri, 8c par cette méchanique fpntre-*
culër le timon 8c par conféquent le carroffe. On.l’appelle'
dxÆbandes de côté, parce queffeftivement cetté
partie des harnois régne le long des flancs du cheval«