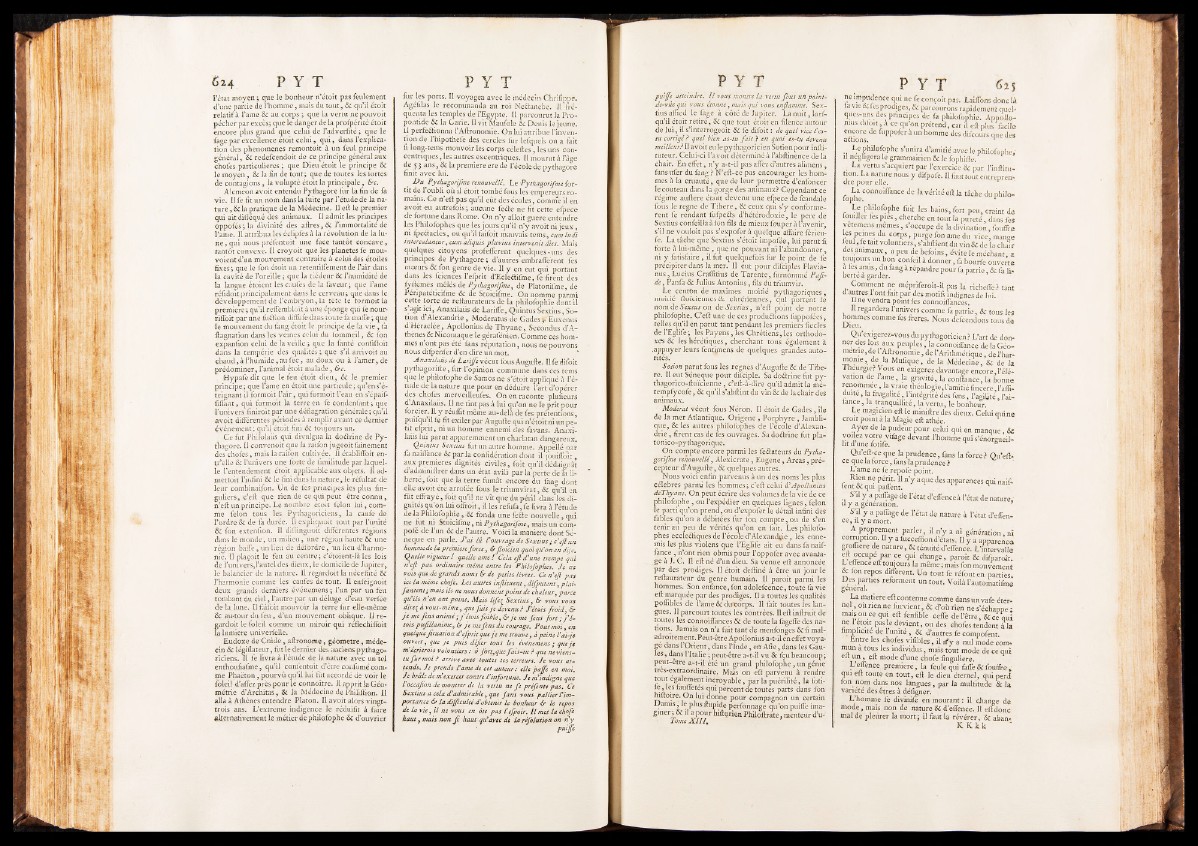
624 P Y T
l’état moyen ; que le bonheur n’ étoit pas feulement
d’une partie de l’homme, mais du tout, 6c qu’il étoit
relatif à l’ame 6c au corps ; que la vertu ne pouvoit
pécher par excès; que le danger de la profpérité étoit
encore plus grand que celui de l’adverlité ; que le
Page par excellence etoit celui, q u i, dans l’explication
des phenomenes remontoit à un feu! principe
général, &c redefcendoit de ce principe général aux
chofes particulières ; que Dieu étoit le principe 6c
le m oyen, & la fin de tout ; que de toutes les lortes
de contagions, la volupté étoit la principale, &c.
Alcméon avoit entendu Pythagore fur la fin de fa
vie. Il fe fit un nom dans la fuite par l’étude de la nature
, 6c la pratique de la Médecine. Il eft le premier
qui aitdiffequé des animaux. Il admit les principes
oppofés ; la divinité des affres, & l’immortalité de
Pâme. Il attribua les éclipfès à la révolution de la lun
e , qui nous préfentoit une face tantôt concave,
tantôt convexe. Il croyoit que les planètes fe mou-
voientd’un mouvement contraire à celui des étoiles
fixes; que le fon étoit un retentiffementde l’air dans
la cavité de l’oreille ; que la tiédeur 6c l’humidité de
la langue étoient les cauies de la faveur ; que l’ame
réfidoit principalement dans le cerveau; que dans le
développement de l’embryon, la tête fe formoit la
première; qu'il reffembloit à une éponge qui fe nour-
riffoit par une fuûion diffufe dans-toute fa ma fié ; que
le mouvement du fang étoit le principe de la vie , fa
ftagnation dans les veines celui du fommeil, & fon
expanfion celui de la veille ; que la fanté confiftoit
dans la tempérie des qualités ; que s’il arrivoit au
chaud, à l’humide, au fe c , au doux ou à l’amer, de
prédominer, l’animal étoit malade, &c.
Hypafe dit que le feu étoit dieu, & le premier
principe; que l’ame en étoit une particule ; qu’en s’éteignant
il formoit l’a ir , qui formoit l’eau en s’épaif-
fiflant, qui formoit la terre en fe condenfant ; que
l ’univers finiroit par une déflagration générale ; qu’il
avoit différentes périodes à remplir avant ce dernier
événement; qu’il étoit fini 6c toujours un..
Ce fut Phiiolaiis qui divulgua la doârine de Pythagore.
Il convenoit que la raifon jugeoit fainement
des chofes, mais la railon cultivée, il établiffqit en-
tr’elle 6ç l’univers une forte de fnnilitude par laquelle
l’entendement étoit applicable aux objets. Il admettait
l’infini 6c le fini dans la nature, le réfultat de
leur combinaifon. Un de fes principes les plus fin-
guliers, c’eft que rien de ce qui peut être connu,
n’eft un principe. Le nombre étoit félon lu i, comme
félon tous les Pythagoriciens, la caufe de
l’ordre 6c de fa durée. Il expiiquoit tout par l’unité
3c fon extenfion. Il diflinguoit différentes régions
dans le monde, un milieu, une région haute 6c une
région baffe, un lieu de défordre, un lieu d’harmonie.
Il plaçoit le feu au centre; c’ étoient-là les lois
de l’univers,l’autel des dieux, le domicile de Jupiter,
le balancier de la nature. Il regardoit la nécefiité 6c
l’harmonie comme les caufes de tout. Il enfeignoit
deux • grands derniers événemens ; l’un par un feu
tombant du cie l, l ’autre par un déluge d’eau verfée
de la lune. Ilfaifoit mouvoir la terre fur elle-même
& au-tour du feu, d’un mouvement oblique. 11 regardoit
le foleil comme un miroir qui réflechiffoit
la lumière univerfelle.
Eudoxe de Cnidè , aftronome, géomètre, médecin
& légiflateur, fut le dernier des anciens pythagoriciens.
Il fe livra à l’étude de la nature avec un tel
enthoufiafme, qu’il confentpit d’être confumé comme
Phaëton, pourvu qu’il lui fut accordé de voir le
foleil d’affez près pour le .connoître. Il apprit la Géométrie
d’Architas, & la Médecine de Philiftion. Il
alla à Athènes entendre Platon. Il avoit alors vingt-
trois ans. L ’extrême indigence le réduifit à faire
alternativement le métier de philofophe 6c d’ouvrier
P Y T
fur les ports. Il voyagea avec le médecin Chrifippe.
Agéfilas le recommanda au roi Ne&anebe. Il fréquenta
les temples de l’Egypte. Il parcourut la Pro-
pontide 6c la Carie. Il vit Maufole 6c Denis le jeune.
Il perfectionna l’Aftronomie. On lui attribue l’invention
de l’hipothefe des cercles fur lefquels on a fait
fi long-tems mouvoir les corps céleftes , les uns concentriques
, les autres excentriques. Il mourut à l’âge
de 5 3 ans, 6c la première ere de l’école de pythagore
finit avec lui.
V u Pythagorifme renouvelle. Le Pythagorifme for-
tit de l’oubli où il etoit tombé fous les empereurs romains.
Ce n’eft pas qu’il eût des écoles, comme il en
avoit eu autrefois; aucune fefre ne fit cette efpece
de fortune dans Rome. On n’y alloit guere entendre
les Philofophes que les jours qu’il n’y avoit ni jeu x ,
ni fpeftacles, ou qu’il faifoit mauvais tems, cumludi
intercalantur, cum aliquis pluvius intervenu dits. Mais
quelques citoyens profefferent quelques-uns des
principes de Pythagore ; d’autres embrafferent fes
moeurs 6c fon genre de vie. Il y en eut qui portant
dans les fciences l’efprit d’Eclefrifme, fe firent des
lÿftèmës mêlés de Pythagorifme, de Platonifme, de
Peripateticifme 6c de Stoicifme. On nomme parmi
cette forte de reftaurateurs de la philofophie dont il
s agit ici , Anaxiiaiis de Lariffe, Quintus Sextius, Sotion
d’Alexandrie, Moderatus de Gades^ Euxenus
d’Héraclée , Apollonius de Thyan e , Secondus d’Athènes
bc Nicomaque le gérafénien. Comme ces hommes
n ont pas ete fans réputation, nous ne pouvons
nous difpenfer d’en dire un mot.
Anaxiiaiis de Lariffe vécut fous Augufte. Il fe difoit
pythagorifte, fur l’opinion commune dans ces tems
que le philofophe de Samosne s ’étoit appliqué à l’étude
de la nature que pour en déduire l’art d’opérer
des chofes merveilleufes. On en raconte piufieurs
d Anaxiiaiis. Il ne tint pas à lui qu’on ne le prît pour
forcer. Il y reuffit même au-delà de fes prétentions,
puifqu’il fe fit exiler par Augufte qui n’étoit ni un petit
elprit, ni un homme ennemi des favans. Anaxi-
laiis lui parut apparemment un charlatan dangereux.
Quintus Sextius fut un autre homme. Appellé par
fa naifiance 6c par la confidération dont il jouiflbit,
aux premières dignités civiles, foit qu’il dédaignât
d’adminiftrer dans un état avili par la perte de la liberté,
foit que la terre fumât encore du fang dont
elle avoit été arrofée fous le triumvirat, 6c qu’il en
fût effrayé, foit qu’il ne vît que du péril dans les dignités
qu’on lui offrait, il les refufa, fe livra à l’étude
d e là Philofophie, 6c fonda une fefre nouvelle, qui
ne fut ni Stoicifme, ni Pythagorifme, mais un compote
de 1 un 6c de l’autre. Voici la maniéré dont Sénèque
en parle. P ai lu Vouvrage de Sextius; c'eft un
.homme de la première force, & Jloïcien quoi qu'on en dije.
Quelle vigueur ! .quelle ame ! Cela efl d ’une trempe qui
r i efl pas ordinaire même entre les Philofophes. J e ne
vois que de grands noms & de petits livres. Cen'ejl pas
ici la même chofe. Les autres inflituent, difputent, plai-
fantent ; mais ils ne nous donnent point de chaleur, parce
qu ils n en ont point. Mais life^ Sextius, 6* vous vous
dirt{ a vous-même^ que fuis je devenu ? Pétois froid, 6*
j e me feus animé i j ’étois foible, & je me fens fort; j 'é -
lois pufillanime, 6* je nie fens du courage. Pour moi, en
quelque Jituation d’efprk que je me trouve , à peine l'ai-je
ouvert, que je puis défier tous les événemens ; que je
m’écrie rois volontiers : 6 fort,que fais-tu ? que ne viens-
tu fu r moi ? arrive avec toutes tes terreurs. Je vous attends.
Je prends Lame de cet auteur .* elle paffe en moi,
J e brûk de m!exercer contre Vinfortune. J e m'indigne que
Coccafion de montrer de la vertu ne f e préfentt pas. Ce
Sextius a cela d'admirable, que fans vous pallier P importance
(S* La difficulté d'obtenir le bonheur & le repos
de la v ie, i l ne vous en ôte pas l'efpoir. I l met la chofe
haut 9 mais non f i haut qu'avec de la réfolution on n'y
P Y T
puiffe atteindre. I l vous montre la vertu fous lift point-
de-vue qui vous étonne, mais qui vous enflamme. Sextius
aflîed le fage à côté de Jüpiter. La nuit, lorf-
qu’il étoit retiré, 6c que tout étoit en filence autour
de lui, il s’interrogeoit & fe difoit : de quèl vice t'es-
tu corrigé ? quel bien as-tu fa i t } en quoi es-tu devenu
meilleur? Il avoit eu le pythagoricien Sotion pour infti-
tùteur. Celui-ci l ’avoit déterminé à l’abftinence dé la
chair. En effet, n’y a-t-il pas affez d’autres alimens,
fànsufer du fang ? N’eft-ce pas encourager les hommes
à la cruauté, que de leur permettre d’enfoncer
le couteau dans la gorge des animaux? Cependant ce
régime auftere étant devenu une efpece de fcandale
fous le régné de Tibere, 6c ceux qui s’y conformèrent
fe rendant f’ufpe&s d’hétérodoxie, le pere de
Sextius confeilla à fon fils de mieux fouper à l’avenir,
s’il ne vouloir pas s’expofer à quelque affaire férieu-
fe. La tâche que Sextius s’étoit impofée, lui parut fi
forte à lui-même, que ne pouvant ni l ’abandonner,
ni y fatisfaire , il fut quelquefois fur le point de fe
précipiter dans la mer. Il eut pour difciples Flavia-
nus, Lucius Craflitius de Tarente, furnommé Pafi-
de, Panfa 6c Julius Antonius, fils du triumvir.
Le centon de maximes moitié pythagoriques,
moitié ftoïciennes 6c chrétiennes, qui portent lé
nom de S ex tus ou de Sextius, n’eft point de notre
philofophe. C’eft une de ces produirions fuppofées ,;
telles qu’il en parut tant pendant les premiers fiecles
de l’Eglife ; les Payens, les Chrétiens, les orthodoxes
6c les hérétiques, cherchant tous également à
.appuyer leurs fentÿnens de quelques grandes autorités.
Sotion parut fous les régnés d’Augufte 6c de Tibere.
Il eut Séneque pour difciple. Sa doftrine fut py-
thagorico-ftoïcienne , c’eft-à-dire qu’il admit la mé-
tempfycofe, & qu’il s’abftint du vin 6c de la chair des
animaux.
Modérât vécut fous Néron. Il étoit de Gades, île
de la mer Atlantique. Origene , Porphyre , Jambli-
que, & les autres philofophes de l’ecole d’Alexandrie
, -firent cas de fes ouvrages. Sa doûrine fut pla-
tonico-pythagorique.
On compte encore parmi les feftateurs du Pythagorifme
renouvellé, A lexicrate, Eugene, Areas, précepteur
d’Augufte, & quelques autres.
Nous voici enfin parvenus à un des noms les plus
célébrés parmi les hommes ; c’ eft celui d’Apollonius
deThyane. On peut écrire des volumes de la vie de ce
philofophe, ou l’expédier en quelques lignes, félon
le parti qu’on prend, ou d’expofer le détail infini des
fables qu’on a débitées fur fon, compte, ou de s’ en
tenir au peu de vérités qu’on en fait. Les philofophes
ecclefriques de l’école d’Alexandrie, les ennemis
les plus violens que l’Eglife ait eu dans fa naif-
fance , n’ont rien obmis pour l’oppofer avec avantage
à J. C . Il eft né d’un dieu. Sa venue eft annoncée
par des prodiges. Il étoit deftiné à être un jour le
reftaurateur du genre humain. Il paroît parmi les
hommes. Son enfance, fon adolefcence, toute fa vie
eft marquée par des prodiges. Il a toutes les qualités
poflïbles de l’ame 6c durcorps. Il fait toutes les langues.
Il parcourt toutes les contrées. Il eft inftruit de
toutes les connoiffances 6c de toute la fageffe des nations.
Jamais on n’a fait tant de menfonges & f i maladroitement.
Peut-être Apollonius a-t-il en effet voyagé
dans l’Orient, dans l’Indè, en Afie, dans les Gaules
, dans l’Italie ; peut-être a-t-il vu & fçu beaucoup;
P®ut“ etre a-t-il été un grand philofophe , un génie
très-extraordinaire. Mais on eft parvenu à rendre
tout egalement incroyable, par la puérilité, la foti-
fe lesfauffetés qui percent de toutes parts dans fon
hiftoire. On lui donne pour compagnon un certain
Damis, le plus ftupide perfonnage qu’on puiffe imaginer
; 6c il a pour hiftçrien Philoftrate, menteur d’u-
Tome X I I I ,
P Y T 6a*
fie împii Jencé qui ne fe conçoit pas. Laiiïons donc là
ia vie&fesprodiges, & parcourons rapidement quel'
ques-uAs des principes de fa philofophie, Appollo-
mus diioitj à ce qu’on prétend, car il efl:plus facile
encore ne fuppofer à un homme des difeours que deü
actions. ^
Le philofophe s’unira d’amitié avec le philofophe;
il négligera le grammairien 6c le fophifte»
. La vertu s’acquiert par l’exercice & par l’inftitu-
tion. La nature nous y difpofe. Il faut tout entreprendre
pour elle.
La connoiflance de la vérité eft ia tâche du philo-
lophe. 1
I fr-ù les bains, fort peu, craint da
lourllfr les pies, cherche en tout ia pureté , dans fes
vdtemene memes'i s’ occupe de la divination, fouffrê
les peines du corps, phrgefon ame du vice,-mange
H U S volontiers, s’abliient du vin & de B chair
des,fmmaux, a peu de befôins, éviteleméchant a
toujours un bon confeil à donner, fa bourfe ouverte
à les amis, du fang à répandre pour fa patrie, & fa li-
berte à garder. .. ’
Une vendra point fe^çonnoiffançes', :, :
Il regardera l’univers comme fa patrie, & to u s les
nqmmes comm'e fes freres. Nous dépendons tous de
Dieu. •
Qu’exigerei-votîs du pythagoricien ? L ’art dp don-
ner des lqis a i» peuples, la connoiffance de la Géométrie,
de i Aftronomie, de l’Arithmétique , de l’har-
ÿ ;:,la Ml>%ae,.,de la, Médecine, & de la
l neurgie. Vous en exigerez davantage encore, l’élévation
de l ame, la gravité, la confiance, la bonne
renommee, la vraie théologie,l’amitié fincere ,1’aiïi-
diute, la frugalité, l’intégrité des fefts, l’agilité rai-
lance , la tranquillité, la vertu, le bonheur.
Le magicien eft le miniftre des dieux. Celui quine
croit point à la Magie eft athée.
Ayez de la pudeur pour celui qui en manque &
voilez votre vifage devant l’homme qui s’enorgueillit
d une lotife. o
Qu’eft-ce que la prudence, fans la force ? Ou’eft-
ce que la force, fans la prudence ?
L ’ame ne fe repofe point.
Rien ne pént. Il n’y a que des apparences qui naif-
lent 6c qui paffent. .
S’il y a paffage de l’état d’effence à l’état de nature;
u y a génération.
S’il y a paffage de l’état dé nature à l’état d’effence
, il y a mort.
A proprement parler,.1 1 nV a. ni .génération, ni
cornrptton. U y a iucceffion d’e'tats. Il y a apparenca
grofliere de nature, & ténuité d’effence. L ’intervalle
eft occupe par ce qui change, paroît & difparcât.
L efleiice ëfl toujours ia même ; mais fon mouvement
“ lon rePQS mffererïtl Un- tout fe réfout en parties.
Des parues reforment un tout. Voilà l’automatifme
general.
La matière eft contenue comme dans un vafe éter»
n e l, où rien ne furvient, 6c d’où rien ne s’échappe ;
maison ce qiu eft fenfible ceffe de l’être, & ce qui
ne 1 etoit pas le devient, ou des chofes tendent J la
limplicite de 1 unité , 6c d’autres, fe compofent.
Entre les chofes vifibles, il r fy a nul mode commun
a tous les individus, mais tout mode de ce qui
eft u n , eft mode d’une chofe finguliere.
L effence première, la feule qui faffe 6c foutfre ;
qui eft toute en tout, eft le dieu éternel, qui perd
fon nom dans nos langues , par la multitude & la
variété des êtres à défigner.
L ’homme fe divinife en mourant i il change de
mode, mais non de nature & d’effence.. Il eft donc
mal dé pleurer la mort; il faut la révérer, & aban-
K Kkk