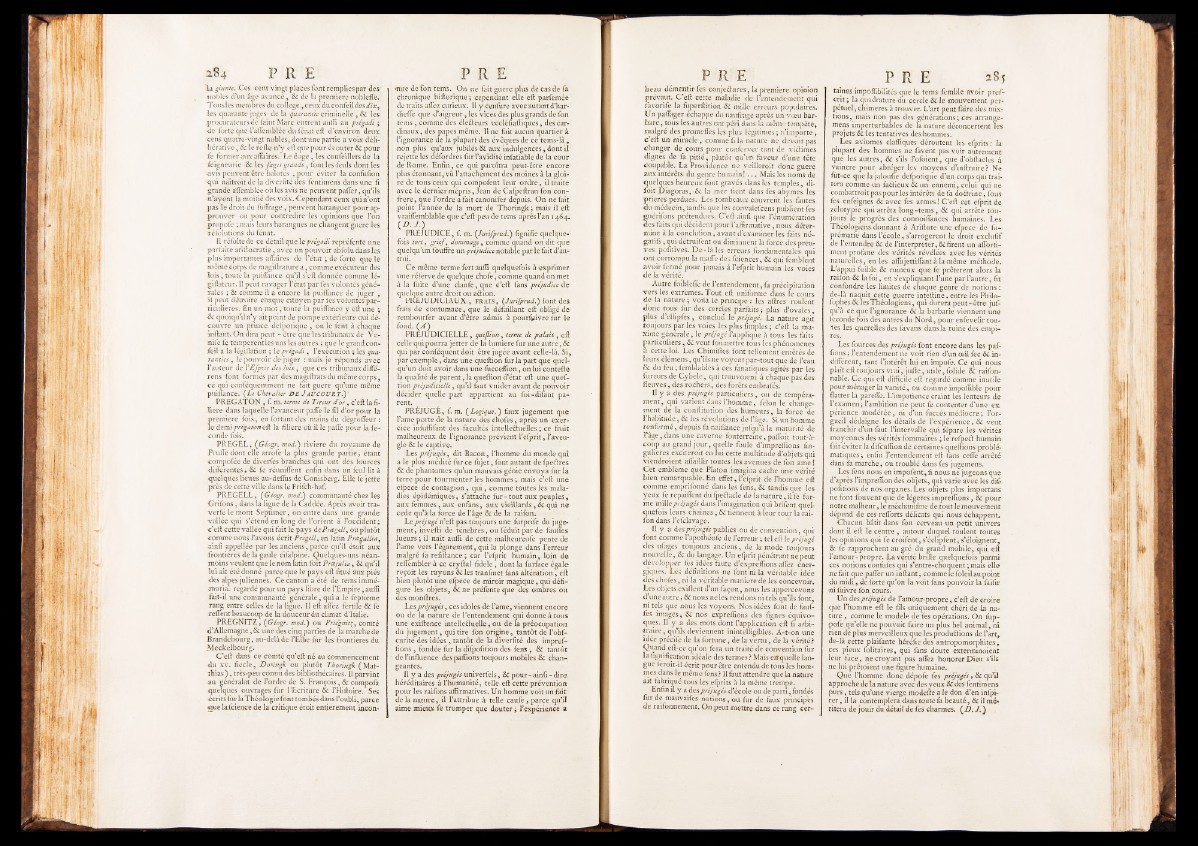
la giunte. Ces eerït vin^t places font remplies par des
nobles d’un âge avance, 6c de la première nobleffe.
Tousles membres du college, ceux du conferl des d ix ,
•les quarante juges de la quarantic criminelle , 6c les
procurateurs de faint Marc entrent auffi au prégadi ;
•de forte que-l’affemblée du fénat eft d’environ deux
cens quatre-vingt nobles, dontune partie a vo ix délibérative
, 6c le refte n’y eft que pour écouter & pour
fe former auxaffaires, Le doge, les conseillers de la
Seigneurie -&-1 es Juges grands , Sont les Seuls dont les
^avis peuvent être balotés , pour éviter la confiifion
qui naîtroit de la diverlité des Sentimens dans aine fi
^grande affemblée-oii les avis ne peuvent paffer, qu’ils
•n’ayent la moitié des^ voix.-Cependant ceux qui n’ont
pas le droit du fuffrage , peuvent haranguer pour approuver
ou pour contredire les opinions que l’on
propofe ; mais leurs harangues ne changent guere les
■ réfolutions du lénat.
11 réfulte de ce détaïl-que le prégadi repréfente une
parfaite ariftocratie, avec un pouvoir abfolu dans les
plus importantes affaires de l ’état ; de forte que le
même corps de magiftrature a , comme exécuteur des
lo is , toute la puiffance qu’il s’eft donnée comme lé-
giflateur. Il peut ravager l’état par fes volontés générales
; & comme il a encore la puiffance de juger ,
il peut détruire chaque citoyen par fes volontés particulières.
En un mot, toute la puiffance y eft une ;
6c quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre
un prince defpotiqûe , on le fent à chaque
inftant. On dira peut - être que les tribunaux de Ve-
nile fe temperentlesuns les autres ; que le grand conseil
a la légiflation ; le p rég a d i, l’exécution ; les quara
mies , le pouvoir de juger : mais je réponds avec
l’auteur de VEfprit des lois , que ces tribunaux diffé-
rens font formés par des magiftrats du même corps,
ce qui cooféquemment ne fait guere qu’une même
puiffance. (L e Chevalier DE J AUCOURT.}'
PRÉGATON , f. m. terme de Tireur d 'o r , c’ eft la filière
dans laquelle l’avanceur paffe le fil d’or pour la
première fois, en fortant des mains du dégroffeur :
le demi prégaton eft la filiere oii il le paffe pour la fécondé
fois.
P R EG E L , ( Géogr. mod.) riviere du royaume de
Pruffe dont elle arrofe la plus grande partie, étant
compofée de diverfes branches qui ont des fources
différentes, 6c fe réunifient enfin dans un foui lit à
quelques lieues au-deffus de Conisberg. Elle fe jette
près de cette ville dans le Frifch-haf.
PR EG E L L , (Géogr. mod.) communauté chez les
Grifons, dans la ligue de la Caddée. Après avoir tra-
verfé le mont Septimer, on entre dans une grande
vallée qui s’étend en long de l’orient à l’occident ;
c ’eft cette vallée qui fait le pays àeProegell, ou plutôt
comme nous l’avons écrit Pregell, en latin Proegallia,
•ainfi appellée par les anciens, parce qu’il étoit aux
frontières de la gaule cifalpine. Quelques-uns néanmoins
veulent que le nom latin foit Proejulia, & qu’il
lui ait été donné parce que le pays eft fitué aux piés
•des alpes juliennes. Ce canton a été de tems immémorial
regardé pour un pays libre de l’Empire, auffi
fait-il une communauté générale, qui a le feptieme
rang entre celles de la ligue. Il eft affez fertile & fe
reffent beaucoup de la douceur du climat d’Italie.
PREGN IT Z, (Géogr. mod.) ou Priegrùt{ , comté
d’Allemagne, & une des cinq parties de la marche de
JBrandebourg, au-delàde l’Elbe fur les frontières du
Aleckelbourg.
C’eft dans ce comté qu’eft né au commencement
du xv. fiecle, D onngk ou plutôt Thoringk (Matthias)
, très-peu connu des bibliothécaires. Il parvint
au généralat de l’ordre de S. François, & compofa
quelques ouvrages fur l ’Ecriture 6c l’Hiftoire. Ses
écrits fur la Théologie font tombés dans l’oubli, parce
«pielafcience de la critique étoit entièrement incon-
•nue de fou'teins. On ne fait guere plus de cas de fa
chronique hiftorique ; cependant elle eft parfemée
de traits affez curieux. Il y cenfure avec autant d’har-
dieffe que d’aigreur , les vices des plus grands de fon
•tems , comme des électeurs eccléfiaftiques, des cardinaux,
des papes même. Il ne fait aucun quartier à
l’ignorance de la plupart des évêques de ce tems-là ,
-non plus qu’aux jubilés & aux indulgences, dont il
rejette les défordres furl’avidité infatiable de la cour
de Rome. Enfin, ce qui paraîtra peut-être encore
plus étonnant, vû l’attachement des moines à la gloire
de tous ceux qui compofent leur ordre , il traite
•avec le dernier mépris, Jean de Cafpeftran fon confrère,
que l’ordre a fait canonifer depuis. On ne fait
point l’année de la mort de Thoringk ; mais il eft
vraiffemblable que c’eft peu de tems après l’an 1464- BBHHi I . . 11 PR É JUD IC E , f. m. (Ju n fp ru d .} fignifiequelquefois
tort, g r ie f, dommage, comme quand on dit que
quelqu’un fouffre un préjudice notable par le fait d’autrui.
Ce même terme fert auffi quelquefois à exprimer
une réferve de quelque chofe, comme quand on met
à la fuite d’une claufe,que c’eft fans préjudice de
quelque autre droit ou airion.
PR ÉJUDICIAUX , frais, (Jurifprud.') font des
frais de contumace, que -le défaillant eft obligé de
rembourfer avant d’être admis à pourfijivre fur le
fond. ( A }
PRÉJUDICIELLE , queflion, terme de p a la is , eft
celle qui pourra jetter de la lumière fur une autre, Si
qui par conféquent doit être jugée avant celle-là. S i,
par exemple, dans une queftion fur la part que quelqu’un
doit avoir dans une fucceffion, on lui contefte
la qualité de parent,la queftion d’état eft une queftion
préjudicielle, qu’il faut vuider avant de pouvoir
décider quelle part appartient au foi-dilant parent.
PR É JU G É , f. m, (L o g iq u e .} faux jugement que
l’ame porte de la nature des chofes, après un exercice
infuffifant des facultés intellectuelles ; ce finit
malheureux de l’ignorance prévient l’efprit, l’aveugle
6c le captive.
Les préjugés, dit Bacon, l’homme du monde qui
a le plus médité fur ce fujet, font autant de fpeftres
& de phantomes qu’un mauvais génie, envoya fur la
terre pour tourmenter les hommes ; mais c’eft une
efpece de contagion, qui -, comme toutes les maladies
épidémiques, s’attache fur - tout aux peuples ,
aux femmes, aux enfans, aux vieillards, & qui ne
cede qu’à la force de l’âge & de la raifon.
Le préjugé n’eft pas toujours une furprife du jugement,
invefti de ténèbres, ou féduit par de faunes
lueurs ; il naît auffi de cette malheureùfe pente dé
l’ame vers l’égarement, qui la plonge dans l’erreur
malgré fa refiftance ; car l’efprit humain, loin de
reffembler à ce cryftal fidele, dont la furface égale
reçoit les rayons & les tranfmet fans altération , eft
bien plutôt une efpece de miroir magique, qui défigure
les objets, & n e préfente que des ombres ou
des monftres.
Les préjugés, ces idoles de l’ame, viennent encore
ou de la nature de l’entendement qui donne à tous
une exiftence intellectuelle, ou de la préocupatfon
du jugement, qui tire fon origine, tantôt de l’obf-
curité des idées , tantôt de la diverfité des impref-
fions , fondée fur la difpofition des feus , & tantôt
de l’influence des pallions toujours mobiles & changeantes.
Il y a des préjugés univerfels, & pour - ainfi - dire
héréditaires à l’humanité, telle eft cette prévention
pour les raifons affirmatives. Un homme voit un fait
de la nature, il l’attribue à telle caufe , parce qu’ il
aime mieux fe tromper que douter ; l’expérience a
beau démentir fes conjectures, la première, opinion
prévaut. C ’eft cette maladie de l’entendement qui
favorife la fiiperftition & mille erreurs populaires.
Un paffager échappe du naufrage après un voeu barbare
, tous les autres ont péri dans la même tempête,
malgré des promeffes les plus légitimes ; n’importe,
c ’eft un miracle, comme fi la nature ne devoit pas
changer de cours pour confervér tant de victimes
dignes de fa pitié, plutôt qu’en faveur d’une tête
coupable. La Providence ne veilleroit donc guere
aux intérêts du genre humain!, . . Mais les noms de
quelques heureux font gravés dans les temples, dirait
Diagoras, & la mer tient dans fes abymes les
prières perdues. Les tombeaux couvrent les fautes
du médecin, tandis que les convalefcens publient fes
guérifons prétendues. C’eft ainfi que l’énumération
des faits qui décident pour l’affirmative, nous détermine
à la conclufion, avant d’examiner les faits négatifs
, qui détruifent ou diminuent la force des preuves
pofitives. D e -là les erreurs fondamentales qui
ont corrompu la maffe des fciences, 6c qui femblent
avoir fermé pour jamais à l’efprit humain les voies
de la vérité.
Autre foibleffe de l’entendement, fa précipitation
vers les extrêmes. Tout eft uniforme dans le cours
de la nature ; voilà le principe : les aftres. roulent
donc tous fur des cercles parfaits ; plus d’ovales,
plus d’ellipfes , conclud le préjugé. La nature agit
toujours par les voies les plus fimples ; c’eft la maxime
generale, le préjugé l’applique à tous les faits
particuliers, 6c veut foumettre tous les phénomènes
à cette loi. Les Chimiftes font tellement entêtés de
leurs élémens, qu’ils-11e voyent par-tout que de l’eau
& du feu ; femblables à ces fanatiques agités par les
fureurs de Cyb e le , qui trou voient à chaque pas .des
fleuves, des rochers, des forêts embrafés;
Il y a des préjugés particuliers , ou de tempérament,
qui varient dans l’homme, félon le changement
de la conftitution des humeurs, la force de
l ’habitude, & les révolutions de l’âge. Si un homme
renfermé, depuis fa naifîânce jufqu’à la maturité de
l ’âge, dans une caverne fouterreine, paffoit tout-à-
coup au grand jour, quelle foule. d’impreffions fin-
gulieres exciteroit en lui cette multitude d’objets qui
viendraient affaillir toutes les avenues de fon ame !
Cet emblème que Platon imagina cache une vérité
bien remarquable. En effet, l’efprit de l’homme eft
comme emprifonné dans les fens, 6c tandis que les
yeux fe repaiffent du fpeCtacle de la nature, il fe forme
mille préjugés dans l’imagination qui brifent quelquefois
leurs chaînes, & tiennent à leur tour la raifon
dans l’efclavage.
Il y a des préjugés publics ou de convention, qui
font comme î’apothéofe de l’erreur ; tel eft le préjugé
des ufages toujours anciens, de la mode toujours
nouvelle, 6c du langage. Un efprit pénétrant ne peut
développer fes idées faute d’expreffions affez énergiques.
Les définitions ne font ni la véritable idée
des chofes, ni la véritable maniéré de les. concevoir.
Les objets exiftent d’un façon, nous les appercevons
d’une autre, & nous ne les rendons ni tels qu’ils font,
ni tels que nous les: voyons. Nos idées font de fauf-
fes images, & nos expreffions des lignes équivoques.
Il y a des mots dont l’application eft fi arbi-
•traire, qu’ils deviennent inintelligibles. A-t-on une
âdée précife de la fortune, de la vertu, de la vérité?
Quand eft-ce qu’on fera un traité de convention fur
la lignification idéale des termes ? Mais ert quelle langue
feroit-il écrit pour être entendu de tous les hommes
dans le même fens ? Il faut attendre que la nature
ait fabriqué tous les efprits à la même trempe.
Enfin il y a des préjugés d’école ou de parti., fondés
fur de mauvaifes notions, ou fur de faux principes
de xaifonnement. On peut mettre dans ce rang cerlaines
impoffibilitcs que le tems femble avoir pref-
crit ; la quadrature du cercle & le mouvement perpétuel,
chimères à trouver. L’art peut faire des mixtions
, mais non pas des générations ; ces arrange-
mens imperturbables de la nature déconcertent les
projets & les tentatives des hommes.
Les axiomes claffiques déroutent les efprits: la
plupart des hommes ne favent pas voir autrement
que les autres, & s’ils l’ofoient, que d’obftacles à
vaincre pour abréger les moyens d’inftruire? Ne
fût -ce que la jaloufie defpotiqûe d’un corps qui traitera
comme un faâleux & un ennemi, celui qui ne
combattroit pas pour les intérêts de fa doélrine, fous
fes erifeignes & avec fes armes! C ’eft cet efprit de
zélotypie qui arrêta long-tems, & qui arrête toujours
le progrès des connoiffances humaines. Les
Théologiens donnant à Ariftote une efpece de fu-
prématie dans l’école, s’arrogèrent le droit exclufif
de l’entendre & de l’interpréter, & firent un afforti-
ment profane des vérités révélées avec les vérités
naturelles , en les affujettiffantàlamême méthode.
L ’appui foible & ruineux que fe prêtèrent alors la
raifon & la fo i, en s’expliquant l’une par l’autre, fit
confondre les limites de chaque genre de notions :
de-là naquit cette guerre inteftine, entre les Philo-
fophes & les Théologiens, qui durera peut r être jufqu’à
ce :que l’ignorance & la barbarie viennent une
fécondé fois des antres du Nord, pour enfeveür toutes
les querelles des favans dans la ruine des empires.
Les fources des préjugés font encore dans les paf-
fions ; l’entendement ne voit rien d’un oeil fec & indiffèrent,
tant l’intérêt lui enimpofe. Ce qui nous
plaît eft toujours v rai,. jufte, utile, folide & raifon-
nable. Ce qui eft difficile eft regardé comme inutile
pour ménager la vanité, ou comme impoffible pour
flatter la pareffe. L’impatience craint les lenteurs dé
l’examen ; l’ambition ne peut fe contenter d’une ex
périence modérée, ni d’un fuccès médiocre ; l’orgueil
dédaigne les détails de l’expérience, 6c veut
franchir d’un faut l’intervalle qui.fépare les vérités
moyennes des vérités fommaires ; le refpeft humain
fait éviter la difcuffion de certaines queftions problématiques
; enfin l’entendement eft fans ceffe arrêté
dans fa marche, ou troublé dans fes jugemens.
Les fens nous en impofent, fi nous ne jugeons que
d’après l’impreffion des objets, qui varie avec les difi
pofitions de nos organes. Les objets plus importans
ne font fouvenî que de légères impreffions, & pour
notre malheur, le méchanifme de tout le mouvement
dépend de ces refforts délicats qui nous échappent.
Chacun bâtit dans fon cerveau un petit univers
dont il eft le centre , autour duquel roulent toutes
les opinions qui fe croifent, s’éclipfent, s’éloignent,
& fe rapprochent au gré du grand mobile, qui eft
l’amour-propre. L a vérité brille quelquefois parmi
ces notions confufes qui s’entre-choquent ; mais elle
ne fait que paffer un inftant, comme lefoleilaupoint
du midi, de forte qu’on la voit fans pouvoir la faifir
ni fuivre fon cours.
Un des préjugés de l’amour-propre, c’eft de croire
que l’homme eft le fils uniquement chéri de la nature
, comme le modèle de fes opérations. On fup-
pofe qu’ elle ne pouvoit faire un plus bel animal, ni
rien de plus merveilleux que les produirions de l’art,
de-là cette plaifante hérefie des antropomorphites,
ces pieux folitaires, qui fans doute exterminoient
leur face , ne croyant pas affez honorer Dieu s’ils
ne lui prêtoient une figure humaine.
Que l’homme donc dépofe fes préjugés, & qu’il
approche de-la nature avec des yeux & des fentimens
purs, tels qu’une vierge modefte a le don d’en infpi-
re r , il la contemplera dans toute fa beauté, & il méritera
de jouir du détail de fes charmes. ( D . ƒ , )