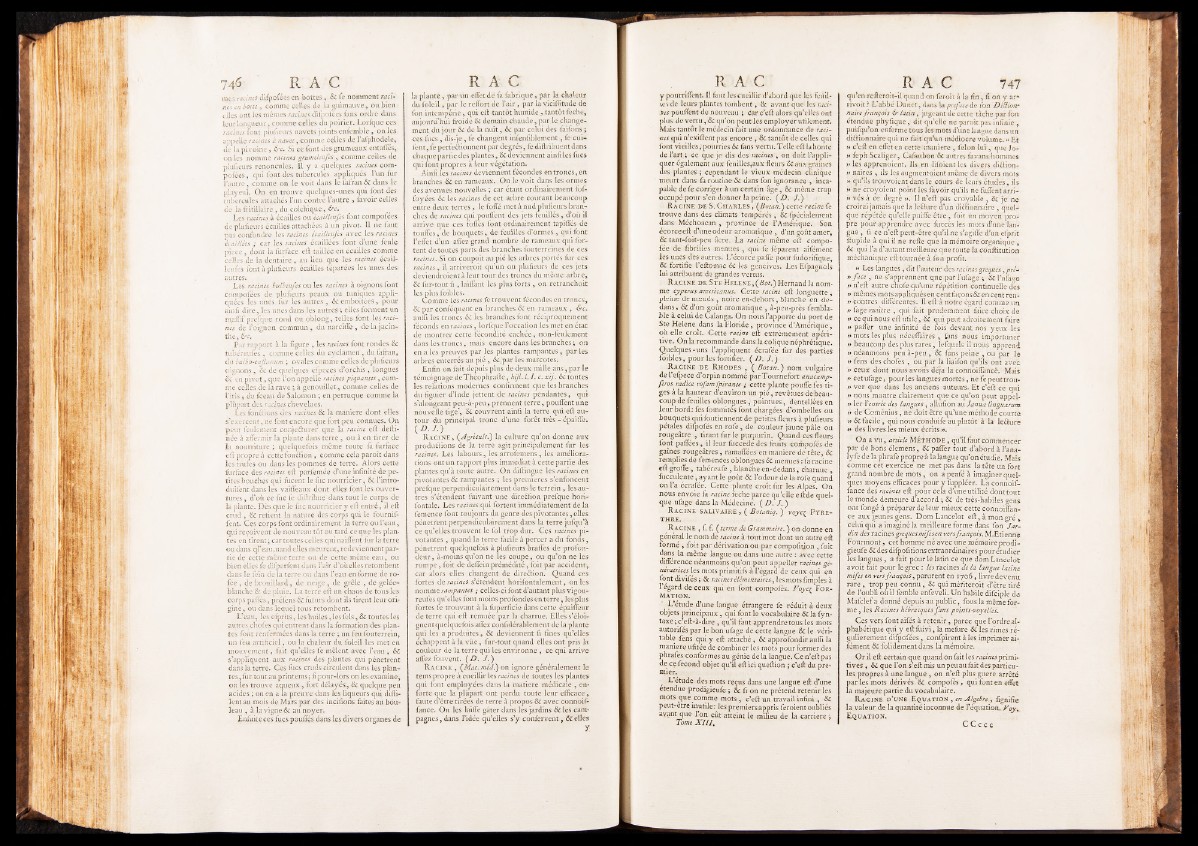
mes racines difpofées en bottes , 8c m nomment racines
en botte, comme celles de la guimauve , ou bien
elles ont les mêmes racine s difpofees fans ordre dans
leur longueur, comme celles du poirier. Lorfque ces
racines Font plusieurs navets joints enfemble , on les.
appelle racines a navet, comme celles de l’afphodele,
de la pivoine, &c. Si ce font des grumeaux entaffés,.
on les nomme racines grumeleufes , comme, celles de
plufieurs renoncules. Il y a quelques racines composes
, qui font des tubercules appliqués l’un fur
l’autre, comme on le voit dans le fafran 8c dans le
glayeul. On en trouve quelques-unes qui font des
tubercules attachés l’un contre l’autre , lavoir celles
de la fritillaire , du colchique-, &c.
Les racines à écailles ou écaillèufes font compofées
de plufieurs écailles attachées à un pivot. Il ne faut
pas confondre les racines écaiUeufts avec les racines
écaillées ; car les racines écaillées font d’une feule
piece , dont la furface eft taillée en écailles comme
celles de la dentaire , au lieu que les racines écailleufes
font à plufieurs écailles leparées les unes des-
autres;
Les racines hulbeuf ;s ou les racines à oignons font
compofées de plufieurs peaux ou tuniques appliquées
les unés fur les autres , & emboîtées, pour
ainfi dire, les unes dans les autres ; elles forment un
maffif prefque rond ou oblong, telles font les racines
de l’oignon commun , du narcifle , de la jacinthe,
&c.
Par rapport à la figure , les racines font rondes 8c
tubéreufes , comme celles du cyclamen , du fafran,
du bulbo-cajlanutn ; ovales comme celles de plufieurs
oignons , 8c de quelques efpeces d’orchis , longues
8c en pivot, que l’on appelle racines piquantes, comme
celles de la rave ; à genouillet, comme celles de
l’iris j du fceau de Salomon ; en perruque comme la
plupart des racines chevelues... .
Les fondions des racines 8c la maniéré dont elles
s’exercent, ne font encore que fort peu connues. On
peut feulement conjecturer que. la racine ejft defti-
née à affermir la plante dans terre , ou à en tirer de
3a nourriture ; quelquefois même toute fa furface
eft propre à cette fonction, comme cela paroît dans
les trufes ou dans les pommes de terre. Alors cette
furface des racines eft parfemée d’une infinité de petites
bouches qui fucent le fuc nourricier, 8c l’intro-
duifent dans les vaiffeaux dont elles font les ouvertures
, d’oîi ce fuc fe diftribue dans tout le corps de
la plante. Dès que le fuc nourricier y eft entré, il eft
çrud , 8c retient la nature des corps qui le fournif-
fent. Ces corps font ordinairement la terre ou l’eau,
qui reçoivent de nouveau tôt ou tard ce que les plantes
en tirent; car toutes celles qui naiffent fur la terre
ou dans ql’eau,uand elles meurent, redeviennent partie
de cette même terre ou de cette même eau, ou
bien elles fe difperfent dans l’air d’où elles retombent
dans le fein de la terre ou dans l’eau en forme de ro-
fée , de brouillard, de neige , de grêle , de gelée-
blanche & de pluie. La terre eft un chaos de tous les
corps pâlies, préfens 8c futurs dont ils tirent leur origine
, ou dans lequel tous retombent.
L’eau, les efprits, les huiles, les fels, 8c toutes les
autres chofes qui entrent dans la formation des plantes
font renfermées dans la terre ; un feu fouterrein,
un feu artificiel, ou la chaleur du foleil les met en
mouvement, fait qu’elles fe mêlent avec l’eau , 8c
s’appliquent aux racines des plantes qui pénètrent
dans la terre. Ces fucs cruds circulent dans les plantes
, fur-tout au printems ; fi pour-lors on les examine,
on les trouve aqueux, fort délayés, 8c quelque peu
acides ; on en a la preuve dans les liqueurs qui difti-
lent au mois de Mars par des incifions faites au bouleau
,, à la vigne & au noyer.
Enfuite ces fuçs pouffes dans les divers organes de
la plante, par un effet dé fa fabrique, par la chaleur
du foleil, par le reffort de l’air, par la viciffitude de
fon intempérie, qui eft tantôt humide, tantôt feche,
aujourd’hui froide 8c demain chaude, par le .changement
du jour 8c de la nuit, 8c par celui des faifons ;
ces fucs , dis-je, fe changent infenfiblement, fe cui-
fent, fe perfe&ionnent par degrés, fe diftribuent dans
chaque partie des plantes, 8c deviennent ainfi les fucs
qui font propres à leur végétation.
Ainfi les racines deviennent fécondes en troncs, en
branches 8c en rameaux.. On le voit dans les ormes
des avenues nouvelles ; car étant ordinairement fof-
foyées 8c les racines de cet arbre courant beaucoup
entre deux terres, le foffé met à nud plufieurs branches
de racines qui pouffent des jets fouillés, d’où il
arrive que ces foliés font ordinairement tapiffés de
touffes, de bouquets, de feuilles d’ormes, qui font
l’effet d’un affez grand nombre de rameaux qui for-
tent de toutes parts des branches fouterreines de ces
racines. Si on coupoitau pié les arbres portés fur ces
racines, il arriveroit qu’un pu plufieurs de ces jets
deviendroient à leur tour des troncs du même arbre,
8c fur-tout fi , laiffant les plus forts , on retranchait
les plus foibles.
Comme les racines fe trouvent fécondes en troncs,
8c par conféquent en branches 8c en rameaux , &c.
auffi les troncs 8c les branches font réciproquement
féconds en racines, lorfque l’occafion les met en état
de montrer cette fécondité cachée, non-feulement
dans les troncs, mais encore dans les branches ; on
en a les preuves par les plantes rampantes, par les
arbres enterrés au pié , &;par les marcotesi '
Enfin on fait depuis plus de deux mille ans, par le
témoignage de Théophrafte, hiß. 1. 1. c. x ij. 8c toutes
les relations modernes confirment que les branches
du figuier d’Inde jettent de racines pendantes, qui
s’alongeant peu-à-peu, prennent terre, pouffent une
nouvelle tige", 8c couvrent ainfi la terre qui eft autour
du principal tronc d’une forêt très - épaiffe.
( D . A )
R a c in e , (Agricult.) la culture qu’on donne aux
produ&ions de la terre agit principalement fur les
racines. Les labours, les arrofemens, les améliorations
ont un rapport plus immédiat à cette partie des
plantes qu’à toute autre. On diftingue les racines en
pivotantes 8c rampantes ; les premières s’enfoncent
prefque perpendiculairement dansde terrein, les autres
s’étendent fuivant une direélion prefque Jhori-
fontale. Les racines .qui fortent immédiatement de la
femence font toujours du genre des pivotantes, elles
pénètrent perpendiculairement dans la terre jufqu’à
ce qu’elles trouvent le fol trop dur. Ces racines pivotantes
, quand la terre facile à percer a du fonds,
pénètrent quelquefois à plufieurs braffes de profondeur
, à-moins qu’on ne les coupe, ou qu’on ne les
rompe, foit de deffein prémédité, foit par accident,
car alors elles changent de direêlion. Quand ces
fortes de racines s’étendent horifontalement, on les
nomme rampantes ; celles-ci font d’autant plus vigou-
reufes qu’elles font moins profondes enterre, les plus
fortes fe trouvant à la fuperficie dans cette épaiffeur
de terre qui eft remuée par la charrue. Elles s’éloignent
quelquefois affez confidérablement de la plante
qui les a produites, 8c deviennent fi fines qu’elles
échappent à la vue, fur-tout quand elles ont pris la
couleur de la terre qui les environne , ce qui arrive
affez fouvent. (D . J . )
R a c in e , {Mat. médé) on ignore généralement le
temspropre à cueillir les racines de toutes les plantes
qui font employées dans la matière médicale , en-
forte que la plupart ont perdu toute leur efficace,
faute d’être tirées de terre à propos 8c avec connoif-
fance. On les laiffe gâter dans les jardins & les campagnes
, dans l’idée qu’elles s’y confervent, 8c elles
y
y p o u r r iffe n t . I l fa u t le s C u e illir d’a b o rd q u e le s fo û il-
v e v d e le u r s p lan t e s t o m b e n t , & a v a n t q u e le s racines
p o u ffe n t d e n o u v e a u ; Car c ’e ft a lo r s q u ’e lle s o n t
p lu s d e v e r t u , 8c q u ’o n p e u t le s em p lo y e r u t ilem e n t .
M a is t an tô t le m é d e c in f a i t u n e o rd o n n a n c e d e racines
q u i n ’ e x ifte n r p a s e n c o r e , 8c t a n tô t d e c e lle s q u i
fo n t v i e i l le s j p o u r r ie s 8c fan s v e r t u . T e lle e ft la h o n te
d e l ’a r t ; c e q u e je d is d e s racines , o n d o it l’a p p liq
u e r é g a lem e n t a u x f e u i lle s ,a u x fle u r s 8c a u x g ra in e s
d e s p la n t e s ; c e p e n d an t le v i e u x m é d e c in c lin iq u e
m e u r t dan s fa ro u t in e 8c d an s fo n ig n o r a n c e , -inca*
p a b lc d e f e c o r r ig e r à u n c e r t a in â g e , 8c m êm e t ro p
o c c u p é p o u r s ’ e n d o n n e r la p e in e . ( D . / . ’) 1
R a c i n e d e S . C h a r l e s , (Bo ta n .) c e t t e racine fe
t r o u v e d an s d e s c lim a t s t em p é r é s , 8c fp é c ia lem e rit
d an s M é c h o a c a n , p r o v in c e d e l’A m é r iq u e . S o n
é c o r c e e ft d’u n e o d e u r a r om a t iq u e , d’u n g o û t am e r ,
& t a n t - fo it -p e u â c r e . L a racine m êm e e ft c om p o -
f é e d e f ib r il le s m e n u e s , q u i f e fé p a r e n t a ifém e n t
l e s u n e s d e s a u t r e s . L ’ é c o r c e p a fle p o u r fu d o r if iq u e ,
& fo r t if ie l ’e f tom a c 8c le s g e n c iv e s . L e s E fp a g n o l s
lu i a t t rib u e n t d e g ran d e s v e r tu s .
R a c i n e d e S t e H e l e n e , {B o t .) H e rn an d la n om m
e cyperus americanus. C e t t e racine e f t lo n g u e t t e ;
p le in e d e noeu d s , n o i r e e n - d e h o r s , b la n c h e e n d e d
an s , 8c d ’u n g o û t a r ôm a t iq u e , à -p e u -p rè s fem b la -
b le à c e lu i d e C a la n g a . O n n o u s l ’a p p o r t e d u p o r t d e
S t e H e le n e d an s l a F lo r id e , p r o v in c e d ’A m é r iq u e ,
o ù e lle c r o ît . C e t t e racine e ft e x t r êm em e n t a p é r i -
t iv e . O n la r e c om m a n d e d an s la c o liq u e n é p h r é t iq u e .
Q u e lq u e s -u n s l’a p p liq u e n t é c r a fé e fu r d e s p a r t ie s
f o ib le s , p o u r le s fo r t if ie r . ( D . J . )
R a c i n e d e R h o d e s , ( B o ta n .) n om v u lg a ir e
d e l’ e fp e c e d ’ o rp in n om m é p a r T o u r n e f o r t anacamp-
feros radice rofam fpirante ; c e t t e p la n t e p o u ffe fe s t i g
e s à la h a u te u r d’e n v ir o n u n p i e , r e v ê t u e s d e b e a u c
o u p d e f e u ille s o b lo n g u e s , p o in t u e s , d e n te l lé e s e n
le u r b o r d : fe s fom m ite s fo n t c h a rg é e s d’ om b e lle s o u
b o u q u e t s q u i fo u t ie n n e n t d e p e t it e s fle u r s à p lu fie u r s
p é t a le s d i lp o fé s e n r o f e , d e c o u le u r ja u n e p â le o u
ro u g e â t r e , t ir a n t fu r le p u rp u r in . Q u a n d c e s fle u r s
fo n t p a f f é e s , i l l e u r fu c c e d e d e s fru it s c om p o fé s d e
g a in e s ro u g e â t r e s , ram a ffé e s e n m a n ié r é d e t ê t e , 8c
rem p lie s d e fem e n e e s o b lo n g u e s 8c m e n u e s : fa r a c in e
e f t g r o f f e , t a b é r e u fe , b la n c h e e n - d e d a n s , c h a rn u e ,
fu c c u l e n t e , a y a n t le g o û t 8c l ’o d e u r d e là ro fe q u an d
o n l’a é c r a fé e . C e t t e p lan te c r o ît fu r le s A lp e s , O n
n o u s e n v o ie fa racine fe c h e p a r c e q u ’e lle e f t d e q u e lq
u e u fa g e d an s la M é d e c in e . { D . J . )
R a c i n e s a l i v a i r e , ( Botaniq. ) voyez P y r e -
t h r e .
R a c i n e , f. f . { terme de Grammaire. ) o n d o n n e en
g e n e r a l le n om d e racine à t o u t m o t d o n t un a u t r e e ft
fo rm é , f o i t p a r d é r iv a t io n o u p a r c om p o f iÿ o n , fo it
d an s l a m êm e lan g u e o u d an s u n e a u t r e : a v e c c e t t e
d i ffé r e n c e n é a nm o in s q u ’o n p e u t a p p e l le r racines génératrices
le s m o ts p r im it ifs à l ’é g a rd d e c e u x q u i en
fo n t d iv i fé s ; & racines élémentaires, le s m o t s f im p le s à
l ’é g a r d d e c e u x q u i e n fo n t c om p o fé s . Voye^ F o r m
a t i o n .
L ’ é tu d e d’ u n e lan g u e é t r a n g è r e f e r é d u it à d e u x
o b je t s p r in c i p a u x , q u i fo n t l e v o c a b u la ir e 8c la f y n -
t a x e ; c ’ e f t -à -d ir e , q u ’i l fa u t a p p r e n d r e to u s le s m o ts
a u to r ifé s p a r le b o n u fa g e d e c e t t e la n g u e & le v é r i t
a b le fe n s q u i y e f t a t ta ch é , 8c a p p ro fo n d ir au ffi la
m a n iè r e u f ité e d e c om b in e r le s m o ts p o u r fo rm e r de s
p h r a fe s c o n fo rm e s a u g é n ie d e la lan g u e . C e n ’ e ft p a s
d e c e ffe c o n d o b je t q u ’ i l e ft i c i q u e ft io n ; c ’e f t d u p r e m
ie r .
L ’ e tu d e d e s m o ts r e ç u s d an s u n e lan g u e e f t d’u n e
e te n d u e p r o d ig ie u fe ; 8c fi o n n e p r é t e n d r e t e n ir le s
m o t s q u e c om m e m o t s , c ’ e ft u n t r a v a i l in fin i , 8c
p e u t - e t r e in u t ile : le s p r em ie r s a p p r is fe ro ie n t o u b lié s
a v a n t q u e l ’o n e û t a t te in t l e m il ie u d e l a c a r r iè r e ;
Tome X I I I .
qu’en refterôit-il quand on feroit à la fin, fi ort y ar*
rivoit? L’abbé Danet, dans la préfacé de fon Diction*
nuire franc;ois & l a t in , jugeant de cette tâche par fon
étendue phyfiqtte, dit qu’elle ne paroît pas infinie ,
puifqu’on enferme tous les mots d’une langue dans un
diftionnaire qui ne fait qû’un médiocre volume. « Et
» c’eft en effet en cettë maniéré , félon lu i, que Jo-
» feph Scaiiger, Calaubon '& autres favans hommes
» les apprenoient. Ils en Jifôient les divers didion-
» naires , ils,les augmentoient même de divers mots
» qu’ils trouvoient dans le cours de leurs études, ils
» he croy oient point les fa voir qu’ils ne fuffent arri-
» vés à ce degré ». Il n’eft pas croyable , 8c je ne
croirai jamais que la lëûure d’un didionnaire , quelque
répétée qu’elle puiffe être , foit Un moyen; pro*
pre pour apprendre avec fuccès les mots d’une langue
, fi ce n’eft peut-être qu’il ne s’agiffe d’un e/prit
Itupide à qui il ne refte que la mémoire organique ,
8c qui l’a d’autant meilleure que toute la conftitution
méchanique eft tournée à fon profit.
» Les langues, dit l’auteur des racines g r eq u e s , pré-*
» fa c e , ne -s’apprennent que par l’ufage 8c l’ufao-e
» n’ eft autre chofe qu’une répétition continuelle des
» mêmes mots appliqués en centfaçons&encentren-
» contres différentes. Il eft à notre égard comme un
» fage maître , .qui fait prudemment faire.choix de
» ce qui nous eft utile, 8c qui peut adroitement faire
» paffer une infinité, de fois devant nos yeux les
» mots les plus néceffaires , fans nous importuner
» beaucoup des plus rares, lefquels il nous apprend
» néanmoins peu à-peu , 8c fans peine , ou par le
» fens des chofes , où par la liaifon qu’ils, ont avec
» ceux dont nous avons déjà la connoiffâncë. Mais
» cet ufage, pour les langues mortes, ne fe peut trou-
» ver que dans les anciens auteurs. Et c’eft ce qui
» nous montre clairement que ce qu’on peut appel-
» 1er Ventrée des la n g u e s , allufion au J a n u a lin g u a rum
» de Coménius, ne doit être qu’une méthode courtè
» 8c facile , qui nous conduife au plutôt à la ledurè
*> des livres les mieux écrits ».
On a V u , article M É f HODE, qu’il faut commencer
par de bons élemen s, & paffer tout d’abord à l’ana-
ly fe de la phrafe p ropre à la langue qu’onétudie. Mais
comme cét e xercice ne met pas dans la tête un fort
grand nombre de m o ts, on a p e n fé à imaginer quelques
moyens efficaces p our y fuppléer. L a connoif-
fance des rac in e s eft pour cela d’une u tilité dont tout
le monde demeure d’accord ; & de très-habiles gens
ont fongé à préparer de leur mieux cette connoiffan-
ce aux jeunes gens. D om Lancelot e f t , à mon gré ,
celui qui a imaginé la meilleure forme dans fon J a r d
in d e s racines g requ esm ife sen v ers fr a n ç o is . M .Etiennè
‘Fourm önt, cet homme né av e c une mémoire prodigieufe
& des dilpofitions extraordinaires pour étudier
les langue.s, a fait pour le latin ce que dom L ance lo t
a vo it fait pour le grec : les racines d e la la n g u e la tin e
m ife s en vers f r a n ç o i s , parurent en 1 7 0 6 , liv re devenu,
r a r e , trop peu co n n u ,' 8c qui mériteroit d’être tiré
de l’oubli où il femble enfeveli. Un habile difciple de
M a fc le f a donné depuis au p u b lic , fous la même form
e , les R a c in e s hébraïque s f a n s p o in ts -vo y e lle s .
C e s ve r s font aifés à r e t e n ir , parce que l’ordre alphabétique
qui y eft fu iv i , la mefure & les rimes régulièrement
d ifp o fé e s , confpirent à les imprimer aifément
8c folidement dans la mémoire.
Or il eft certain que quand on fait les racines primitives
, 8c que l’on s’eft mis un peu au fait des particules
propres à une langue , on n’eft plus guere arrêté
par les mots dérivés 8c compofés, qui font en effet
la majeure partie du vocabulaire.
R a c in e d ’u n e E q u a t io n , en A lg è b r e ., lignifie
la v a leu r de la quantité inconnue de l’équation. Voy,.
E q u a t io n .
C C c c c