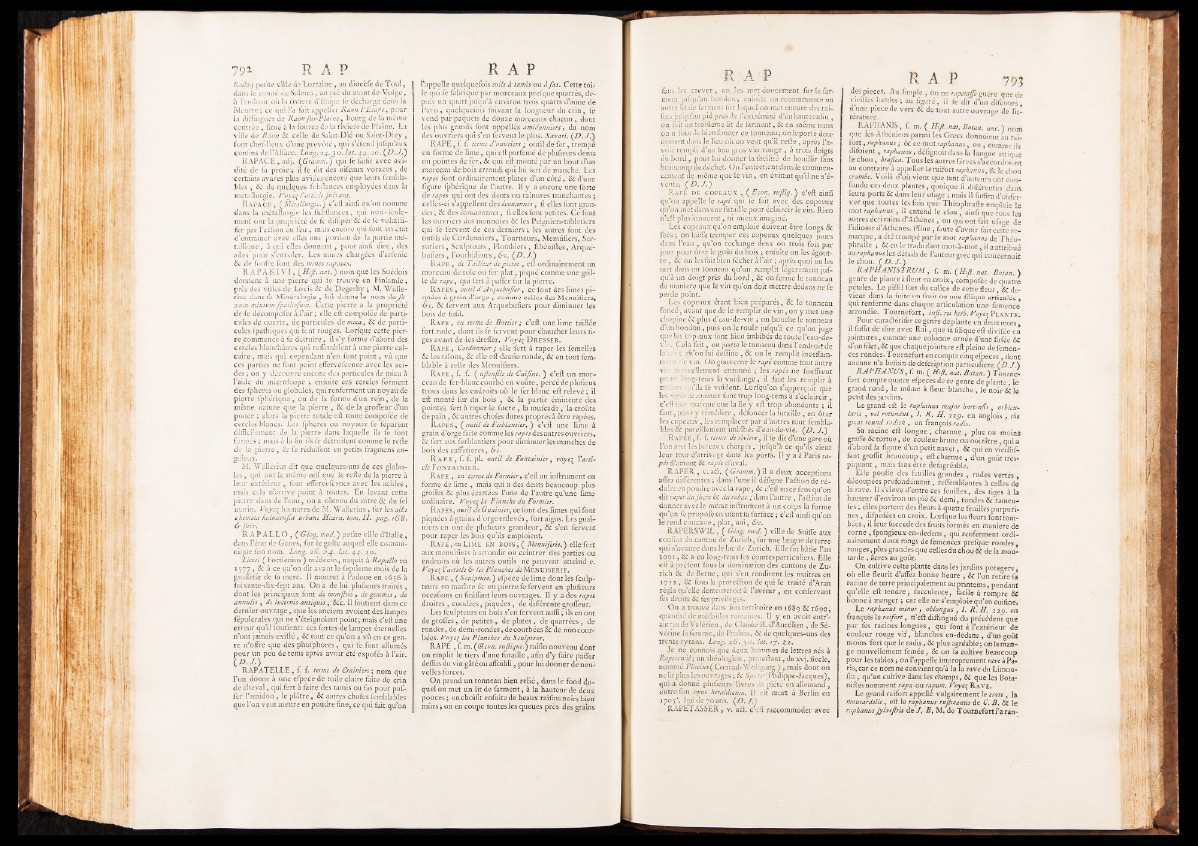
7/ /0 ! JTL ?V AXX PA
Rado; petite ville de Lorraine , au diocèfe de Toul ,
dans le comté de Salmes, au pie du mont de Vol'ge,
à l’endroit oii la riviere d’Etape fe décharge dans la
Meurte ; ce qui l’a fait appeller Raon l'Etape , pour
la diftinguer de Raon ftir-P laine, bourg de la même
contrée , iitué à la fource de la riviere de Plaine. La
ville de Raon 5c celle de Saint-Dié ou Saint-Diey,
font chef-lieux d’une prévôté, qui s’étend jufqu’auX
confins de l’Alface. Long. 24.3 o. lat. 44 .20 . (D .J . )
RAPACE , adj. (Gramm. ) qui fe foifit avec avidité
de fa proie ; il fe dit des oifeaux voraces , de
certains avares plus avides encore que leurs fembla1-
bles ■, 5c de quelques fubftances employées dans la
métallurgie. Voye£ l'articleJuivatit.
R a p a c e , (Métallurgie.) c’eft ainfi qu’on nomme
dans la métallurgie les fubftances, qui non-feulement
ont la propriété de fe diffiper 5c de fe volatili-
fer par l’aftion clu feu , mais encore qui font en état
d’entraîner avec elles une portion de la partie métallique
, à qui elles donnent, pour ainfi dire, des
aîles pour s’envoler. Les mines chargées d’arfenic
5c de foufre font des mines rapaces.
R A P A K 1V I , ( Hiß. nat. ) nom que les Suédois
donnent à une pierre qui fe trouve en Finlande,
près des villes de Lovis & de Degerby ; M. Walle-
rius dans fa Minéralogie , lui donne le nom de fa-
xum mixtum Jpathofum. Cette: pierre a la propriété
de fe décothpofer à l’air ; elle eil compofée de particules
de quartz, de particules de mica, & de particules
fpathiques qui font rouges. Lorfque cette pierre
commence à fe détruire, il s’y forme d’abord des
cercles blanchâtres qui reffemblent à une pierre calcaire
, mais qui cependant n’en font point, vu que
ces parties ne font point effervefccnce avec les acides
; on y découvre encore des particules de mica à
l’aide du microfcope ; enfuite ces cercles forment
des fpheres ou globules, qui renferment un noyau de
pierre fphérique, ou de la forme d’un rein, de la
même nature que la pierre , 5c de la groffeur d’un
pouce ; alors la pierre totale eft toute compofée de
cercles blancs. Les fpheres ou noyaux fe féparent
difficilement de la pierre dans laquelle ils fe font
formés ; mais à la fin ils fe détruifent comme le relie
de la pierre, 5c fe réduifent en petits fragmens an-
guleux.
M. Valierius dit que quelques-uns de ces globules
, qui ont le même oeil que le relie de la pierre à
leur extérieur, font effervefcence avec les acides ,
mais cela n’arrive point à toutes. En lavant cette
pierre dans de l’ eau, on a obtenu du nitre 5c du fel
marin, l^oye^ les notes de M. Wallerius, fur les alla
chtrniça holmienßa urbani Hicern. tom. I I . pag. 16 8 .
& fuiv.
R A P A L L O , ( Géog. mod. ) petite ville d’Italie,
dans l’état de Gènes, fur le golfe auquel elle communique
fon nom. Long. 26. 6 4 . lat. 44. 20.
Liccti ( Fortienius ) médecin, naquit à Rapallo en
1 5 7 7 , & à ce qu’on dit avant le feptieme mois de la
groffeffe de fa mere. Il mourut à Padoue en 1656 à
foixante-dix-fept ans. On a de lui plufieurs traités
dont les principaux font de monßris, de gemmis , de
annulis , de lucernis antiquis, & c . Il foutient dans ce
dernier ouvrage, que les anciens avoient des lampes
fépulcrales qui ne s’éteignoient point; mais c’ell une
erreur qu’il loutient : ces fortes de lampes éternelles
n’ont jamais e x illé , 5c tout ce qu’on a vu en ce gern
re n’offre que des phofphores, qui fe font allumés
pour un peu de tems après avoir été expofés à l’air. WBÊm
R A PA T E L L E , f. f. terme de Crainiers ; nom que
l’on donne à une efpeçe de toile claire faite de crin
de cheval, qui fert à faire des tamis ou fas pour paffer
l’amidon , le plâtre, & autres chofes femblables
que l’on veut mettre en poudre fine, ce qui fait qu’on
R A P
l’appelle quelquefois toile à tamis ou à fas. Cette toile
qui fe fabrique par morceaux prefque quarrés, depuis
un quart jufqu’à environ trois quarts d’aune de
Paris, quelquefois fuivant la longueur du crin, fe
vend par paquets de douze morceaux chacun, dont
lés plus grands font appelles amidonniers, du nom
des ouvriers qui s’en fervent le plus. Savait. (D . / .)
R A P E , f. f. terme d'ouvriers ; outil de fe r , trempé
en forme de lime, qui ett parfemé de plufieurs dents
ou pointes de fe r , & qui eft monté par un bout d’un
morceau de bois arrondi qui lui fert de manche. LeS
râpes font ordinairement plates d’un côté , 5c d’une
figure fphérique de l’autre. Il y a encore une forte
de râpes qui ont des dents ou rainures tranchantes ;
celles-ci s’appellent des écouannes, fi elles font grandes
; 5c des écouannettes, fi elles font petites. Ce font
les ouvriers des monnoies 5c les Peigniers-tabletiers
qui fe fervent de ces derniers ; les autres font des
outils de Cordonniers, Tourneurs, Menuifiers, Serruriers,
Sculpteurs, Plombiers , Ébéniftes, Arque-
bufiers, Fourbiffeurs, &c. (D . J .)
R â p e , de Tailleur de pierre , eft ordinairement un
morceau de tôle ou fer plat, piqué comme une grille
de râpe, qui fert à paner fur la pierre.
R â p e s , outil d'Arquebujîer, ce font des limes piquées
à grain d’orge , comme celles des Menuifiers,
&c. 5c fervent aux Arquebufiers pour diminuer les
bois de fufil.
R â p e , en terme de Bottier ; c’eft une lime taillée
fort rude, dont ils fe fervent pour ébaucher leurs tiges
avant de les dreffer. Voye\[ D r e s s e r .
R â p e , Cordonnier ; elle fert à râper les femelles
5c les talons, 5c elle eft demie ronde, 5c en tout fem-
blable à celle des Menuifiers.
R â p e , f. f.- ( uflenjile de Cuijine. ) c’eft un morceau
de fer-blanc courbé en voûte, percé deplufieus
trous dans les endroits,où le fer blanc eft relevé ; il
eft monté fur du bois , 5c la partie éminente des
pointes fert à râper le fucre , la mufeade, la croûte
de p ain, 5c autres chofes dures propres à être râpées.
R â p e s , ( outil de Ferblantier. ) c’ eft une lime à
grain d’orge faite comme les râpes des autres o u v r ie r s ,
5c fert aux ferblantiers p our diminuer les manches de
bois des c à ffe tie re s, &c.
R A P E , f. f. pl. outil de Fontainier, voye^ ¥ article
F o n t a in i e r .
R a p e , en 'terme de Formier, c’eft un inftrument en
forme de lime , mais qui a des dents beaucoup plus
groffes 5c plus écartées l’une de l’autre qu’une limé
ordinaire. Voyt2 la Planche du Formier.
R â p e s , outil deGuainier, ce font des limes qui font
piquées à grains d’orge enlevés, fort aigus. Les guaî-
niers en ont de plufieurs grandeur, 5c s’en fervent
pour râper les bois qu’ils emploient.
R â p e , ou L im e en BOIS , ( Menuiferie.') elle fert
aux menuifiers à arrondir ou ceintrer des parties ou
endroits où les autres outils ne peuvent atteind e.
Voye{ l’article & les Planches de MENUISERIE.
R â p e , ( Sculpture. ) efpece de lime dont lès fculp-
teurs en marbre 5c en pierre fe fervent en plufieurs
ôccafions en finiflant leurs ouvrages. Il y a des râpes
droites , coudées, piquées, de differente groffeur.
Les fculpteurs en bois s’ en fervent auffi ; ils en ont
de groffes, de petites , de plates , de quarrées , de
rondes, de demi-rondes, de courbées 5c de non courbées.
Voye{ les Planches du Sculpteur.
RAPE , f. m. ( (Econ. rujlique.) raifin nouveau dont
on emplit le tiers d’une futaille, afin d’y faire pafler
defîiis du vin gâté ou affoibli, pour lui donner de nouvelles
forces.
On prend un tonneau bien re lié , dans le fond duquel
on met un lit de farment, à la hauteur de deux
pouces ; on choifit enfuite de beaux raifins noirs bien
mûrs ; on en coupe toutes les queues près des grains
R A P
fans les c re v e r, on les inet doucement fur le farment
jufqu’au bondon ; enfuite on recommence un
autre lit de farment fur lequel on-met encore des rai-
fins jufqu’au pidprès de l’extrémité d’en haut: enfin ,
on fait un troifieme lit de farment, & en même tems
pn a foin de bien foncer ce tonneau; on le porte doucement
dans le lieu où on veut qu’il refte , après l’a-
yoir rempli d’un bon gros vin rouge , à trois doigts
du bord, pour lui donner la facilité de bouillir fans
.beaucoup de déchet. On l’entretient dans le commencement
de même que le vin , en évitant qu’il ne s ’éventé
» "( D . J . ) ,
R â p é d é c o p e a u x , ( Econ. rufliq. ) c’eft ainfi
qu’on appelle le râpé qui fe fait avec des copeaux
.qu’on met dans une futaille pour éclaircir le vin. Rien
n’eft plus innocent, ni mieux imaginé.
Les copeaux qu’on emploie doivent être lon<*s 5c
fe c s; on îâifie tremper ces copeaux quelques jours
dans l’eau , qu’on rechange deux ou trois fois par
jour pour ôter le goût du bois ; enfuite on les égoutte
, 5c on les fait bien fécher à l’air ; après quoi on les
met dans un tonneau qu’on remplit légèrement jufqu’à
un doigt près du bord , 5c on ferme le tonneau
de maniéré que le vin qu’on doit mettre dedans ne fe
perde point. '
Les copeaux étant bien préparés, 5c le tonneau
foncé, avant que de le remplir de v in , on y met une
chopine 5c plus d’eau-de-vie ; on bouche le tonneau
d’un bondon, puis on le roule jufqu’à ce qu’on juge
que les copeaux font bien imbibés de toute l’eau-de-
Vie. Cela fa it, on porte le tonneau dans l’endroit de
ïa cave qîi’on lui deftine, 5c on le remplit inceffam-
ment de vin. On gouverne le râpé comme tout autre
vin nouvellement entonné ; les râpés ne fouffrent
point long-terris la vuidànge , il faut les remplir à
mefure qu’ ils le vuiclent. Lcrfqu’on s’apperçoit que
les râpés de copeaux font trop long-tems à s’éclaircir
c’eft une marque que la lie y eft trop abondante ; il
faut, pour y remédier , défoncer la futaille , en ôter
les copeatix , les remplacer par d’autres tout femblables
5c pareillement imbibés d’eau-de-vie. (D . J . )
• R âpée , f . f. terme de riviere, il fe dit d’une gare où
l’on met les bateaux chargés, jufqu’à ce qu’ils aient
leur tour d’arrivage dans les ports. Il y a à Paris râpée
d’amont 5c râpée ci’avaL
RAPER , v. a&. ( Gramm. ) il a deux acceptions
afiêz differentes ; dans l’une il défigrie l’aftion de réduire
en poudre avec la râpe, 5c c’eft en ce fens qu’on
dit râper du fucre 5c du tabac ; dans l’autre , l’aefion de
donner avec le même inftrument à un corps la forme
qu’on fe propofe en ufant fa furface ; c’eft ainfi qu’on
le rend concave, plat, uni, &c.
RAPERSW1L , ( Géog. mod. ) ville de Suiffe aux
confins du canton de Zurich, fur une langue de terre
qui s’avance dans le lac de Zurich. Elle fut bâtie l’an
1 0 9 1 , 5c a eu long-tems fes comtes particuliers. Elle
eft à préfent fous la domination des. canton^ de Zurich
5c de Berne, qui s’en rendirent les maîtres en
1 7 1 1 , 5c fous la prote&ion de qui le traité d’Aran
régla qu’elle demeureroit à l’avenir , en confervant
fes droits 5c fes privilèges.
On a trouvé dans fon territoire en 1689 & 1690,
quantité de médailles romaines. Il y en avoit entr’-
autresde V alérien, de Claude IL d’Aurélien , de .Séverine
fa femme, de Probiiis, 5c de quelques-uns des
trente tyrans. Long. 2 6 . g o . lat. iy. 22 .
Je ne comtois que deux hoYnmes de lettres nés à
Râpersw il ; un théologien, p rote liant ,-dtixvj.fiecle,
nommé Placius( Conrad-Wolfgang ) , mais dont on
ne lit plus les ouvrages ; 5c S/7e^r(Pbilippe-Jacques),
qui a-; donné plufieurs livres de piété en allemand ,
outre fon opus heraldieum. Il eft mort à Berlin en
1705*, âgé de 70 ans. (D . J . )
RAPETASSER, v. aâs, c’eft raccommoder avec
R A P 795
des pieceS. Au fimple , on ne râpe taffe guere que de
vieilles hardes ; au figuré, il fe dit d’un difoours ;
d une piecede vers 5c de tout autre ouvrage de littérature.
°
RAPHÀNIS, f. m. ( Hiß. nat. Botàn. anc. ) nom
que les Athéniens parmi les Grecs donnoient au fai-
fort , raphanus ; 5c ce motrapkanus, ou * comme ils
difoient, raphanos , défignoit dans la langue attique
le chou, brafica. Tous les autres Grecs s^aécordoient
au contraire à appeüer le raifort raphanus , 5c le chou
erambe. Voilà d’où vient que tant d’auteurs ont confondu
ces,deux plantes, quoique fi différentes dans
leurs ports 5c dans leur ufage ; mais il fuffira d’obfer-
ver que toutes les fois que Théophrafte emploie le
mot raphanus , il entend le chou, ainfi que tous les
autres écrivains d’Athènes , ou qui ont fait ufage de
l’ idiome d’Athènes. Pline , faute d’avoir fait eefte remarque,
a été trompé par le mot raphanos de Théophrafte
; 5c en le traduifant mot-à-mot, il a attribué
au raphanus les details de l’auteur grec qui cobeernoit
le chou. ( D. J . ),
R A P H AN IST RUM , f. m. ( Hiß. nat. Botan. )
genre de plante à fleur en croix , compofée de quatre
pétales. Le piftil fort du calice de cette fleur, & de*
vient dans la fuite un fruit ou une filique articulée
qui renferme dans chaque articulation une femence
arrondie. Tournefort, infl. rei herb. F ’oyeç P l a n t e *
Pour caraâérifer ce genre déplanté en deux mots,
il fuffit de dire avec R a i, que fa filique eft divifée en
jointures, comme une colonne ornée d’une fufiée 5c
d’un filet, 5c que chaque jointure eft pleine de fernen-
ces rondes. Tournefort en compte cinq efoeces dont
aucune n’a befoin dedefeription particulière. ( D J . )
R A PH A N U S , { . m. ( Hiß. nat. Botan. ) Tournefort
compte quatre efpeces de ce genre de plante, Le
grand rond, le même à fleur blanche, le noir 5c le
petit des jardins.
Le grand eft le raphanus major hortenßs, orbicu-
laris , vel rotundus, 1. R . H. 22g). en anglois , tht
great round radish , en françois radis.
Sa racine eft longue , charnue , plus ou moins
graffe & tortue, de couleur brune ou noirâtre, qui a
d’abord la figure d’un petit navet, & qui en vieillif-
font groffit beaucoup , eft charnue , d’un goût très-
piquant , mais fans être defogréable,
E Elle pouffe .des feuilles grandes , rudes vertes ,
découpées profondément, reffemblantes à celles de
la rave. Il s’élève d’entre ces feuilles, des tiges à la
hauteur d’environ un pié & demi, fondes 5c Tameu-
fes ; elles portent des fleurs a quatre feuilles purpurines
, difpofées en croix. Lorfque les fleurs font tombées
, il leur fuccede des fruits formés en maniéré de
corne , fpongieux en-dedans, qui renferment ordinairement
deux rangs de femences prefque fondes
rouges ,j>lus grandes que celles du chou 5c de la moutarde
, âcres au goût.
On cultive cette plante dans les jardins potagers I
où elle fleurit d’affez bonne heure , 5c l’on retire fa
racine de terre principalement au printems, pendant
qu’elle eft tendre, fiieculente, facile à rompre 5C
bonne à manger ; car elle ne s’ emploie qu’en euifine*
Le raphanus minor , oblongus , ƒ. R . H. 2 lg . en
françois le raifort, n’eft diftingué du précédent qué
par fes racines longues, qui font à l’extérieur dâ
couleur rouge v i f , blanches en-dedans , d’un goût
moins fort que le radis , & plus agréable; on la mange
nouvellement femée, & on la cultive beaucoup
pour les tables ; on l’appelle improprement rave à Paris,
car ce nom ne convient qu’à la la rave du Limou-
fin , qu’on cultive dans les champs, 5c que les Bota-
niftesnomment rapa ou rapum. Voye\ R a v e .
Le grand raifort appelle Vulgairement le cràte , lâ
moutardelle, eft le raphanus rußte anus de C. B . 5c le
raphanus Jylveßris de J , B , M. de Tournefort l’a ran-
S||%
I
jgl f.