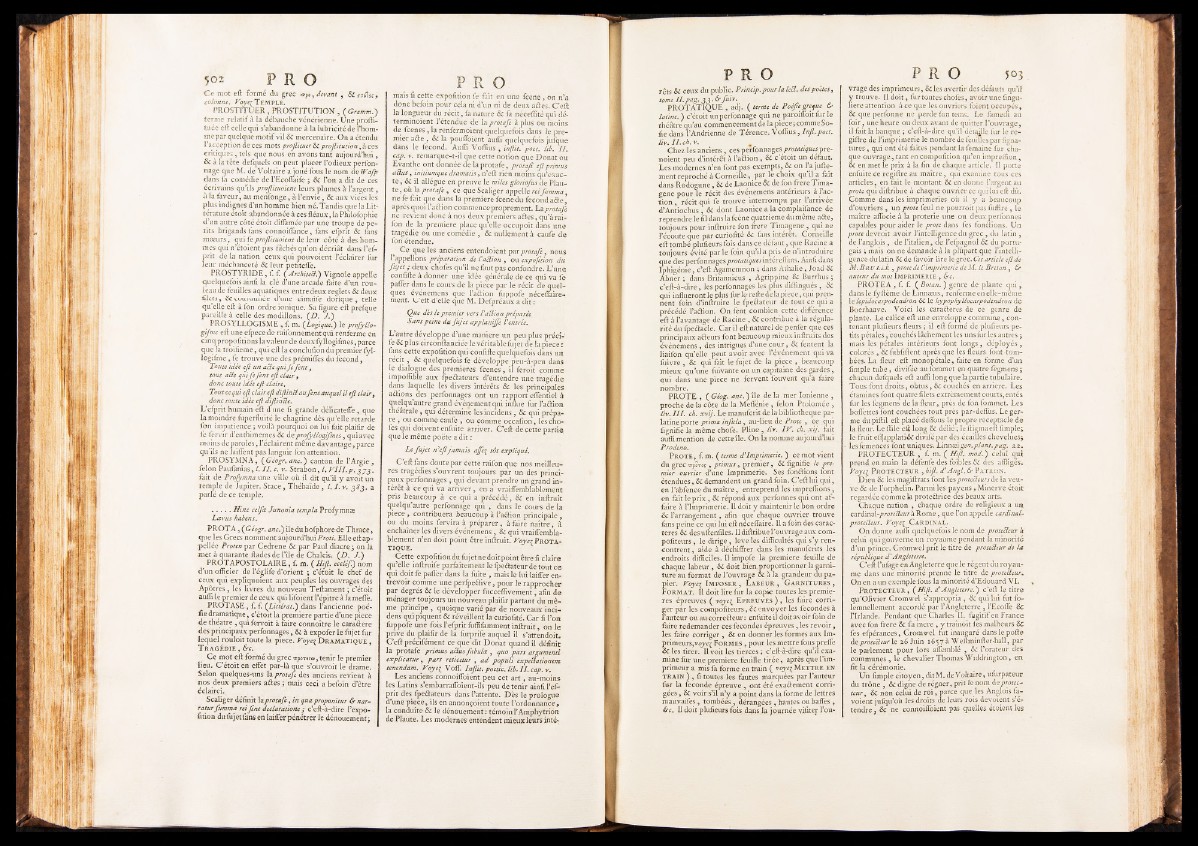
502 P RO
C e mot eft formé du grec ®po, devant , & nuloc ,
colonne. Voyt\ TEMPLE.
P RO ST ITU E R , PRO ST ITU T IO N , ( Gramm.)
terme relatif à la débauche vénérienne. Une profti-
tuée eft celle qui s’abandonne à la lubricité de l’homme
par quelque motif vil 6c mercenaire. On a étendu
l’acception de ces mots proßituer&c profiitution, à ces
critiques, tels que nous en avons tant aujourd’h u i,
& à la tête delquels on peut placer l’odieux perfon-
nage que M. de Voltaire ajoué fous le nom de JVafp
<ians fa comédie de l’Ecoflaife ; 6c l’on a dit de ces
écrivains qu’ils proßituoient leurs plumes à l’argent,
à la faveur, au menfonge, à l’envie, 6c aux vices les
plus indignes d’un homme bien né. Tandis que la L ittérature
etoit abandonnée à ces fléaux, la Philofophie
d’un autre côté étoit diffamée par une troupe de petits
brigands fans connoiffance, fans efprit 6c fans
moeurs, qui fe proßituoient de leur côté à des hommes
qui n’étoient pas fâchés qu’on décriât dans l’ef-
prit de la nation ceux qui pouvoient l’éclairer fur
leur méchanceté & leur petiteffe.
PROSTY R ID E , f. f. ( Architect.) Vignole appelle
quelquefois ainfi la clé d’une arcade faite d’un rouleau
de feuilles aquatiques entre deux reglets & deux
filets, & couronnée d’une cimaife dorique , telle
qu’elle eft à fon ordre ionique. Sa figure eft prefque
pareille à celle des modifions. (D . J . )
PROSYLLOGISME , f. m. [Logique.) le profyllo-
gifme eft une efpecede raifonnement qui renferme en
cinq propofitions la valeur de deuxfyllogifmes, parce
que la troilieme, qui eft la conclufion du premier fyl-
logifme, fe trouve une des prémiffes du fécond,
Toute idée eß un acte qui fe fen t ,
tout acte quife fent eß clair ,
donc toute idée eß claire.
Tout ce qui efi clair eß difiinct au fens auquel i l eß clair,
donc toute idée eß difiincie.
L ’efprit humain eft d une fi grande délicateffe , que
la moindre fuperfluité le chagrine dès qu’elle retarde
fon impatience ; voilà pourquoi on lui fait plaifir de
fe fervir d’enthimemes 6c de profyllogifmes, qui avec
moins de paroles, l’éclairent même davantage, parce
qu’ils ne îaiflent pas languir fon attention.
PROSYMNA, ( Géogr. anc.) canton de l’Argie ,
félon Paufanias, l. I I . c. v. Strabon, l. V I I I .p . 3 7 3 .
fait de Profymna une ville où il dit qu’il y avoit un
temple de Jupiter. Stace, Thébaïde, /. I . v. 3 8 3 . a
parlé de ce temple.
..........Hinc celfce Junonia templa Profymnæ
Lcevus Habens.
P RO T A , (Géogr. anc.) île du bofphore de Thrace,
que les Grecs nomment aujourd’hui Prori. Elle eft ap-
;pellée Proten par Cedrene 6c par Paul diacre; on la
met à quarante ftades de l’île de Chalcis. (D . J . )
^ PROTAPOSTOLAIRE, f. m. ( Hiß. eccléf) nom
d’un officier de l’églife d’orient ; c’étoit le chef de
ceux qui expliquoient aux peuples les ouvrages des
Apôtres , les livres du nouveau Teftament ; c’étoit
aufli le premier de ceux qui lifoient l’épitre à la meffe.
PRO TASE , f. f. (Littéral.) dans l’ancienne poé-
fie dramatique, c’étoit la première partie d’une piece
de theatre , qui fervoit à faire connoître le cara&ere
des principaux perfonnages, & à expofer le fujet fur
lequel rouloit toute la piece. Voye^ Dramatique ,
T ragédie , &c.
Ce mot eft forme du grec wpoTtv«, tenir le premier
lieu. C’étoit en effet par-là que s’ouvroit le drame.
Selon quelques-uns la protafe des anciens revient à
nos deux premiers attes ; mais ceci a befoin d’être
éclairci.
Scaliger définit la protafe, in qua proponitur & nar-
ratur fumma reifine declaratione ; c’eft-à-dire l’expo-
fition du fujet fans en laifler pénétrer le dénouement;
P R O
m a is f i c e tt e e x p o f i t io n f e fa i t e n u n e f e e n e , o n n ’ a
d o n c b e fo in p o u r c e la n i d ’u n n i d e d e u x a d e s . C ’e f t
la lo n g u e u r d u r é c i t , f a n a tu re & f a n é c e f li t é q u i dé-
t e rm in o ie n t l’ é t e n d u e d e la protafe à p lu s o u m o in s
d e f e e n e s , l a r e n fe rm o ie n t q u e lq u e fo i s d an s l e p r e m
ie r a f t e , & la p o u ffo ie n t a u fl i q u e lq u e fo is ju fq u e
d a n s le fé c o n d . A u f l i V o f l iu s , in fût. poet. lib. I I .
cap. v . r em a r q u e - t - il q u e c e tt e n o t io n q u e D o n a t o u
E v a n th e o n t d o n n é e d e la p r o t a f e , prota fi efi primus
actus, initiumque dramatis, n ’ e ft r ie n m o in s q u ’e x a c t
e , & i l a l lè g u e e n p r e u v e le miles gloriofus d e P la u t
e , o ù la protafe , c e q u e S c a l ig e r a p p e lle rei fumma ,
n e f e f a i t q u e .d an s la p r em iè r e f e e n e d u fé c o n d a é le
a p rè s q u o i l’ a & io n c om m e n c e p r o p r em e n t . L a protafe
n e r e v ie n t d o n c à n o s d e u x p r em ie r s a f t e s , q u ’ à r a i r
fo n d e la p r em iè r e p la c e q u ’ e lle o c c u p o it d an s u n e
t r a g é d ie o u u n e c om é d ie , 6c n u llem e n t à c a u fe d e
fo n é t e n d u e .
C e q u e le s a n c ie n s e n t e n d o ie n t p a r p rota fe, n o u s
l ’a p p e lio n s préparation de l'action , o u expofition du
fu je t y d e u x c h o fe s q u ’il n e fa u t p a s c o n fo n d r e . L ’u n e
c o n fif t e à d o n n e r u n e id é e g é n é r a le d e c e q u i v a f e
p a ffe r d an s le c o u r s d e la p i e c e p a r l e r é c i t d e q u e l q
u e s é v é n em e n s q u e l ’a & io n fu p p o fe n é c e ffa ire - ;
m e n t . C ’ e ft d ’ e l l e q u e M . D e fp r é a u x a d it :
Que dés le premier vers l'action préparée
S ans peine du fu je t applaniffe l'entrée.
L ’ a u t r e d é v e lo p p e d ’u n e m a n ié r é u n p e u p lu s p r é c i -
fe 6c p lu s c ir c o n f t a n c ié e le v é r i t a b le fu je t d e la p ie c e :
fa n s c e t t e e x p o f i t io n q u i c o n fif t e q u e lq u e fo is d an s u n
r é c i t , 6c q u e lq u e fo i s fe d é v e lo p p e p e u - à - p e u d an s
le d ia lo g u e d e s p r em iè r e s f e e n e s , i l f e r o i t c om m e
im p o f l ib le a u x lp e & a t e u r s d’e n t e n d re u n e t r a g é d ie
d an s la q u e l le le s d iv e r s in t é r ê t s & le s p r in c ip a le s
a t t io n s d e s p e r fo n n a g e s o n t u n r a p p o r t e f fe n t ie l à
q u e lq u ’a u t r e g ra n d é v é n em e n t q u i in f lu e fu r l ’a & io n
t h é â t r a le , q u i d é t e rm in e le s in c i d e n s , 6c q u i p r é p a r
e , o u c om m e c a u fe , o u c om m e o c c a f io n , le s c h o fe
s q u i d o iv e n t ë n fu ite a r r i v e r . C ’ e ft d e c e tt e p a rtie ,
q u e l e m êm e p o è t e a d it :
L e fu je t n'eft jam a is ajfe£ tôt expliqué.
C ’e ft fan s d o u t e p a r c e t t e r a ifo n q u e n o s m e ille u r
e s t r a g é d ie s s ’ o u v r e n t t o u jo u r s p a r u n d è s p r in c ip
a u x p e r fo n n a g e s , q u i d e v a n t p r e n d r e u n g r a n d in t
é r ê t à c e q u i v a a r r i v e r , e n a v r a if fem b la b lem e n t
p r i s b e a u c o u p à c e q u i a p r é c é d é , 6c e n in f t ru i t
q u e lq u ’a u t r e p e r fo n n a g e q u i , d an s le c o u r s d e la
p ie c e , c o n t r ib u e r a b e a u c o u p à l ’a f t io n p r in c ip a le ,
o u d u m o in s f e r v i r a à p r é p a r e r , à fa ire n a î t r e , à
e n c h a în e r le s d iv e r s é v é n em e n s , 6c q u i v r a i f lem b la -
b lem e n t n’ e n d o it p o in t ê t r e in f t ru it . Voye^ P r o t a -
TIQUE.
C e t t e e x p o f i t io n d u fu je t n e d o it p o in t ê t r e f i c la i r e
q u ’e l le in f t ru ife p a r fa item e n t le fp e & a t e u r d e t o u t c e
q u i d o it fe. p a ffe r d a n s la fu ite , m a is le lu i la i f fe r e n t
r e v o i r c om m e u n e p e r f p e f t i v e , p o u r le r a p p r o c h e r
p a r d e g r é s 6c le d é v e lo p p e r fu c c e f l î v em e n t , a fin d e
m é n a g e r to u jo u r s u n n o u v e a u p la if i r p a r t a n t d u m ê m
e p r in c ip e , q u o iq u e v a r i é p a r d e n o u v e a u x in c id
e n s q u i p iq u e n t 6c r é v e i l le n t la c u r io f i t é . C a r f i l ’ o n
fu p p o fe u n e fo is l ’e fp r it fu ffifam m e n t in f t r u i t , o n le
p r iv e d u p la if i r d e l a fu r p r ife a u q u e l i l s ’a t t e n d o it .
C ’e ft p r é c ifém e n t c e q u e d it D o n a t q u a n d il d é fin it
la p r o t a fe primus actus fabuliz , quo p ars argumenté
exp lica tu r, pars reticetur , a d p o p u li expeclationem
tenendam. Voye { V o f f . In jü t. poetic. lib. I I . cap. v .
L e s a n c ie n s c o n n o if fo ie n t p e u c e t a r t , a u -m o in s
le s L a t in s s ’ em b a r r a ffo ie n t - ils p e u d e t e n i r a in fi l ’ e f p
r it d e s fp e & a t e u r s d an s l’a t t e n t e . D è s le p r o lo g u e
d’ u n e p i e c e , il s e n a n n o n ç q ie n t to u t e l ’o r d o n n a n c e ,
la c o n d u it e 6c le d é n o u em e n t : t ém o in l’A m p h y t r iô n
d e P la u t e . L e s m o d e rn e s e n t e n d e n t m ie u x le u r s inté-
P R O
rêts 6c ceux du public. Princip.pour la lect. des poètes,
tome Il.pag. 3 3 . &fuiv.
PROTATIQUE , ad). ( terme de Poefie greque &
latine. ) c’étoit un perfonnage qui ne paroifloitfur le
théâtre qu’au commencement de la piece; comme So-
fie dans l’Andrienne de Térence. V oflius, Infi.poet.
liv. I I . ch. v. w
Chez les anciens, ces perfonnages protatiquesme-
noient peu d’intérêt à l’a ô io n , & c etoit un^defaut.
Les modernes n’ en font pas exempts, 6c on l’a jufte-
ment reproché à Corneille, par le choix qu il a fait
dans Rodogune, & de Laonice 6c de fon frere Tima-
gene pour le récit des évenemens anterieurs a l’act
io n , récit qui fe trouve interrompu par l’arrivée
d’Antiochus , & dont Laonice a la complaifance de
reprendre le fil dans la fcène quatrième du même a&e,
toujours pour inftruire fon frere Timagene , qui ne
l’écoute que par curiofité 6c fans interet. Corneille
eft tombe plufieurs fois dans ce défaut, que Racine a
toujours évité par le foin qu’il a pris de n’introduire
que des perfonnagesprotatiquesintereffans. Ainfi dans
Iphigénie, c’eft Agamemnon ; dans Athalie, Joad 6c
Abner ; dans Britannicus , Agrippine & Burrhus ;
c’eft-à-dire, les perfonnages Les plus diftingués , 6c
qui influeront le plus fur le refte delà piece, qui prennent
foin d’inftruire le fpeélateur de tout ce qui a
précédé l’aftion. On fent combien cette différence
eft à l’avantage de Racine , 6c contribue à la régularité
du fpe&acle. Car il eft naturel de penfer que ces
principaux atteurs font beaucoup mieux inftruits des
événemens , des intrigues d’une cour, 6c fentent la
liaifon qu’elle peut avoir avec l’événement qui va
fuivre , & qui fait le fujet de la piece , beaucoup
mieux qu’une fuivante ou un capitaine des gardes,
qui dans une piece ne fervent fouvent qu’à faire
nombre.
PROTE , ( Géog. anc. ) \ le de la mer Ionienne ,
proche de la côte de la Meffénie, félon Ptolomée ,
liv. I I I . ch. xvij. Le manuferit de la bibliothèque palatine
porte prima infula, au-lieu de P rote , ce qui
lignifie la. même chofe. Pline , liv. IV . ch. x ij. fait
aufli mention de cette île. On la nomme aujourd’hui
Prodeno.
Prote, f. m. ( terme d'imprimerie. ) ce mot vient
du grec npotoç , primus, premier, & lignifie le premier
ouvrier d’une Imprimerie. Ses fondions font
étendues, & demandent un grand foin. C ’eft lui qui,
en l ’abfence du maître, entreprend les impreflïons,
en fait le p r ix , & répond aux perfonnes qui ont affaire
à l’Imprimerie. Il doit y maintenir le Don ordre
& l’arrangement, afin que chaque ouvrier trouve
fans peine ce qui lui eft neceflaire. Il a foin des caractères
& desuftenfiles. Il diftribue l ’ouvrage aux com-
pofiteurs, le dirige , leve les difficultés qui s ’y rencontrent
, aide à déchiffrer dans les manuferits les
endroits difficiles. Il impqfe la première feuille de
chaque labeur, & doit bien, proportionner la garniture
au format de l ’ouvrage & à la grandeur du papier.
Voye[ Imposer , Labeur , Garnitures ,
Format. Il doit lire fur la copie toutes les premier
res épreuves ( voye%_ E preuves ) , les faire corriger
par les compofiteurs, & C envoyer les fécondés à
l’auteur ou au correfteur : enfuite il doit avoir foin de
faire redemander ces fécondés épreuves, les re voir,
les faire corriger , & en donner les formes aux Imp
r i m e u r s , Formes , pour les mettre fous preffe
& les tirer. Il voit les tierces ; c’eft-à-dire qu’il examine
fur une première feuille tirée, après que l’imprimeur
a mis fa forme en train ( voye[ Mettre en
train ) , fi toutes les fautes marquées par l ’auteur
fur la fécondé épreuve , ont été exaftement corrigées,
& voir s’il n’y a point dans la forme de lettres
mauyaifes, tombées, dérangées , hautes ou baffes ,
&c. Il doit plufieurs fois d^ns.Ia journée vifiter l’ou-
P R O 5 0 3
vrage des imprimeurs, & les avertir des défauts qu’il
y trouve. Il doit, fur toutes chofes, avoir une fingu-
liere attention à ce que les ouvriers foient occupés,
& que perfonne ne perde fon tems. Le famedi au
fo ir, une heure ou deux avant de quitter l ’ouvrage,
il fait la banque ; c’eft-à-dire qu’il dételle fur le re-
giftre de l’imprimerie le nombre de feuilles par figna-
tures, qui ont été faites pendant la femaine fur chaque
ouvrage, tant en compofition qu’en impreflion,
oc en met le prix à la fin de chaque article. Il porte
enfuite ce regiftre au maître, qui examine tous ces
articles, en fait le montant 6c en donne l’argent au
prote qui diftribue à chaque ouvrier ce qui lui eft dû.
Comme dans les imprimeries où il y a beaucoup
d’ouvriers , un prote feul ne pourroit pas fuflire , le
maître affocie à la proterie une ou deux perfonnes
capables pour aider le prote dans fes fondions. Un
prote devroit avoir l ’intelligence du grec , du latin ,
de l’anglois , de l’italien, de l’efpagnol & du portugais
; mais on ne demande à la plûpart que l ’intelligence
du latin Sc de favoir lire le grec. Cet article efi de
M. B ru LLÈ , prote de l'imprimerie de M. le Breton , 6*.
auteur du mot Imprimerie , &c.
PROTEA , f. f. ( Botan. ) genre de plante q u i,
dans le fyftème de Linnæus, renferme en elle-même
le lepidocarpodendron 6c le hypophyllocarpodendron de
Boerhaave. Voici les carafteres de ce genre de
plante. Le calice' eft une enveloppe commune, contenant
plufieurs fleurs ; il eft formé de plufieurs petits
pétales, couchés lâchement les uns fur les autres ;
mais les pétales intérieurs font longs, déployés ,
colorés , &fubfiftent après que les fleurs font'tombées.
La fleur eft monopétale, faite en forme d’un
fimple tube, divifée au fommet en quatre fegmens ;
chacun defquels eft aufli long que la partie tubulaire.
Tous font droits, obtus, & couchés en arriéré. Les
étamines font quatre filets extrêmement courts, entés
fur les fegmens de la fleur, près de fon fommet. Les
boflettes font couchées tout près par-deffus. Le germe
du piftil eft placé deffous le propre réceptacle de
la fleur. Le ftile eft long & délié ; le ftigmaeft fimple;
le fruit eft|applati& divifé par des écailles chevelues;
les femences font uniques. 'Umnæxgen.plant.pag. 2.2.
PRO TECT EUR , f. m. ( Hifi. mod. ) celui qui
prend en main la défenfe des foibles 6c des affligés.
Voye{ Protecteur , hifi. d'Angl. & Patron.
Dieu & les magiftrats font les protecteurs de la veuve
6c de l’orphelin. Parmi les payens, Minerve étoit
regardée comme la proteûrice des beaux arts.
Chaque nation , chaque ordre de religieux a un
cardiml-protecteur à Rome, que l’on appelle cardinal-
protecteur. Voye^ Cardinal.
On donne aufli quelquefois le nom de protecteur à
celui qui gouverne un royaume pendant la minorité
d’un prince. Cromwel prit le titre de protecteur de la
république d'Angleterre.
C ’eft l’ufage en Angleterre que le régent du royaume
dans une minorité prenne le titre de protecteur.
On en a un exemple fous la minorité d’Edouard VI.
Protecteur, (Hifi. d'Angleterre.) c ’eft le titre
qu’Olivier Cromwel s’appropria , 6c qui lui fut fo-
lemnellement accordé par l’Angleterre , l’Ecofle 6c
l’Irlande. Pendant que Charles IL fugitif en France
avec fon frere & fa mere , y traînoit fes malheurs 6c
fes efpérances, Cromwel fut inauguré dans le pofte
de protecteur le 26 Juin 1657 à Weftminfter-hall, par
le parlement pour lors aflemblé , 6c l’orateur des
communes, le chevalier Thomas Widdrington, en
fit la cérémonie.
Un fimple citoyen, ditM. de Voltaire, ufurpateur
du trône , & digne de régner, prit le nom de protecteur,
6c non celui de ro i, parce que les Anglois fa-
voient juiqu’où les droits de leurs rois dévoient s’ér
tendre, 6c ne connoiffoient pas quelles étoient les