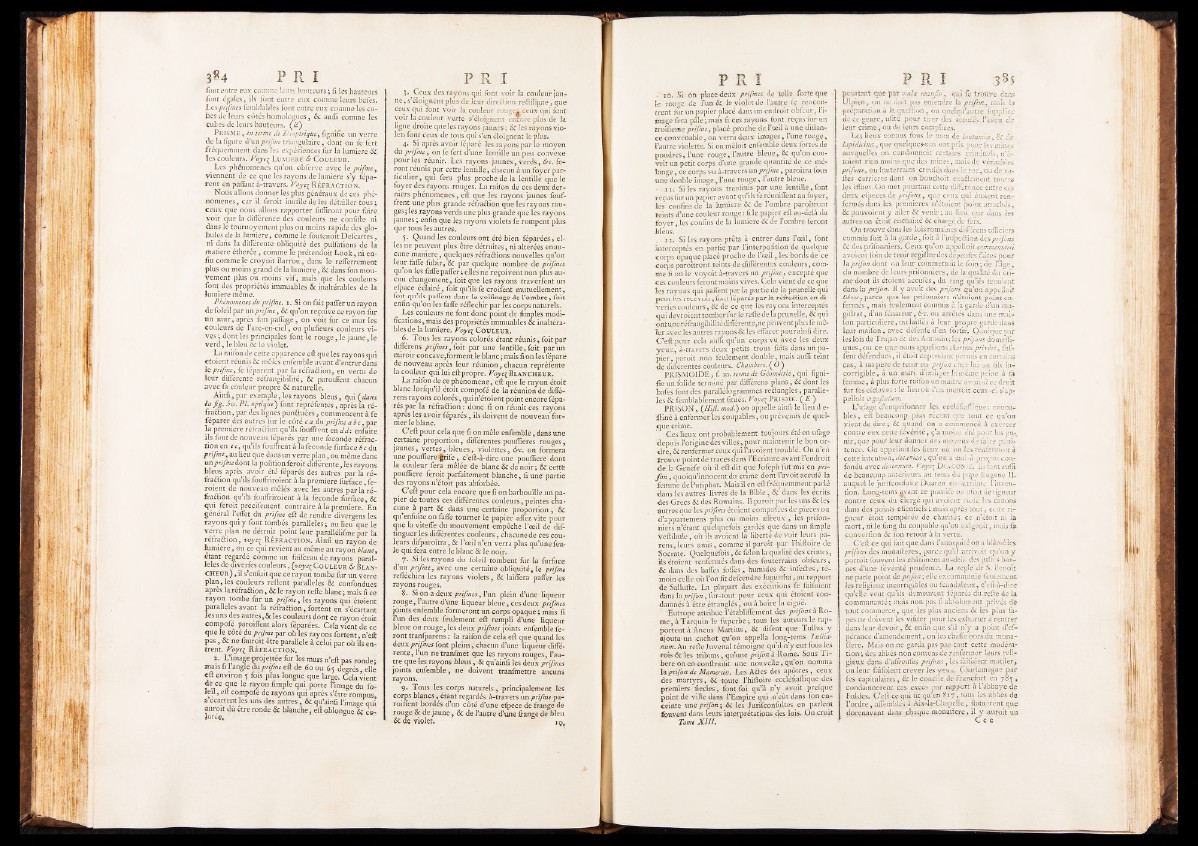
font entre eux comme leurs hauteurs ; fi les hauteurs
font égales, ils font entre eux comme leurs bafes.
JLes prifmes femblables font entre eux comme les cubes
de leurs côtés homologues, & auffi comme les
cubes de leurs hauteurs. (iQ
Prisme , en terme de Diop trique, fignifîe un verre
de la figure d’un prifme triangulaire, dont on fe fert
fréquemment dans les expériences fur la lumière &
les couleurs. Voye[ Lumière & Couleur.
Les phénomènes qu’on obferve avec le prifme,
viennent de ce que les rayons de lumière s’y fépa-
rent en paflant à-travers. Vayeç Réfraction.
Noiis allons donner les plus généraux de ces phénomènes
, car il feroit inutile de les détailler tous ;
ceux que nous allons rapporter fuffiront pour faire
voir que la différence des couleurs ne confifte ni
dans le tournoiement plus ou moins rapide des globules
de la lumière, comme le foutenoit Defcartes,
ni dans la différente obliquité des pulfations de la
matière étherée, comme le prétendoit Lo o k , ni enfin
comme le croyoit Barrou, dans le refferrement
plus ou moins grand de la lumière, & dans fon mouvement
plus ou moins v i f , mais que les couleurs
font des propriétés immuables & inaltérables de la
lumière même.
Phénomènes du prifme. i . Si on fait paffer un rayon
de foleil par un prifme, & qu’on reçoive ce rayon fur
un mur, après fon paffage, on voit fur ce mur les
couleurs de l’arc-en-ciel, ou plufieurs couleurs v ives
; dont les principales font le rouge, le jaune, le
verd, le bleu Ôc le violet.
La raifon de cette apparence eft que les rayons qui
etoient réunis & mêlés enfemble avant d’entrer dans
1 z prifme, fe féparent par la réfra&ion, en vertu de
leur différente réfrangibilité, & parodient chacun
avec fa couleur propre & naturelle.
Ain fi,p a r exemple, les rayons bleus, qui ( dans
la fig. 5 o. PI. optique) font repréfentes , après la réfraction
, par des lignes ponctuées, commencent à fe
féparer des autres fur le côté c a du prifme a b c , par
la première réfraCtion qu’ils fouffrent en d d : enfuite
ils font de nouveau féparés par une fécondé réfraction
en e e, qu’ils fouffrent à la fécondé furface bc du
prifme, au lieu que dans un verre plan, ou même dans
un prifme dont la pofition feroit différente, les rayons
bleus après avoir été féparés des autres par la réfraction
qu’ ils fouffriroient à la première furface fe-
roient de nouveau mêlés avec les autres par la’ réfraction
qu’ils fouffriroient à la fécondé furface Sc
qui feroit précifement contraire à la première. ’En
général l’effet du prifme eft de rendre divergens les
rayons qui y font tombés parallèles; au lieu que le
verre plan ne détruit point leur parallélifme par la
réfraction, voyei Réfraction. Ainfi un rayon de
hunier e , ou ce qui revient au même au rayon blanc,
étant regardé comme un faifceau de rayons parallèles
de diverfes couleurs, (yoyei Couleur & Blancheur)
, il s’ enfuit que ce rayon tombe fur un verre
plan,les couleurs refient paralieles S i confondues
après la réfraCtion, & le rayon refle blanc; mais fi ce
rayon tombe fur un prifme, les rayons qui étoient
parallèles avant la .réfraCtion, fortent en s’ écartant
les uns des autres, & les couleurs dont ce rayon étoit
compofé paroiffent alors féparées. Cela vient de ce
que le côté du prifme par où les rayons fortent, n’efi
pa s, Sc ne fauroit être parallèle à celui par où ils entrent.
Voye^ Réfraction.
1 . L’image projettée fur les murs n’eft pas ronde;
mais fl l’angle du prifme efl de fip ou 6 5 degrés elle
eft environ 5 fois plus longue que large. Cela vient
de ce que le rayon fimple qui porte l’image du fole
il, eft compofi de rayons qui après s’être rompus
s’écartent l,e's juns des autres, Sc qu’ainfi l’image qui
aurait dû être ronde & blanche, eft obloneue Sc colorée,
3 . C e u x d e s r a y o n s q u i fo n t v o i r la c o u le u r j a u n
e , s ’ é lo ig n e n t p lu s d e le u r d ire c tio n reC t ilig n e , q u e
c e u x q u i fo n t v o i r la c o u le u r r o u g e t c e u x q u i fo n t
v o i r la c o u le u r v e r t e s ’é lo ig n e n t e n c o re p lu s d e la
lig n e d r o ite q u e le s r a y o n s ja u n e s ; Sc le s r a y o n s v io le
t s fo n t c e u x d e to u s q u i s ’e n é lo ig n e n t le p lu s .
4 . S i a p rè s a v o i r fé p a r é le s r a y o n s p a r le m o y e n
d u p r ifm e , o n fe f e r t d ’u n e le n t il le u n p e u c o n v e x e
p o u r le s r é u n ir . L e s r a y o n s j a u n e s , v e r d s , &c. f e ro
n t ré u n is p a r c e tt e le n t i l l e , c h a cu n à u n f o y e r p a r t
ic u l i e r , q u i f e r a p lu s p r o c h e d e la le n t ille q u e le
f o y e r d e s r a y o n s ro u g e s . L a r a ifo n d e c e s d e u x d e r n
ie r s p h é n om è n e s , e f i q u e le s r a y o n s ja u n e s fo u f fr
e n t u n e p lu s g ra n d e ré fraC t io n q u e le s r a y o n s ro u g
e s ; le s r a y o n s v e r d s u n e p lu s g ra n d e q u e le s r a y o n s
ja u n e s ; e n fin q u e le s r a y o n s v io le t s f e rom p e n t p lu s
q u e to u s le s a u t r e s .
5 . Q u a n d le s c o u le u r s o n t é t é b ie n fé p a r é e s , e l le
s n e p e u v e n t p lu s ê t r e d é t ru it e s , n i a lt é r é e s e n a u c
u n e m a n ié r é , q u e lq u e s ré fr a c t io n s n o u v e lle s q u ’ort
le u r .fa ffe fu b i r , Sc p a r q u e lq u e n om b r e d e prifmes
q u ’o n le s fa ffe p a f f e r ; e lle s n e r e ç o iv e n t n o n p lu s a u c
u n c h a n g em e n t , f o i t q u e le s r a y o n s t r a v e r fe n t u n
e fp a c e é c l a i r é , fo it q u ’ils fe c ro ife n t m u tu e l lem e n t ,
fo.it q u ’il s p a ffe n t d an s l e v o i fin a g e d e l’o m b r e , fo i t
e n fin q u ’o n le s fa f fe r é flé c h ir p a r le s c o r p s n a tu re ls .
L e s c o u le u r s n e fo n t d o n c p o in t d e fim p le s m o d ific
a t io n s , m a is d e s p r o p r ié t é s im m u a b le s Sc in a lt é r a b
le s d e la lum iè r e . Voye£ Couleur.
6 . T o u s le s r a y o n s c o lo r é s é t an t r é u n i s , fo i t p a r
d iffe re n s prifmes, (oit p a r u n e le n t i l l e , fo it p a r u n
m ir o ir c o n c a v e / o rm e n t le b la n c ; m a is f i o n le s fé p a r e
d e n o u v e a u a p r è s le u r r é u n io n , c h a c u n r e p r é fe n t e
la c o u le u r q u i lu i e f i p r o p r e . Voye^ Blancheur.
L a ra ifo n d e c e p h e n om e n e , e ft q u e le r a y o n é t o it
b la n c lo r fq u ’i l é to it c om p o fé d e la r é u n io n d e d iffé ro
n s r a y o n s c o lo r é s , q u in ’ é to ie n t p o in t e n c o r e fé p a -
r e s p a r la ré fraC t io n : d o n c f i o n r é u n it c e s r a y o n s
a p re s le s a v o i r f é p a r é s , il s d o iv e n t d e n o u v e a u fo r m
e r le b la n c .
C ’ e ft p o u r c e la .q u e f i o n m ê le e n fem b le , d an s u n e
c e r t a in e p r o p o r t io n , d iffé r e n te s p o u flie re s r o u g e s ,
j a u n e s , v e r t e s , b l e u e s , v io l e t t e s , &c. o n fo rm e r a
u n e p o u f f ie r e ^ r i f e , c ’e f t -à -d ir e u n e p o u flïe re d o n t
la c o u le u r fe r a m ê lé e d e b la n c Sc d e n o i r ; & c e t t e
p o u f liç r e fe ro i t p a r fa item e n t b la n c h e , fi u n e ' p a r t ie
d e s r a y o n s n ’ é to it p a s a b fo rb é e .
C ’e f t p o u r c e la e n c o r e q u e fi o n b a r b o u il le u n p a p
i e r d e to u te s c e s d iffé r e n te s c o u l e u r s , p e in t e s c h a c
u n e à p a r t Sc d a n s u n e c e r t a in e p r o p o r t io n , &
q u ’e n fu ite o n fa ffe t o u rn e r l e p a p ie r a lle z v i t e p o u r
q u e la v i t e f f e d u m o u v em e n t em p ê ch e l ’oe i l d e d is t
in g u e r le s d iffé r e n t e s c o u l e u r s , c h a cu n e d e c e s c o u le
u r s d ifp a r o î t r a , & l ’oe i l n ’ e n v e r r a p lu s q u ’u n e feu -
l e q u i f e r a e n t r e l e b la n c & l e n o ir ,
7 . S i le s r a y o n s d u fo le i l tom b e n t fu r la fu r fa c e
d ’u n prifme, a v e c u n e c e r t a in e o b l iq u it é , le prifme
ré flé c h ir a le s r a y o n s v i o l e t s , Sc la iffe r a p a ffe r le s
r a y o n s ro u g e s .
8 . S i o n a d e u x prifme s, l ’u n p le in d’u n e liq u e u r
r o u g e , l’a u t r e d ’u n e liq u e u r b le u e , c e s d e u x prifmes
jo in t s e n fem b le fo rm e r o n t u n c o r p s o p a q u e ; m a is f i
l ’u n d e s d e u x fe u lem e n t e f t r em p li d’u n e liq u e u r
b le u e o u r o u g e , le s d e u x prifmes jo in t s en fem b le f e ro
n t t ran fp a r e n s : la ra ifo n d e c e la e ft q u e q u an d le s
d e u x prifmes fo n t p l e in s , c h a cu n d’u n e l iq u e u r d iffé r
e n t e , l ’u n n e t r a n fm e t q u e le s r a y o n s r o u g e s , l’au t
r e q u e le s r a y o n s b l e u s , & q u ’a in fi le s d e u x prifmes
jo in t s e n f em b le , n e d o iv e n t t r an fm e t tr e au c u n s
r a y o n s .
9 . T o u s le s c o r p s n a tu r e l s , p r in c ip a lem e n t le s
c o r p s b la n c s » é t a n t r e g a rd é s à - t r a v e r s u n prifme p a ro
iffe n t b o rd e s d ’un c ô t é d ’u n e e fp e c e d e fra n g e d e
r o u g e & d e j a u n e , & d e l ’a u t r e d ’u n e fra n g e d e b le u
Sc d ç v i ç l e t , iq .
- t 6 . S i ô ft p la c e d e u x prifmes d e t e l le for-fë q u e |
J e ro u g e d e l'u n & le v io le t d e l>ut-re f e r e n c o n t
r e n t fu r u n p a p ie r p la c é dan s u n e n d ro it o b f c u r , l’im
a g e fe r a p a le ; m a is f i c e s r a y o n s fo n t r e ç u s fu r un
t ro iû em e prifme, p la c é p r o c h e d e l ’oe i l a u n e d iftan -
c e c o n v e n a b le , o n v e r r a d e u x im a g e s , L’u n e r o u g e ,
l ’ a u t r e .v io le t te . S i o n m ê io i t e n fem b le d e u x fo r t e s de
p o u d r e s , l’u n e r o u g e , l ’a u t r e b le u e » & q u ’ o n c o u - ;
v r î t u n p e t it c o r p s d’u n e g ra n d e q u a n t it é d e c e m é - ;
l a n g e , c e c o rp s v u à - t r a v e r s u n p rifm e, p a ro ît r a fo u s
u n e d o u b le im a g e , l ’u n e r o u g e , l’ a u t r e b le u e .
• 1 1 . S i le s r a y o n s t ran fm is p a r u n e le n t i l l e , fo n t
r e ç u s fu r u n p a p ie r a v a n t q u ’ ils f e ré u n ifie n t a u f o y e r , !
le s c o n fin s d e la lum iè r e Sc d e l ’om b re p a r a î t ro n t :
te in t s d’ u n e c o u le u r r o u g e : fi le p a p ie r e ft au -d e là d u ■
f o y e r , le s c o n fin s d e la lum iè r e Sc d e l’om b re fe ro n t ;
b le u s . ' • !
, 1 2 . S i le s r a y o n s p r ê t s à e n t r e r d an s l’oe i l , fo n t
in t e r c e p t é s e n p a r t ie p a r l’ in t e rp q fit io n d e q u e lq u e :
c o r p s o p a q u e p la c é p r o c h e d e l’ oe i l , le s b o rd s d e c e .
c o r p s p a ro it ro n t t e in t s d e d iffé r e n te s c o u le u r s , c om m
e fi ©ta le v o y o i t à - t r a v e r s u n p r ifm e , e x c e p t é q u e '
c e s c o u le u r s fe ro n t m o in s v i v e s . C e la v i e n t d e c e q u e ;
le s r a y o n s q u i p a ffe n t p a r là p a r t ie d e la p ru n e lle q u i
p e u t le s r e c e v o i r , fo n t f é p a r é s p a r l a r é fr a f r io n e n d iv
e r f e s c o u l e u r s , Sc d e c e q u e le s r a y o n s in t e r c e p t é s
q u i d e v ro ie n t tom b e r fu r Le re ft e d e la p ru n e lle , & q u i
o n t u n e ré fr a n g ib il it é d iffé r e n te ,n e p e u v e n t p lu s fe m ê le
r a v .e ç le s a u t r e s r a y o n s & le s e ffa c e r p o u r a in fi d ire .
C ’ e ft .pour c e la a u ffi q u ’ u n c o r p s v u a v e c le s d e u x
y e u x , à - t r a v e r s d e u x p e t it s t ro u s fa its d an s u n p a p
i e r , p a ro ît n o n fe u lem e n t d o u b le , m a is a u fl i te in t
d e .d iffé rente s c o u le u r s . Ch ambersf O ) _ • _
P R I S M O ID E , fi m . terme de Géométrie, q u i lig n if
ie u n fo l id e t e rm in é p a r d iffé re n s p lan s , & d o n t le s ;
b a fe s fo n t d e s p a r a l lé lo g r am m e s r e c t a n g le s , p a r a l le -
l e s & fem b la b lem e n t f itu é s . Voye\_ P r i sm e . ( E )
P R I S O N , (Jïift- mod.) o n a p p e lle a in fi le lie u d e - j
i t in é à e n fe rm e r le s .c o u p a b le s , o u p r é v e n u s d e q u e l- i
q u e c r im e .
C e s l i e u x o n t .p ro b a b lem e n t .tou jou r s é té en u fa g e |
d e p u is l’o r ig in e d e s v i l l e s , p o u r m a in te n ir le b o n o r - !
■ dre , Sc re n fe rm e r c e u x q u i l’a v o ie n t t ro u b le . O n n ’e n j
t r o u v e p o in t d e t r a c e s d an s l ’E c r i t u r e a v a n t l ’e n d ro it
d e la G e n è fe o ù i l e ft d it q u e Jo f ë p h fu t m is e n p r i-
fo n , q u o iq u ’ in n o c e n t du c r im e d o nt-l’a v o i t a c c u le la
fem m e d e P u t ip h a r . M a is i l en e ft fr é q u em m e n t p a r lé ;
d a n s le s a u t r e s l i v r e s d e l a B ib l e , Sç d an s le s é c r it s ;
d e s G r e c s & d e s R om a in s . 11 .p a ro ît p a r le s u iis & le s
a u t r e s q u e le s prifons é to ie n t c om p o fé é s d e p iè c e s o u ;
d ’ a p p a r tem e n s p l u s .o u m o in s a ffre u x , le s p r ifo n - |
n ie r s .n’ é tan t q u e lq u e fo is g a rd é s q u e dan s un fim p le j
v e f t i b u l e , o ù ils à v o ie n t la l ib e r té d e v o i r le u r s p a - :
r e n s , le u r s am i s , .com m e i l p a ro ît p a r i ’h if to ir e d e I
S o c r a t e . Q u e lq u e fo is , & f é lo n la q u a l i t é d e s c r im e s ; .
i l s é to ie n t re n fe rm é s d a n s d e s fo u t e r r a in s o b f c u r s , j
& d an s d e s b a ffe s f o fiè s , h um id e s Sç in f é r é s , t é - j
m o in c e l le o ù l ’o n f it d e fc e n d r e Ju g u r fh a , a u ra p p o r t .
d e S a llu f te . L a p lu p a r t d e s e x é c u t io n s fe fa ifo ie n t j
d an s l a p r ifo n , fu r - to u t p o u r c e u x q u i e to ie n t c o n - j
d am n é s à ê t re é t r a n g lé s , o u à b o ir e la c ig u ë .
E u t r o p e a t t rib u e l’ é ta b liffem e n t d e s prifons à R o - ;
m e -, à T a r q u in le fu p e r b e ; to u s le s a u te u r s le r a p - !
p o r t e n t à A n c u s M a r t iu s , & d ife n t q u e T u l lu s y j
a jo u t a u n .c a ch o t q û ’o n a p p e lla d o n g - je rn s Tullia- \
num. A u re ft e J u v e n a l tém o ig n e q u ’ i l n ’y e u t fo u s le s ;
r o i s ô f 'le s t r ib u n s , q u ’u n e prifou à R o m e . S o u s T i - j
b e r e o n en cQ nftru ifit u n e n o u v e lle j q u ’o n n om m a |
l a prifon de Marner tin. L e s A & e s d e s a p ô t re s , c e u x
d e s m a r t y r s , & to u te l’h ifto ir e e c d é f ia f t iq u e d e s
p r em ie r s f i e c l e s , fo n t .fo i q u ’ il n’ y a v o i t p r e fq u e
p o in t d e v i l le d an s l’ Em p ir e q u i n’ e ù t dan s fo n en»
c.e in te u n e prifon ; & le s Ju r ifc o n fu lt e s e n p a rle n t
f o u v e n t dan s le u t s in t e rp ré t a t io n s d e s .fois. O n c r o it
Tome X l lU
pourtant que pat malq manfo ? q.uï fé trouve dans
Ulpien, on ne doit p^s entendre fa prifon, mais la
préparation à la queftion, ou qu.elqu’autre fupplicé
de çe genre, ufite pour tirer des accules l’aveu de
leur crime, ou de leurs complices.
Les lieux connus fous le nom.de iauiuYauc, &: de
iapidïcina, , que quelques-uns ont pris pour les mines
auxquelles on confian>noit certains criminels, n’é-
tOrient rien moins .quç des mines, mais fie véritables
prifons, ou lo.uterrains creifiés dans le rof ,.ou fie va-
ftes carrières dont on’bouchoit exaftement toutes
les ifîiies. On met pourtant cette cfifférence entre ces
deux efpeces dg ^ , que ceux qui étoient renfermés
dans les premières n’étoient point attachés*
& pouvoient y aller & venir ; au lieu que dans les
.autres on étoit enchaîné & chargé de fers.
On trouve dansles fois romaines différens officiers
commis foit à la garde, foit à l’inlpeôion des prifons
6ç ides prifonniers. Ceux qu’on appelloit commentant
.avoient foin de tenir regiftre des depenfes faites pour
la prifon dont on leur çommettoit le foin ; de l’âge,
du nombre de leurs prifonniers, de la qualité du crir
me dont ils étoient accufés, du rang qu’ils teno’ ent
dans la prifon. Il y avoit des prifons qu’on appelloit
libres, parce que les prifonniers n’étoienf point enfermés
, mais feulement commis à la garde d’un ma-
giftrat, d’un fénateur, &c. ou arrêtés dans une mai-
fon particulière, au laifiés à leur propi'e garde dans
leur maifon, avec défenfe d’en fortir. Quoiqiie par
les lois de Trajan & des Antonins les prifons domefti-
ques,ou ce quemousappelionsckanresprivées, biffent
défendues, il étoit cependant permis en certains
Cas, à un pere de tenir en prifon chez lui un fils incorrigible
, à un mari d’infliger la même peine à fa
femme, à plus forte raifon un maître avoit-il ce droit
fur fes .efcîayes : le beu où i’on mettoit .ceux-ci s’ap-
pelfoit ergajiulurji.
L’ufage fi’emprifonn.er les eccléfxaftique.'; coupables,
eft beaucoup plus récent que tout ce qu’on
vient de dire ; & quand on a commencé à exercer1
contre eux cette fevérité , ç’a moins été pour les punir,
que pour leur donner des moyens de faire pénitence.
On appelloit lès lieux où on les renfermoit à
cette intention, decanica , qu’on a mai-à-propos confondu
avec diaconum. A7oye^ D iaco nïe. Ils font auffi
de beaucoup antérieurs au tems du pape Eugene IL
auquel le jurifconfulte Duaren en attribue l’invention.
Long-tems avant ce pontife on ufqit de rigueur
contre ceux du clergé qui avoient violé les canons
dans des points effentiels ; mais après tout, cette rigueur
étoit tempérée de charité ; ce . n’étoit ni la
mort, ni le fang du coupable qu’on exigeoit, mais fa
converfion & ion retour à la vertu.
C’eft ce qui fait que dans l’antiquité on a blâmé les
prifons des monafteres, parce qu’il arrivait qu’on y
portoit fouvent les châtimens au-deià des juftes bornes
d’une fevérité prudente. La réglé de S. Benoît
ne parle point de prifon ; elle excommunie feulement
les religieux incorrigibles ou fcandaleux, c’eft-à-dirê
qu’elle veut qu’ils demeurent féparés du refte de la
communauté; mais non pas fi abiplument privés de
tout commerce, que les plus anciens & les plus fa-
ges ne doivent les vifiter pour les exhorter à rentrer
dans leur devoir, & enfin que s’il n’y a point d’ef-
pérance d’amendement, on les chaffe hors du mona-
ftere. Mais on ne garda pas par-tout cette modération
.; des abbés non contens fie renfermer leurs religieux
dans d’affreufes prifons , les faifoient mutiler»
ou leur faifoient crever les yeux. Charlemagne par
fes capitulaires, & le concile.de Francfort en 785 ,
condamnèrent ces excès par rapport à l’abbaye de
Fuldes. C’eft ce qui fit qu’en 8 1 7 , tous les abbés de
l’ordre., afiemhlés à Aix-la-Chapelle, ftatuerent que
dorénavant dans cfoique monaftere, il y auroit un
C c c