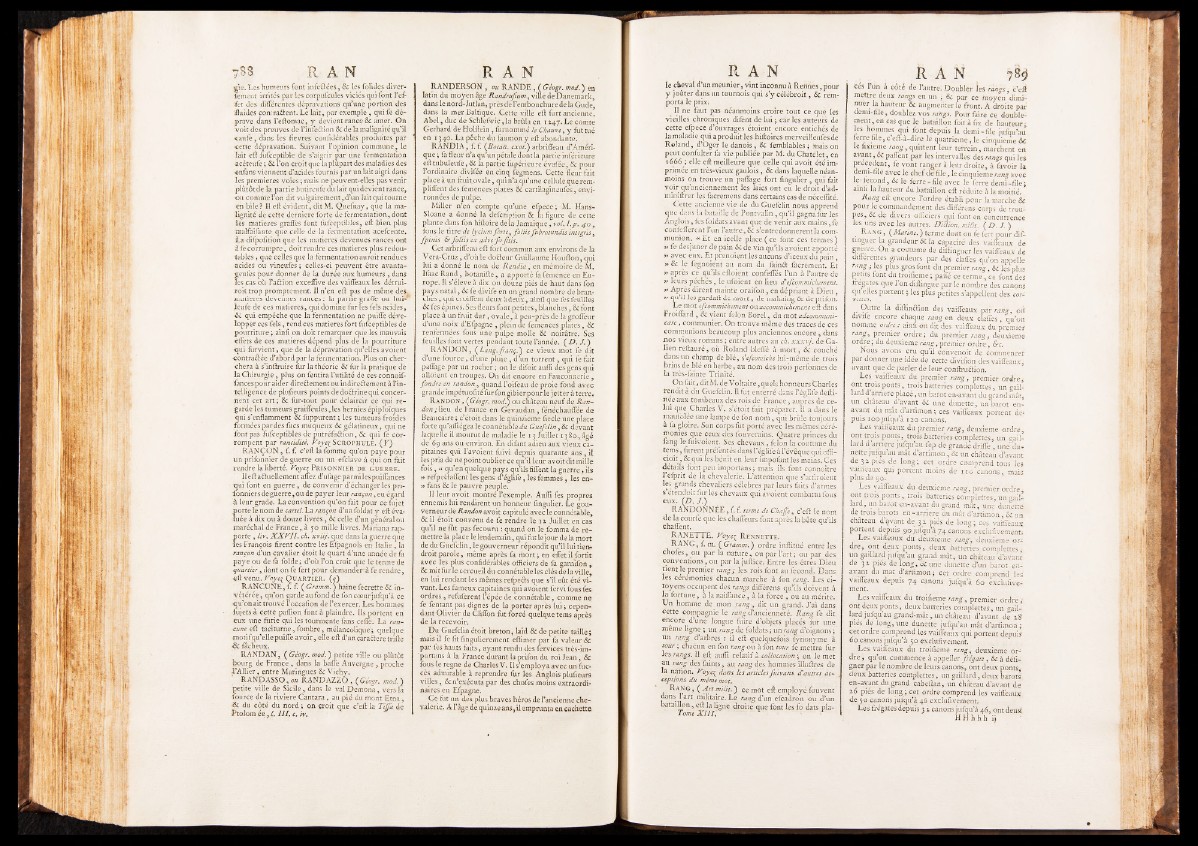
785 R A N
21e. Les humeurs font infeüées, 8c les foliées diver-
iement irrités par les corpuléules viciés qui font l’e ffet
des différentes dépravations qu’une portion des
fluides contractent. Le lait, par exemple , qui fe déprave
dans l’eftomaç, y devient rance & amer. On
voit des preuves de l’ infeCHon & de la malignité qu’il
•caufe, dans les fievres confidé.rables produites par
■ cette dépravation. Suivant l’opinion commune, le
lait eft fufceptible de s’aigrir par Une fermentation
acéteufe ; &c l’on croit que la plupart des maladies des
■ enfans viennent d’acides fournis par un lait aigri dans
les premières voies ; mais ne peuvent-elles pas venir
plutôt de la partie butireufe du lait qui devient rance,
ou comme l’on dit vulgairement, d’un lait qui tourné
en bile? Il ell évident, dit M. Quefnay, que la malignité
de cette derniere forte de fermentation, dont
les matières grades font fufceptibles, ell bien plus
malfaifante que celle de la fermentation acefcente.
La difpofition que les matières devenues rances ont
à fe corrompre, doit rendre ces matières plus redoutables
, que celles que la fermentation auroit rendues
acides ou vineufes ; celles-ci peuvent être avanta-
geufes pour donner de la duree aux humeurs , dans
les .cas oii Faction excedive des vaiffeaux les détrui-
roit trop promptement. Il n’en ell pas de même des.
matières devenues rances : la partie grade ou hui-
leufe de ces matières, qui domine fur les fels acides,
& qui empêche que la fermentation ne puiffe développer
ces fels, rend ces matierès fort fufceptibles de
pourriture ; ainfi on doit remarquer que les mauvais
effets de ces matières dépend plus de la pourriture
qui fiirvient, que de la dépravation qu’elles avoient
■ contractée d’abordpar la fermentation. Plus on cherchera
à s’inllruire fur la théorie & fur la pratique dé
la Chirurgie, plus on fentira l’utilité de ces connoif-
fancespour aider directement ou indirectement à l’intelligence
de plusieurs points de doCtrine qui concernent
cet art; & fur-tout pour éclaircir ce qui regarde
les tumeurs gràiffeufes ,les hernies épiploïques
qui s’enflamment & fuppurent ; les tumeurs froides
forméespardes fucs muqueux & gélatineux, qui ne
font pas fufceptibles de putréfaction, & qui fe corrompent
par rancidité. Voye^ SCROPHULE. (Y )
RANÇO N , f. f. c’ed la fomme qu’on paye pour
un prifonnier de guerre ou un efclave à qui on fait
rendre la liberté. Voye[ Pr i s o n n i e r d e g u e r r e .
Il eft actuellement affez d’ufage parmi les puiffances
•qui font en guerre , de convenir d’échanger les pri-
fonniers de guerre, ou de payer leur rançon, eu égard
à leur grade. La convention qu’on fait pour ce fujet
porte le nom de cartel. La rançon d’un fofdat y eft évaluée
à dix ou à douze liv re s, & celle d’un général ou
maréchal de France, à 50 mille livres. Mariana rapporte
, liv. X X V I I . ch. xviij. que dans la guerre que
les François firent contre les Efpagnols en Italie la
rançon d’un cavalier étoit le quart d’une année de fa
paye ou de fa folde ; d’oîi l’on croit que le terme de
quartier, dont on fe fert pour demander- à fe rendre,
•eft venu. Voye^ Q u a r t i e r . ( f )
RANCUNE, f. f. ( Gramm. ) haine fecrette & invété
ré e , qu’on garde au fond de fon coeur jufqu’à ce
qu’on ait trouvé l’occafion de l’exercer. Les hommes
fujetsà cette paflion font à plaindre. Ils portent en
eux une iarie qui les tourmente fans celle. La rancune
ell taciturne, fombre, mélancolique'; quelque
motif qu’elle puiffe a voir, elle ell d’un caraCtere trille
•& fâcheux.
R.ANDÄN, ( Géogr. mod. ) petite ville ou plutôt
bourg de France , dans la baffe Auvergne, proche
l ’Ailier, entre Maringues & Vichy.
’ RANDASSO, ou RANDAZZO , (Géogr. mod.)
petite ville de Sicile, dans le val Demona, vers la
fource de la rivière Cantara , au pié. du mont Etna,
•& du côté du nord ; on croit que c’ ell la Tijfa. de
Rtolom é e , l. I I I , c. iy.
R A N
RANDERSON , ou R A N D E , (Géogr. mod.) en
latin du moyen âge Randrujium, ville de Danemark,
dans le nord-Jutlan, près de l’embouchure de la Gu de,
dans la mer Baltique. -C,ette ville ell fort ancienne.
Abel, duc de Schlefwic,1a brûla en 12-47* he comte
Gerhard de Holltein, furnommé le Chauve, y fut tué
en 1340. La pêche du faumon y ell abondante.
R A N D IA , f. f. (Botah. exot.) arbriffeau d’Amérique
; fa fleur n’a qu’un pétàle dont la partie inférieure
ell tubuleufe, & la partie fupérieure évafée, & pour
l’ordinaire divifée en cinq legmens. Cette fleur fait
place à un fruit,ovale, qui n’a qu’une cellulè querem-
pliffent des femences plates & cartilagineufes, environnées
de pulpe.
Miller n’en compte qu’une efpece; M. Hans-
Sloane a donné la çlefcription & la figure de cette
plante dans fon hilloire de la Jamaïque, vol. I.p . 4 0 ,
lous le titre de lycium forte, foliis fubrotundis integris ,
fpinis & foliis ex adve fo jitis.
Cet arbriffeau eft fort commun aux environs de la
Vera-Cruz, d’oîi le doCteur Guillaume Houllon, qui
lui a donné le nom de Randia, en mémoire de M .
Ifaac Rand, botanille, a apporté fa femence en Europe.
Il s’élève à dix ou douze piés de haut dans fon
pays natal, 8c fe divife én un grand nombre de branches
, qui croiffent deux à deux, ainfi que fes feuilles
& fes épines. Ses fleurs font petites, blanches, 8c font
place à un fruit dur, ovale, à peu-près de la groffeur
d’une noix d’Efpagne , plein ae femences plates, 8c
renfermées fous une pulpe molle 8c noirâtre. Ses
feuilles font vertes pendant toute l’année. ( D. J . )
RANDON , (Lang.franç.) ce vieux mot fe dit
d’une fource, d’une pluie , d’un torrent, qui fe fait
paffage par un rocher ; on le difoit aufli des gens qui
alloient en troupes. On dit encore en Fauconnerie,
fondre en randon, quand l’oifeau de proie fond avec
grande impétuofité fur fon gibier pour le jetter à terre.
R a n d o n , (Géogr. mod.) ou château neuf de Randon;
lieu de France en Gevaudan, fénéchauffée de
Beaucaire ; c’ étoit dans le quinzième fiecle une place
forte qu’afliégea le connétable^« Guefclin, 8c devant
laquelle il mourut de maladie le 13 Juillet 13 8 0 , âgé
de 69 ans ou environ. En difant adieu aux vieux capitaines
qui l’avoient fuivi depuis quarante ans , il
les pria de ne point oublier ce qu’il leur avoit dit mille
fois, « qu’en quelque pays qu’ils fiffent la guerre, ils
» rèfpeaaffent les gens d’églife, les femmes, les eri-
» fans 8c le pauvre peuple.
Il leur avoit montré l’exemple. Aufli fes propres
ennemis lui rendirent un honneur fingulier. Le gouverneur
de Randon avoit capitulé avec le connétable,
& il étoit convenu de fe rendre le 12. Juillet en cas
qu’il ne fût pas feeouru : quand on le fomma de remettre
la place le lendemain, qui fut le jour delà mort
de du Guefclin, le gouverneur répondit qu’il lui tien»
droit parole, même après fa mort ; en effet il fortit
avec les plus confidérables officiers de fa garnifon ,
& mit fur le cercueil du connétable les clés de la ville,
en lui rendant les mêmes refpeCts que s’il eût été vivant.
Les fameux capitaines qui avoient fervi fous fes
ordres., refuferent l’épée de connétable, comme ne
fe fentant pas dignes de la porter après lui ; cependant
Olivier de Cliffbn fut forcé quelque tems après
de la recevoir.
Du Guefclin étoit breton, laid & de petite taille;
mais il fe fit fingulierement eftimer par fa valeur 8c
par fes hauts faits, ayant rendu des lervices très-im-
portans à la France durant la prifon du roi Jean, 8c
fous le régné de Charles V. Il s’employa avec un fuc-
cès admirable à reprendre fur les Anglois plufieurs
villes,, 8c n’exécuta par des chofes moins extraordinaires.
en Efpagne.
Ce fut un des plus braves héros de l’ancienne chevalerie..
A l’âge de quinze ans,il emprunta en cachetta
R A N
le cheval d’un meunier, vint inconnu à Rennes, pour
y jouter dans un tournois qui s’y célébroit, & remporta
le prixi
Il ne faut pas néanmoins croire tout ce quë les
vieilles chroniques difent de lui ; car les auteurs de
cette efpece d’ouvrages étoient encore entichés de
la maladie qui a produit les hiftoires merveilleufes de
Roland, d’Oger le danois, 8c femblables ; mais on
peut confulter fa vie publiée par M; du Chatélet, en
ï 666 ; elle eft meilleure que celle qui avoit été imprimée
en très-vieux gaulois, 8c dans laquelle néanmoins
on trouve un paffage fort fingulier , qui fait
voir qu’anciennement les laïcs ont eu le droit d’ad-
miniftrer les facremens dans certains cas de néceflité.
Cette ancienne vie de du Guefclin nous apprend
que dans la bataille de Pontvalin , qu’il gagna fiir les
Anglois, fes foldats avant que de venir aux mains, fe
confefferent l’un l’autre, & s’entredonnerentla communion.
« Et en icelle place ( ce font ces termes )
» fe desjuner de pain 8c de vin qu’ils avoient apporté
» avec eux. Et prenoient les aucuns d’ieeux du pain,
» & le fegnoient au nom du fainCt fâcrément. Et
» après ce qu’ils eftoient confeffés l’un à l’autre de
» leurs péchés, le ufoient en lieu d?éfcommichement.
» Après dirent mainte oraifon, en dé priant à Dieu ,
» qu’il les gardaft de mort, de mahaing 8c de prifon.
Le mot efcommichement dwaccommichement eft dans
Froiffard , 8c vient félon Borel, du mot adcommuni-
care, communier. On trouve même des traces de ces
communions beaucoup plus anciennes encore ; dans
, ,------------— - - 5 v*.. ■ w k u iu uiv-m. a i i i u u , CUUC11C
dans un champ de blé, s’efco/niche lui-même de trois
brins de blé en herbe, au nom des trois perfonnes de
la très-fainte Trinité.
On fait, ditM. de Voltaire, quels honneurs Charles
fendit à du Guefclin. Il fut enterré dans l’églife defti-
née aux tombeaux des rois de France, auprès de celui
que Charles V. s’étoit fait préparer. Il a dans le
rnaufolee une lampe de fon nom, qui brûlé toujours
à fa gloire. Son corps fut porté avec les mêmes cérémonies
que ceux des fouyerains. Quatre princes du
fang le fuivoient. Ses chevaux, félon la coutume du
tems, furent prefentés dans l’églife à l’évêque qui officient
, & qui les bénit en leur impôfantles mains; Ces
details font peu importans ; mais ils font connoître
l ’efprit de la chevalerie. L’attention que s’attiroient
les grands chevaliers célébrés par leurs faits d’armes
s etendoit fur les chevaux qui avoient combattu fous
eux,, (D . J . )
RANDONNÉE, f. f. terme de Chajj'e, c’eft le nom
de la coiirfe que lés chaflèurs font après la bête qu’ils
chaffent.
R ANE T T E . Voye£ R e n n e t t e .
R A N G , f. m. (Gramm.) ordre inftitué entré les
chofes, ou p a r la nature, ou par l’art; ou par des
conventions, ou parla juftiçé. Entre les êtres Dieu
tient le jpremier rang; les rois font au fécond. Dans
les cérémonies chacun marche à fon rang. Les citoyens
occupent des rangs différens qu’ils doivent à
la fortune, à la naifl'ance, à la force , ou au mérites
Un homme de mon rang, dit un grand. J ’ai dans
cette compagnie le rang d’ancienneté. Rang fe dit
encore d’une longue fuite d’objets plâçés fiir une
meme ligne ; un raij.g de foldats ; un rang d’oignons ;
un rang d’arbres : il eft quelquefois lÿrionyme à
tour ; chacun en fon rang ou à fon tour fe mettra fur
les rangs. Il eft aufli relatif à collocation ; on le met
au rang des faints, au rang des hommes illuftres de
la nation. Vyyeç dans les articles fuivans d’autres acceptions
du même mot.
R a n g , ( A rtmilit.) ce mot eft employé fouvent
dans 1 art militaire. Le rang d’un efeadron ou d’un
bataillon, eft la ligné droite que font les fo dats pla-
Tome X I I I ,
R À N 78^
tés l’ùn à coté de l’autrel Doubler les rangs ; c’eft
mettre deux rangs en un ; & par ce moyen dimi-
ntiêr la hauteur & augmenter le front. Â droite par
demi-file, doublez vos rangs. Poür faire ce. doublement,
en Ca$ que le bataillon foit à fix de hauteur;
les hommes qui font depuis la demi-file jufqu’ait
ferre file, c’eft-à-dire le quatrième, le cinquième &
le fixieme rang, quittent leur terrein, marchent en
avant, & paffent par les intervalles des rangs qui les
precedent, fe vont ranger à leür droite, â favoir la
demi-file avec lé chef de file, le cinquième rang avec
& *e ferre - file avec le ferre demi-file;
ainfi la hauteur du bataillon eft réduite à la moitié.
Rang eft encore l’ordre établi pour la marche &
pour le commandement des différens corps de troupes,
& de divers officiers qui font en concurrence
les uns avec les autres. Diction, milit. (D . J . )
R a n g , ( Marine. ) terme dont on fe fert pour dif-
tinguer la grandeur & la capacité des vaiffeaux de
guerre. On a coutume de diftinguer les vaiffeaux de
differentes grandeurs par des elaffes qu’on appelle
rang ; les plus gros font du premier rang, & les plus
petits font du troifieme ; paffé ce terme, ce font des
tregates que l’on diftingue par le nombre des canons
qu elles portent ; les plus petites s’appellent des corvettes.
Outre la diftinfrion des vaiffeaux par rang, oii
divife encore chaque rang en deux elaffes, qu’ort
nomme ordre : ainfi dn dit des vaiffeaux du premier
rang, premier ordre; du premier rang, deuxieme
ordre; du deuxieme rang^-premier ordre, &c.
Nous avons cru qu’il convenoit de commencef
par donner une idée de cette divifion des vaiffeaux;
avant que de parler dè leur conftru<ftion.
Les vaiffeaux du premier rang, premier ordre;
ont trois ponts, trois batteries complettes, un gaillard
d’arriere placé, un barot en-avant du grand mât;
un chateau d’avant & une dunette, un barot en-
avant du mat d’artimon ; cés vaiffeaux portent depuis
100 jufqu’à 12 0 canons.
Les vaiffeaux du premier rang, d'euxieme ordre
ont trois ponts, trois batteries complettes, un gaillard
d’arriere jufcpi’au fep de grande driffe , une dunette
jufqu’âu mât d’artimo'n, & un château d’avant
dé 3 2 piés de long ; cet ordre comprend tous les
vaiffeaux qui portent moins de n o canons, mais
plus de 90. -
Les vaiffeaux du deuxieme rang, premier ordre ■
ont trois ponts , trois batteries complettes, un gaillard,
un barot en-avant ydu grand mât, une dunette
barots en-arriéré du mât d’artimon ; & un
chateau d’avant de 3 2 pies de long ; ces vaiffeaux
portent depuis 90 jufqu’à 74 canons exclufivement;
Les vaiffeaux du. deuxieme rang, ’deuxieme ordre,
ont deux ponts, deux batteries.complettes;•
un gaillard jufqu’au grand mat, un château d’avant
de 32 piés de long, 6c une dunette d’un barot en-
avant du mat d’artimon; cet ordre comprend les
vaiffeaux depuis 74 canons jufqu’à 60 exclufivement.
Les vaiffeaux du troifieme rang, premier ordre ;
ont deux ponts, deux batteries complettes, un gail-
lard jufqu au grand-mât ; un château d’avant de 28
piés de long, une dunette jufqu’au mât d’artimon ;
cet ordre comprend les vaiffeaux qui portent depuis1
60 canons jufqu’à 50 exclufivement.
Les vaiffeaux du trô'ifiëmè rang ,• deuxieme ord
re , qu’on commence à appeller frégate > êc à défi-
gner par le nombre de leurs canons,- ont deux ponts,-
deux batteries complettes, un gaillard, deux barots
en-avant du grand cabeftan, un éhâteau d’avant dé
26 piés dé long ; cet. ordre comprend les vaiffeaux
de 50-canofis jufqu’à 46 exclufivement.
Les frégates depuis 3 2 canons jufqu’à 46, ont deux
H H h h h ij