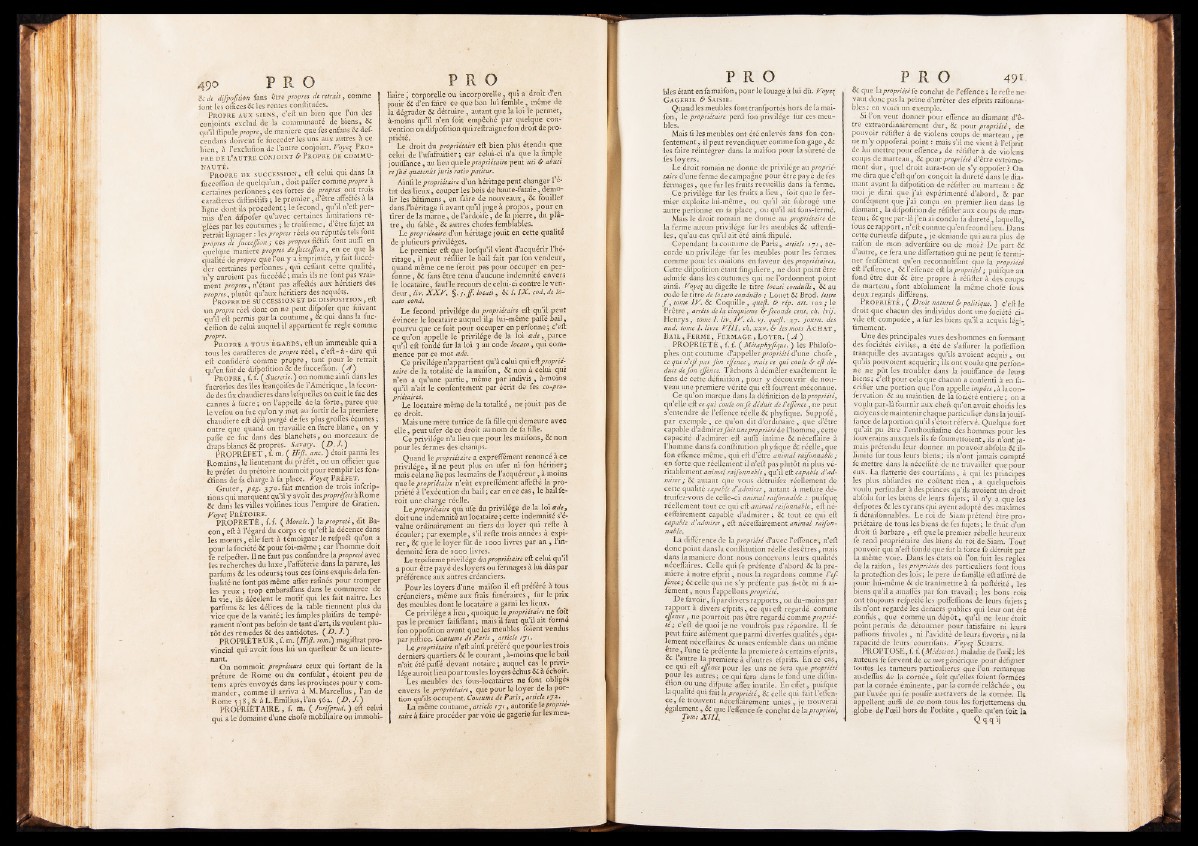
%zde difpojiùon fans être propres de retrait, c o m m e
font lès offices & les rentes constituées.
Propre aux siens, c’eft un bien que lun des
conjoints exclüd de la communauté de biens, &
qu’il ftipulepropre, de maniéré que fes enfans & def-
cendans doivent fe fucceder les uns aux autres à ce
bien, à l’exclufion de l’autre conjoint. Voye{ Propre
DE L’AUTRE CONJOINT & PROPRE DE COMMUNAUTÉ.
. , . . , .
Propre de succession, eft celui qui dans la
fucceffion de quelqu’un , doit paffer comme propre à
certaines perfonnes ; ces fortes de propres ont trois
carafteres diftinftifs ; le premier, d’être affeftés à la
ligne dont ils procèdent; le fécond, qu’il n’eft permis
d’en difpofer qu’avec certaines limitations réglées
par les coutumes ; le troifieme, d’être fujet au
retrait lignager : les propres réels ou réputés tels font
propres de fucceffion; ces propres fictifs font auffi en
quelque manière propres de fucceffion, en ce que la
qualité de propre que l’on y a imprimée, y fait uicce-
der certaines perfonnes, qui ceffant cette qualité,
n'y auroient pas fuccede ; mais ils ne font pas vraiment
propres, n’ étant pas affe&és aux héritiers des
propres, plutôt qu’aux héritiers des acquêts.
Propre de succession et de disposition , eft
un propre réel dont on ne peut difpofer que fuivant
qu’il eft permis par la coutume, & qui dans la fucceffion
de celui auquel,il appartient fe réglé comme
propre. . ( ~ t
Propre a tous égards , eft un immeuble qui a
tous les cara&eres de propre réel, c’eft-à-dire qui
eft confidéré comme propre, tant pour le retrait
qu’en fait de difpofition & de fucceffion. (A )
Propre , f. f. ( Sucrerie.') on nomme ainfi dans les
fucreries des îles françoifes de l’Amérique, la fécondé
des fix chaudières dans lefquelles on cuit le fuc des
cannes à fucre ; on l’appelle de la forte, parce que
le vefou ou fuc qu’on y met au fortir de la première
chaudière eft déjà purgé de fes plus groffes écumes ;
outre que quand on travaille en fucre blanc, on y
pafle ce fuc dans des blanchets, ou morceaux de
draps blancs & propres. Savary. {D . J . )
PRO PR ÉFET, f. m. ( Hift. anc. ) étoit parmi les
Romains, le lieutenant du préfet, ou un officier que
le préfet du prétoire nommoit pour remplir les fondions
de fa charge à fa place. Voye{ Prefet.
Gruter, pag. $ y o . fait mention de trois infcrip-
tions qui marquent qu’il y avoit àespropréfets à Rome
& dans les villes voifines fous l’empire de Gratien.
Voye{ P r é t o i r e .
PRO P R E T É , f. f. ( Morale. ) la propreté, dit Bacon,
eft à l’égard du corps ce qu’eft la décence dans
les moeurs, elle fort à témoigner le refped qu’on a
pour la fociété & pour foi-même ; car l’homme doit
le refpe&er. Il ne faut pas confondre la propreté avec
les recherches du luxe, l’afféterie dans la parure, les
parfums & les odeurs; tous ces foins exquis delà fen-
lualité ne font pas même affez rafïnés pour tromper
les yeux ; trop embaraflans dans le commerce de
la v ie , ils décrient le motif qui les fait naître. Les
parfums & les délices de la table tiennent plus du
vice que de la vanité ; les fimples plaifirs de tempérament
n’ont pas befoin de tant d’art, ils veulent plutôt
des remedes & des antidotes. ( D . J . )
PRO PR ÉT EU R , f. m. {Hift. rom.) magiftrat provincial
qui avoit fous lui un quefteur & un lieutenant.
On nommoit propréteurs ceux qui fortant de la
préture de Rome ou du confulat, étoient peu de
tems après envoyés dans les provinces pour y commander,
comme il arriva à M.Marcellus, l’an de
Rome 5 3 8 ; & à L . Emilius, l’an 562. (D . / .à
PRO PR IÉTA IR E, f. m . ( Jurifprud. ) eft celui
qui a le domaine d’une chofe mobiliaire ou immobiliaire
\ corporelle ou incorporelle, qui a droit d’en
jouir & d’en faire ce que bon lui femble, même de
la dégrader & détruire , autant que la loi le permet,
à-moins qu’ il n’en foit empêche par quelque convention
ou difpofition qui reftraigne fon droit de propriété.
Le droit du propriétaire eft bien plus étendu que
celui de l’ufufruitier ; car celui-ci n’a que la fimple
jouiflance, au lieu que le propriétaire peut uti & abuti
refuâ quatenks juris ratio patitur.
Ainfi le propriétaire d’un héritage peut changer l Je-
tat des lieux , couper les bois de haute-futaie, démolir
les bâtimens, en faire de nouveaux, & fouiller
dans .l’héritage fi avant qu’il juge à propos, pour en
tirer de la marne, de l’ardoife, de la pierre, du plâtre
, du fable, & autres chofes femblables.
Le propriétaire d’un héritage jouit en cette qualité
de plufieurs privilèges.
Le premier eft que lorfqu’il vient d’acquérir l ’héritage,
il peut réfilier le bail fait par fon vendeur,
quand même ce ne feroit pas pour occuper en personne
, & fans être tenu d’ aucune indemnité envers
le locataire, fauf le recours de celui-ci contre le vendeur
, liv. X X V , §. j . j f . locati , èc l. IX . cod. de lo-
cato cond.
Le fécond privilège du propriétaire eft qu’il peut
évincer le locataire auquel il,p lui-même paffo bail,
pourvu que ce foit pour occuper en perfonne ; c’efl:
ce qu’on appelle le privilège de la loi oede parce
qu’il eft fondé fur la loi 3 au code locato, qui commence
par ce mot oede.
Ce privilège n’appartient qu’à celui qui eftproprié
taire de la totalité de la maifon, & non à celui qui
n’en a qu’une partie, même par indivis , à-moins
qu’il n’ait le confentement par écrit de fes co-propriétaires.
y .
Le locataire même de la totalité, ne jouit pas de
ce droit.
Mais une mere tutrice de fa fille qui demeure avec
e lle , peut ufor de ce droit au nom de fa fille.
Ce privilège n’a lieu que pour les maifons, & n on
pour les fermes <|es champs.
Quand le propriétaire a expreflement renoncé à ce
privilège, il ne peut plus en ufor ni fon héritier;
mais cela ne lie pas les mains de l’acquéreur, à-moins
que le propriétaire n’eût expreflement affeéle la propriété
à l’exécution du bail ; car en ce cas, le bail fo-
roit une charge réelle.
Le propriétaire qui ufo du privilège de la loi oede,
doit une indemnité au locataire ; cette indemnité s’évalue
ordinairement au tiers du loyer qui refte à
écouler; par exemple, s’il refte trois années à expire
r , & que le loyer fut de 1000 livres par an , l’indemnité
fora de 1000 livres.
Le troifieme privilège du propriétaire eft celui qu’il
a pour être payé des loyers ou fermages à lui dus par
préférence aux autres créanciers.
Pour les loyers d’une maifon il eft préféré à tous
créanciers, même aux frais funéraires, fur le prix
des meubles dont le locataire a garni les lieux.
Ce privilège a lieu, quoique le propriétaire ne foit
pas le premier faififlant ; mais il faut qu’ il ait forma
fon oppofition avant que les meubles foient vendus
par juftice. Coutume de Paris, article iy i.
Le propriétaire n’eft ainfi préféré que pour les trois
derniers quartiers &: le courant, à-moins que le bail
n’ait été pafle devant notaire ; auquel cas le privilège
auroit lieu pour tous les loyers échus & à échoir.
Les meubles des fous-locataires ne font obligés
envers le propriétaire, que pour le loyer de la portion
qu’ils occupent. Coutume de Paris, article i jx - ^
La même coutume, article t y i , autorife leproprietaire
à faire procéder par voie de gagerie fur les meublés
étant en fa maifon, pour le louage à lui dû. Voyef
Gagerie & Saisie.
Quand les meubles font tranfportés hors de la maifon,
le propriétaire perd fon privilège fur ces meubles.
Mais fi les meubles ont été enlevés fans fon çon-
fentement, il peut revendiquer comme fon gage, &
les faire réintégrer dans la maifon pour la sûreté de
fes loyers.
Le droit romain ne donne de privilège au propriétaire
d’une ferme de campa|ne pour être payé de fes
fermages, que fur les fruits recueillis dans fa ferme.
Ce privilège fur les fruits a lieu , foit que le fermier
exploite lui-même, ou qu’il ait fubrogé une
autre perfonne en fa place , ou qu’il ait fous-fermé.
Mais le droit romain ne donne au propriétaire de
la ferme, aucun privilège fur les meubles & uftenfi-
le s , qu’au cas qu’il ait été ainfi ftipulé.
Cependant la coutume de Paris, article l y i , accorde
un privilège fur lés meubles pour les fermes
comme pour les maifons en faveur des propriétaires.
Cette difpofition étant finguliere, ne doit point être
admife dans les coutumes qui ne l’ordonnent point
ainfi. Voye{ au digefte le titre locati conducli, & au
code le titre de locato conducto ; Louet & Brod. lettre
f , tome IV. & Coquille, queft. & rép. art. ioz ; le
Pretre, arrêts de la cinquième & fécondé cent. ch. Ivij.
Henrys, tome I. liV.tIV . ch. vj. .queft. zy. journ. des
aud. tome I. livre V II I . ch. x xv. & les mots Achat ,
Bail , Ferme, Fermage , Loyer. ( A ) _
PROPRIÉTÉ , f. f. ( Métaphyjique. ) les Philofo-
phes ont coutume d’appeller propriété d’une chofe ,
ce qui r i eft pas fon effence , mais ce qui coule & eft déduit
de fon effence. Tâchons à démêler exactement le
fons de cette définition, pour y découvrir de nouveau
une première vérité qui eft fouvent méconnue.
Ce qu’on 'marque dans la définition de la propriété,
qu’elle eft ce qui coule ou f e déduit de V effence , ne peut
s’entendre de l’effence réelle & phyfique. Suppofé,
par exemple, ce qu’on dit d’ordinaire, que d’être
capable d’admirerfoit une propriété de l’homme, cette
capacité d’admirer eft auffi intime & néceffaire à
l’homme dans fa conftitution phyfique & réelle, que
fon effence même, qui eft d’être animal raifonnable ;
en forte que réellement il n’eft pas plutôt ni plus vé ritablement
animal raifonnable, qu’il eft capable d'admirer
; & autant que vous détruifez réellement de
cette qualité capable d'admirer, autant à mefufe dé-
truifez-vous de celle-ci animal raifonnable : puifque
réellement tout ce qui eft animal raifonnable, eft né-
ceffairement capable d’admirer ; & tout cè qui eft
capable d'admirer, eft nécefiairement animal raifon-
nable.
La différence de la propriété d’avec l’ effence>, n’eft
donc point dans la conftitution réelle des êtres, mais
dans la maniéré dont nous concevons leurs qualités
nécefîaires. Celle qui fe préfente d’abord & là première
à notre efprit, nous la regardons comme l'effence;
& celle qui ne; s ’y préfente pas fi-tôt ni fi ai-
fément, nous l’appelions propriété.
De favoir, fi par divers rapports, ou du-moins par
rapport à divers efprits, ce qui eft regardé comme
effence, ne pourroit pas être regardé comme propriété
; c’eft de quoi je ne voudrois pas répondre. Il fe
peut faire aifément que parmi diverfies qualités, également
néceflaires &: unies enfemble dans un même
e tre , l’une fe préfente la première à certains efprits,
& l’autre la première à d’autres efprits. En ce cas ;
ce qui eft effence pour les uns ne fera que propriété
pour les autres ; ce qui fera dans le fond une diftin-
riion ou une difpute affez inutile. En effet, puifque
la qualité qui fait Va propriété, & celle qui fait i’effenT
c e , fe trouvent nécefiairement unies , je trouverai
^gaiement, & que l’eflence fe conclut de la propriété,
Tome X I I I , "
& qae la propriété fe conclut de l’ effence ; le refte ne
vaut donc pas la peine d’arrêter des efprits raifonna-
bles : en voici un exemple.
Si l’on veut donner pour effence au diamant d’être
extraordinairement dur, Sc pour propriété, de
pouvoir réfifter à de violens coups de marteau , je
ne m ÿ oppoferai point : mais s’il me vient à l’efprit
de lui mettre pour effence, de réfifter à de violens
coups de marteau, & pour propriété d’être extrêmement
dur , quel droit aura-t-on de s’y oppofer? On
me dira que c’eft qu’on conçoit la dureté dans le diamant
ayant la difpofition de réfifter au marteau : &
moi je dirai que j’ai expérimenté d’abord, & par
çonféquent que j’ai conçu en premier lieu dans le
diamant, la difpofition de réfifter aux coups de marteau;
& que par-là j’en ai conclu fa dureté, laquelle,,
fous ce rapport, n’eft connue qu’en fécond lieu. Dans
cette curieufo difpute, je demande qui aura plus de
raifon de mon adverfaire ou de moi? De part Sc
d’autre, ce fera une differtation qui ne peut fe terminer
fenfément qu’en reconnoiflant que la propriété
eft 1 effence, & l’effence eft la propriété ; puifque au
fond être dur & être propre à réfifter à des coups
de marteau, font abfolument la même chofo fous,
deux regards différens.
P r o p r i é t é , ( Droit naturel & politique. ) c ’ e ft l e
d r o i t -que ch a cu n d e s in d iv id u s d o n t u n e fo c ié t é c iv
il e e f t c om p o f é e , a fu r le s b ie n s q u ’i l a a c q u is lé g it
im em e n t .
Une des principales vues des hommes en formant
des fociétés civiles, a été de s’affurer la poffeffion
tranquille des avantages qu’ils avoient acquis, ou'
qu’ils pouvoient acquérir; ils ont voulu que perfonne
ne pût les troubler dans la jouiffance de leurs
biens; c’eft pour cela que chacun a confond à en fa-
crifier une portion que l’on appelle impôts, à la con-
fervation & au maintien de la fociété entière ; on a
voulu par-là fournir aux chefs qu’on avoit ehoifis les
moyens de maintenir chaque particulier dans la jouiffance
de la portion qu’il s’étoit réforvé. Quelque fort
qu’ait pu être l’enthoufiafme des hommes pour les
fouverains auxquels ils fe foumettoient, ils n’ont jamais
prétendu leur donner, un pouvoir abfolu & illimité
fur tous leurs biens; ils n’ont jamais compté
fe mettre dans la néceffité de ne travailler que pour
eux. La flatterie des courtifans , à qui les principes
les plus abfurdes ne coûtent rien , a quelquefois
voulu perfuader à des princes qu’ils avoient un droit
abfolu fur les biens de leurs fujets ; il n y a que les
defpotes Scies tyrans qui ayent adopté des maximes
fi déraifonnables. Le roi de Siam prétend être pro-
. priétaire de tous les biens de fes fujets; le fruit d’un
droit fi barbare , eft que le premier rébelle heureux
fe rend propriétaire des biens du roi de;Siam. Tout
pouvoir qui n’eft fondé que fur la force fe détruit par
la même voie- Dans les états où l’on fuit les réglés
de la raifon, les propriétés des particuliers font fous
la protection des lois'; le pere de famille eft afluré de
jouir lui-même & de tranfmettre à fa poftérité les
biens qu’il a amaffés par fon travail ; les bons rois
ont toujours refoe&é lés poffeffions de leurs fujets ;
ils n’ont regardé les deniers publics qui leur ont été
confiés, que comme i;n dépôt, qu’ il ne leur étoit
point permis de détourner pour iatisfaire ni leurs
paffions frivoles , ni l’âvidité de leurs favoris, ni la
rapacité de leurs courtifans. Voye£ S u j e t s .
PROPTOSE, f. f. {Médecine.) maladie de l’oeil ; les
auteurs fe fervent de ce mot générique pourdéfigner
toutes les tumeurs particulières que l’on remarque
au-deffus de la cornée, foit qu’elles foient formées
par la cornée éminente, par la cornée relâchée, ou
par l’uvée qui fe poufl'e au-travers de la cornée. Ils
appellent auffi de. ce nom tous les forjettemens du
•globe de l’oeil hors de l’orbite , quelle qu’en foit la